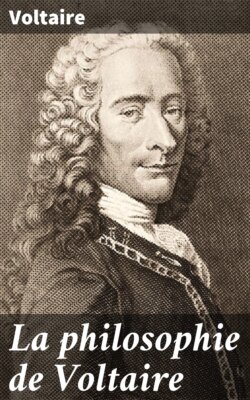Читать книгу La philosophie de Voltaire - Voltaire - Страница 6
III.
ОглавлениеLe reste de ses opinions philosophiques n’est pas ce qu’on attend d’après la renommée. Il n’est pas ce que trop souvent on imagine, un sceptique qui doute absolument de tout et ne se plaît qu’à détruire. Il a ruiné plus d’une croyance, mais au profit des vérités naturelles, et de la tolérance, qui lui était la meilleure des vérités. Il a constamment, et en mille endroits, soutenu avec énergie l’existence d’un Dieu qui a fait et gouverne le monde; et il avait le droit de le dire: «Il y a eu des gens qui m’ont appelé athée, c’est appeler Quesnel moliniste.» Il a soutenu avec la même opiniâtreté l’existence d’une loi morale, règle absolue des actions humaines. La liberté l’a embarrassé plus d’une fois comme bien d’autres philosophes; il se rappelle avec complaisance le mot de Locke, avouant qu’il était là comme le diable de Milton pataugeant dans le chaos, mais, même dans ses plus mauvais moments, loin de la nier, il s’offensait qu’on la niât, et devenait affirmatif pour la défendre. Sa polémique contre Frédéric est un chef-d’œuvre. Il croyait volontiers que Dieu peut donner la pensée à la matière, et il a eu le malheur de railler l’âme spirituelle; mais il avait horreur du matérialisme, qui ne voit et n’estime dans l’homme que l’animal. Enfin il n’est pas très-ferme sur l’immortalité de l’âme: il mêlait trop l’esprit avec le corps, et dans la décomposition des organes il avait peine à le retrouver; mais sauf quelques propos assez légers sur cette matière, dans les discussions sérieuses qui reviennent souvent, il ne permet point qu’on supprime ce dogme: selon lui, affirmer est téméraire, nier l’est plus encore. Il a été téméraire, à son honneur: rapportant toutes ses croyances à la pratique, et sentant bien que la crainte des châtiments futurs est nécessaire pour contenir le crime, que, sans les punitions de l’autre vie, la morale dans la vie présente n’a plus de sanction, il a plaidé l’immortalité de l’âme et a été éloquent. Que de doutes devront lui être pardonnés pour cette noble protestation contre le fatalisme du roi de Prusse! «Vous m’épouvantez; j’ai bien peur, pour le genre humain et pour moi, que vous n’ayez tristement raison. Il serait affreux pourtant qu’on ne pût pas se tirer de là. Tâchez, sire, de n’avoir pas tant raison; car encore faut-il bien, quand vous faites de Potsdam un paradis terrestre, que ce monde-ci ne soit pas absolument un enfer. Un peu d’illusion, je vous en conjure. Daignez m’aider à me tromper honnêtement..... Je me doute bien que l’article des remords est un peu problématique; mais encore vaut-il mieux dire avec Cicéron, Platon, Marc-Aurèle, etc., que la nature nous donne des remords, que de dire avec La Mettrie qu’il n’en faut point avoir.»
Voltaire semble sensualiste contre Descartes comme il semble pessimiste contre Leibniz; mais le Descartes qu’il combat n’est pas le vrai, et au fond, sans le savoir, il est de son école. Voyant bien qu’il y a dans l’esprit humain des vérités nécessaires, éternelles et immuables, Descartes avait dit qu’elles ne nous viennent pas du dehors, qu’elles sortent du fond de notre nature, se forment au-dedans de nous, dans notre raison, par une opération naturelle et mystérieuse; pour marquer sa pensée par un mot énergique, il les nommait idées innées. La doctrine était incontestable, mais l’expression prêtait à la méprise, et, comme il arrive souvent, le mot étouffa la chose. On lui attribua l’opinion bizarre que nous naissons avec certaines idées toutes faites, comme nous naissons avec des yeux et des mains; un tel système ne pouvait obtenir d’autre fortune que la fortune du ridicule. Qu’on ouvre les Essais de Locke, que de temps et de peine il perd à prouver contre Descartes que nous n’apportons pas d’idées en venant au monde; dans Voltaire, que d’esprit vainement dépensé contre une théorie fabuleuse! Il a ses antipathies en fait de systèmes comme en fait de personnes, celle-là en est une. L’idée innée prête au ridicule, il l’en couvrira. Voyez, par exemple, comme il l’expose et la juge dans Micromégas: «Le cartésien prit la parole et dit: L’âme est un esprit pur, qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligée d’aller à l’école, et d’apprendre tout de nouveau ce qu’elle a si bien su, et ce qu’elle ne saura plus. Ce n’était donc pas la peine, répondit l’animal de huit lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton.» Voltaire est sensualiste contre Descartes, ou plutôt contre le Descartes qu’il imagine; le voilà donc Sous les drapeaux de Locke, mais je crains bien qu’on ne l’y retienne malaisément; un soldat si clairvoyant, qui veut toujours savoir au juste pourquoi il se bat, n’est pas commode à gouverner. Si Locke, dans la chaleur de la lutte, se laisse emporter trop loin, si un coup destiné à Descartès atteint le bon sens, Voltaire désertera. Le philosophe ignorant qui ignore tant de choses, ce philosophe si peu dogmatique qui n’affirme qu’en parlant des bornes étroites de notre intelligence, des découvertes impossibles, du désespoir fondé, de la faiblesse des hommes, ce philosophe ose annoncer, en tête de deux chapitres, qu’il va Combattre Locke, son maître. Ce maître si écouté a, par malheur, prétendu que la justice est arbitraire; son disciple le corrige sévèrement. La loi morale peut être plus d’une fois mal appliquée dans les détails, mais elle-même est universelle et nécessaire. «Dieu nous a donné une raison qui se fortifie avec l’âge, et qui nous apprend à tous, quand nous sommes attentifs, sans préjugés, qu’il y a un Dieu et qu’il faut être juste..... En abandonnant Locke en ce point, je dis, avec le grand Newton: Natura est semper sibi consona, la nature est toujours semblable à elle-même. La loi de la gravitation qui agit sur un astre agit sur tous les astres, sur toute la matière; ainsi la loi fondamentale de la morale agit également sur toutes les nations bien connues. Il y a mille différences dans les interprétations de cette loi en mille circonstances; mais le fond subsiste toujours le même, et ce fond est l’idée du juste et de l’injuste. On commet prodigieusement d’injustices dans les fureurs de ses passions, comme on perd sa raison dans l’ivresse; mais quand l’ivresse est passée, la raison revient. La société n’est fondée que sur ces notions, qu’on n’arrachera jamais de notre cœur. Quel est l’âge où nous connaissons le juste et l’injuste? L’âge où nous connaissons que deux et deux font quatre.»
Est-ce Voltaire, est-ce Descartes qui parle ainsi? Et ce n’est point chez lui une saillie, il y revient partout avec une décision et une vigueur qui ne se démentent point. L’homme qui croit à Dieu, à la liberté et à la justice absolue n’est pas un sensualiste assurément. Un véritable sensualiste, c’est d’Holbach, et Voltaire écrivait en tête d’un exemplaire du Bon sens de cet auteur: «Il prend quelquefois ses cinq sens pour du bon sens.»
Interrogez Voltaire sur l’existence de l’âme; c’est bien lui qui écrit: «Je suis en peine, monsieur, de toute âme et de la mienne.» Il prie3 l’honnête homme qui fera Matière (dans l’Encyclopédie) de bien prouver que le je ne sais quoi qu’on nomme matière peut aussi bien penser que le je ne sais quoi qu’on appelle esprit. Il soutient sans faiblir une fois, d’accord avec Locke, que Dieu peut donner la pensée à la matière. Qu’est-ce, au juste, que cette opinion? Les spiritualistes se récrient comme s’ils étaient en présence du matérialisme. Non, disent-ils, Dieu ne saurait faire ce qui est contradictoire; or il est contradictoire que la pensée incorporelle appartienne à la nature palpable, que la matière, toujours divisible, ait conscience de son unité, comme il arrive dans l’homme. On ne peut mieux, si en effet la matière est toujours divisible; mais si, comme le veut Leibniz, les derniers éléments sont simples, elle peut donc penser tout comme l’esprit dont elle a la nature. Or sommes-nous en plein matérialisme avec Leibniz? On n’a pas osé le dire, on ne l’osera pas. Plusieurs docteurs de la primitive Église ont cru l’âme corporelle; étaient-ils donc à-la-fois matérialistes et chrétiens? Quoi! la proposition de Locke et de Voltaire, si suspecte chez eux, devient-elle ici innocente et perd-elle son venin en changeant de lieu? Parlons franchement; cessons, comme dirait Descartes, de nous battre dans des caves: on n’est point matérialiste pour prétendre que la matière est capable de penser, ni spiritualiste pour prétendre qu’elle en est incapable.
Entre le spiritualisme et le matérialisme, l’éternelle question n’est pas, en dépit des apparences, de savoir s’il n’y a qu’une seule nature d’êtres ou s’il y en a deux, seulement de l’étendue, seulement de l’esprit, ou ensemble de l’esprit et de l’étendue, mais si dans l’homme il n’y a qu’une seule vie, qu’une seule destinée. Admettez-vous qu’en nous tout tende vers un but unique, la perfection du corps, le bon état et le bien-être de cette machine qui digère, respire, change de place; que nous devions n’avoir qu’une seule préoccupation: respirer à notre aise, digérer sans peine, nous mouvoir librement, donner à nos sens le plus possible de jouissances, en écarter avec le plus grand soin la douleur, nous établir dans ce monde en telles conditions de fortune, de puissance qui nous rendent cette tâche facile, cultiver notre esprit dans la mesure que réclame cet art du bien vivre; rapporter tout à ce centre, sans autre pensée, sans autre souci, vous êtes matérialiste. Si, au contraire, la destinée physique vous semble étroite, la pensée trop noble pour se mettre tout entière au service du corps; si le cœur humain vous semble renfermer d’autres désirs que ceux qui ont le corps pour objet; si au-dessus de la perfection des organes vous concevez une autre perfection de tout autre nature; si vous rêvez de science infinie, de dévouement; si vous vous sentez soulevé de terre vers un monde supérieur, peuplé de grandes pensées, de sentiments généreux; si vous comprenez qu’on doit sacrifier le bien-être et même la vie du corps pour vivre de cette autre vie, vous êtes spiritualiste. Cet être qui pense et cet être qui respire sont-ils de même nature? Dussé-je toujours l’ignorer, ce que je sais de science certaine, c’est qu’il y a en moi un double mouvement, une double destinée: l’une de conserver, de perfectionner en moi l’animal qui est né il y a quelques jours et dans quelques jours va mourir; l’autre, de conserver et de perfectionner en moi l’être intelligent, sensible et moral, avec ses aspirations infinies; ce que je sais de science certaine, c’est que la première de ces destinées est subordonnée à la seconde, comme la raison l’atteste, comme la loi morale le veut; et ainsi je suis un être immortel, de passage dans un corps mortel.
Voltaire a tort de croire que la matière peut penser, que l’âme a la nature du corps; mais pour être matérialiste, il faut qu’il ajoute que l’âme dépend entièrement du corps. Ne le dit-il pas en effet? «La disposition1 des organes fait tout..... La manière dont on digère décide presque toujours de notre manière de penser.» Voici encore
Lettre à Mme du Deffand, 1772, t. X, p. 415.
un mot qui plairait à La Mettrie: «On a une fluxion sur l’âme comme sur les dents.» Mais ce n’est pas son dernier mot: «C’est une plaisante chose que la pensée dépende absolument de l’estomac, et que malgré cela les meilleurs estomacs ne soient pas les meilleurs penseurs.» La Mettrie regarderait à deux fois avant de signer cette pensée, et il ne signerait certes pas celle-ci: «On fait aller son corps comme l’on veut. Lorsque l’âme dit: Marche, il obéit.» Au fond il la regardait comme un atome, une particule matérielle sans doute, mais d’une extrême ténuité et indivisible. On trouve souvent cette idée dans ses ouvrages philosophiques, et la lettre suivante au comte de Tressan exprime bien ses plus secrètes sympathies. «Vous me paraissez tenir pour ce feu élémentaire que Newton se garda bien toujours d’appeler corporel. Ce principe peut mener loin; et si Dieu, par hasard, avait accordé la pensée à quelques monades de ce feu élémentaire, les docteurs n’auraient rien à dire: on aurait seulement à leur dire que leur feu n’est pas bien lumineux, et que leur monade est un peu impertinente. » Un pas de plus, et la monade de feu élémentaire se tournait en pur esprit; Voltaire ne l’a pas fait. Mais il est entièrement des nôtres quand il accorde à l’âme la liberté, la connaissance de la loi morale qu’elle doit accomplir, et de Dieu sur qui la vertu s’appuie. Son instinct est moins matérialiste encore que sa raison. «Il faut donner à son âme toutes les formes possibles. C’est un feu que Dieu nous a confié, nous devons le nourrir de ce que nous trouvons de plus précieux. Il faut faire entrer dans notre être tous les modes imaginables, ouvrir toutes les portes de son âme à toutes les sciences et à tous les sentimens; pourvu que tout cela n’y entre pas pêle-mêle, il y a place pour tout le monde.»