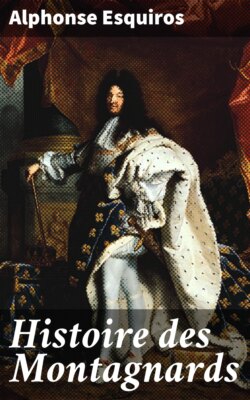Читать книгу Histoire des Montagnards - Alphonse Esquiros - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L'ASSEMBLEÉ CONSTITUANTE I
ОглавлениеTable des matières
Les élections.—Convocation des Etats généraux.—Serment du
Jeu-de-Paume.
L'élection des députés aux États généraux fut la préface de la Révolution Française; qui ne la trouve digne de l'oeuvre? Le pays, las de l'arbitraire, réclamait, par la voie des cahiers, une manière fixe d'être gouverné, une constitution. Les communes entendaient qu'on les délivrât de ces formes surannées qui classaient la nation en deux espèces d'hommes: les oppresseurs et les opprimés. Dans ces cahiers, dits de condoléance, on se plaignait des abus du système féodal, de l'absence d'une juridiction fixe et uniforme, des priviléges qui pesaient sur l'industrie, de l'inégalité des impôts et contributions territoriales. Tout était incertain, abandonné au hasard, c'est-à-dire au caprice des puissants. Le moyen qu'on indiquait pour remédier à ce mal dans la société, c'était de substituer la loi à l'arbitraire et d'armer les volontés générales d'une force réelle, supérieure à l'action de toute autre volonté. Déjà l'esprit de la Révolution était mûr; sa marche était tracée. L'autorité se déplaçait naturellement et sans bruit. De toutes parts, on sentait le besoin de limiter les anciens pouvoirs et d'en créer de nouveaux dans la nation même. Jusqu'ici le roi avait dit: «Nous voulons»; maintenant le pays voulait. [Note: Voyez les Cahiers de la Révolution, par Chassin, et le Bonhomme Jadis, par l'auteur des Montagnards éditeur Dentu.]
Les obstacles à cette heureuse rénovation étaient grands, mais ils ne semblaient point insurmontables. Les intérêts privés, en contradiction ouverte avec l'intérêt général, étaient de plus divisés entre eux. La guerre éclatait au sein même des priviléges et des privilégiés. La noblesse comptait sur les États généraux pour lier les mains du roi et pour appauvrir le clergé, qui, de son côté, songeait à humilier l'aristocratie. Il y avait alors le haut et le bas clergé: quel contre-sens parmi les ministres de Celui qui n'admettait pas qu'on fît acception des personnes! Le haut clergé voulait conserver tous les abus; le clergé inférieur consentait à certaines réformes. Le tiers état seul s'entendait pour détruire les inégalités dans l'Église et dans l'aristocratie. Les cahiers du clergé et de la noblesse contiennent d'ailleurs quelques voeux significatifs; on se reconnaissait mutuellement des torts. La conversion de l'ancien régime devait commencer par un examen de conscience et par une confession publique.
Ces importantes élections se firent dans les circonstances les plus critiques. L'année 1788 avait affligé la France d'une nouvelle disette. La terre se resserrait comme le coeur des riches dans cette société égoïste. L'été avait été sec, l'hiver fut froid: ni pain, ni feu. L'inactivité des travaux entraînait la baisse des salaires, qui, combinée avec la cherté des subsistances, répandait la tristesse et la misère dans les familles. Il faut sans doute que toutes les grandes choses germent dans le besoin et la pauvreté: la Révolution eut pour langes le déficit et la disette.
Le peuple supportait héroïquement tous ces maux. En présence de la démoralisation effroyable de la noblesse et du clergé, il avait les vertus qu'engendre le travail. Quelques troubles insignifiants, presque tous suscités par l'aristocratie ou par la cour, traversèrent, dans les provinces, les opérations des électeurs. A Paris, Réveillon, ancien ouvrier, fabricant de papiers peints, avait tenu des propos atroces. Il se proposait de réduire la paie des ouvriers à quinze sous par jour, disant tout haut que le pain était trop bon pour ces gens-là, qu'il fallait les nourrir de pommes de terre. Sa maison fut saccagée. Après un simulacre de jugement, il fut pendu lui-même en effigie sur la place de Grève. [Note: L'impartialité veut que je recueille tous les avis; voici celui de Barère: «Des intrigants excitèrent et ameutèrent les ouvriers pour avoir le prétexte de se plaindre officiellement des troubles de Paris et provoquer le déploiement violent de la force armée contre cette émeute de fabrique. On accusait alors un grand personnage d'avoir voulu effrayer les députés, produire une commotion populaire pour amener des troubles et par suite l'impossibilité de convoquer les États généraux.»]
Depuis quelques années, en France, les esprits étaient malades, comme il arrive presque toujours à la veille des transformations sociales. L'annonce de la convocation des États généraux fut pour tous un grand soulagement, une détente. Le 4 mai eut lieu à Versailles la messe du Saint-Esprit. Les députés du tiers état, en modestes habits noirs, mais acclamés par la faveur publique; la noblesse en grande pompe, avec ses chapeaux à plumes, ses dentelles et ses parements d'or, accueillie par un morne silence; le clergé divisé en deux classes: les prélats en rochet et robe violette, puis les simples curés dans leur robe noire, défilèrent devant une foule immense. Le roi fut applaudi; c'était pour le remercier d'avoir convoqué les États. Au passage de la reine s'élevèrent quelques murmures; des femmes crièrent: «Vive le duc d'Orléans!» Marie-Antoinette pâlit et chancela; la princesse de Lamballe fut obligée de la soutenir.
Ce jour-là, Versailles était Paris, la nation semblait étonnée d'avoir recouvré la parole après un silence forcé de soixante-quinze années. L'enthousiasme ne peut se décrire. Les vieillards pleuraient de joie, les femmes agitaient leurs mouchoirs aux fenêtres et jetaient des fleurs sur les députés des communes. Tous les coeurs s'ouvraient à une vie nouvelle. Les Français n'avaient été jusqu'ici que des sujets, le moment était venu pour eux de se montrer citoyens. L'évêque de Nancy, M. de La Fare, fit un sermon politique. Il parla contre le luxe et le despotisme des cours, sur les devoirs des souverains, sur les droits du peuple. Les idées de liberté, enveloppées dans les formes chrétiennes, avaient je ne sais quoi d'attendrissant et de solennel qui pénétrait toutes les âmes. On appellerait volontiers ce 4 mai le jour de la naissance morale d'une grande nation.
Le 5, les douze cents députés se réunirent dans la salle des Menus, convertie en salle des séances.
Le clergé fut assis à la droite du trône, la noblesse à gauche et le tiers en face. Le roi ouvrait d'une tremblante main l'antre des discussions politiques; il craignait d'en déchaîner les vents et les tempêtes. La frayeur perçait dans son langage embarrassé, diffus, ombrageux, et dans celui de son ministre, le garde des sceaux M. de Necker. On avait convoqué la nation, et on lui exprimait indirectement le voeu d'être délivré de son concours. La France prétendait hâter, par l'assemblée des États, les innovations nécessaires; la couronne comptait, au contraire, sur cette mesure pour les modérer. A des hommes rassemblés pour réformer et gouverner le pays, on ne parla que de finances, on ne demanda que des subsides. La cour ne voulant pas que la discussion s'élevât jusqu'aux idées, elle lui traçait d'avance un programme. Les représentants de la nation étaient encore attachés à la personne du roi, mais ils se retranchèrent derrière leur mandat pour lui résister. Louis XVI avait une belle occasion de retremper ses droits dans la souveraineté populaire: c'était d'abdiquer son pouvoir en entrant dans la salle des séances, pour le recevoir ensuite du libre consentement de l'Assemblée. Il n'en fit rien.
Une question préoccupait surtout les esprits: quelle serait enfin la situation du tiers relativement aux deux autres ordres? Le voeu des communes était formel: les Français devaient cesser d'appartenir à différentes classes; à l'avenir, l'ensemble des citoyens et du territoire constituerait l'État. Il ne doit y avoir qu'un peuple, qu'une Assemblée nationale. Les États se trouvèrent réduits, dès le début, à l'inaction. La noblesse et le clergé voulaient qu'on votât par ordres, et les communes par têtes. La noblesse montrait pour ses priviléges un attachement intraitable; le clergé ne voulait pas abandonner ses prétentions; la vieille France hésitait à se fondre dans la France nouvelle. Composée d'éléments hétérogènes, l'Assemblée ne pouvait vivre qu'en les ramenant à l'unité. Le tiers état se trouvait être le lien de cette unité nécessaire, le médiateur des pouvoirs particuliers qui allaient se réunir dans un grand pouvoir national.
Je passe sur bien des lenteurs et des retards; je ne puis pourtant omettre les résistances qui amenèrent la ruine de ce qu'on espérait sauver. Ces fluctuations (on perdit tout un grand mois à négocier pour la réunion des trois ordres) réjouissaient la cour. Les défiances du pouvoir souverain croissaient avec l'énergie des communes. En même temps, on serrait Paris de troupes. Le mauvais vouloir des conseillers du roi éclatait par des actes significatifs: le Journal des États généraux, dont Mirabeau avait publié la première feuille, venait d'être supprimé. Quel moment choisissait-on pour mettre le scellé sur les idées? Celui où la nation, impatiente, s'était réunie pour rompre le silence violent qu'on lui imposait depuis des siècles! La liberté de la presse, mère de toutes les autres libertés, venait d'être frappée: c'est toujours la première à laquelle s'attaquent les réactions.
La cour espérait rencontrer peu de résistance à l'exécution de ses projets. Quels étaient ces projets? Louis XVI avait-il l'intention de frapper un grand coup? Voulait-il attaquer ou se défendre? Mais se défendre contre qui? Le peuple et l'Assemblée tenaient encore pour le roi. Cette conduite louche et ténébreuse entretenait une inquiétude profonde. «Que la tyrannie se montre avec franchise, s'écriait Mirabeau, et nous verrons alors si nous devons nous roidir ou nous envelopper la tête!» Mirabeau! qu'était cet homme?—Un monstre d'éloquence.—Que venait-il faire?—Détruire. Il reprochait à la société les meurtrissures qu'elle lui avait faites, et les vices dont il était gangrené. Ses aventures scandaleuses avaient fait du bruit, mais, comme les rugissements du lion imposent silence, dans la forêt, aux cris lugubres du chacal et aux hurlements de la hyène, cet homme allait écraser la médisance sous la puissance de son organe.
Le jour où il parut aux États généraux fut pour lui, de même que pour le pays, un jour de rénovation. Mirabeau avait eu à souffrir de la tyrannie de la famille et de celle du pouvoir; il allait envelopper son ressentiment dans la colère d'un grand peuple.
La situation devenait périlleuse. La cour, livrée à une agitation extrême, n'osait ni frapper ni céder. Dans des conjonctures si difficiles, l'Assemblée sentait le besoin de lier son sort à celui du peuple. «Que nos concitoyens nous entourent de toutes parts, s'écriait Volney, que leur présence nous anime et nous inspire!» D'un autre côté, les royalistes répétaient à outrance que la société allait périr sous le débordement de la démocratie. Au milieu de tant d'ennemis, l'Assemblée ne disposait que d'une force morale; à la vérité, cette force commençait à être immense. La voix des députés du tiers était grossie par tous les échos de l'opinion publique. Les têtes bouillonnaient, et le volcan dont on entendait déjà les grondements sourds et profonds ouvrait son cratère à quatre lieues de Versailles. La cour avait pour elle l'armée; l'Assemblée avait Paris. Là, l'exaspération était au comble: les aristocrates indignaient le peuple par le retard qu'ils apportaient à l'organisation de l'Assemblée. Au milieu du jardin du Palais-Royal s'élevait une sorte de tente en planches où l'on discutait sur les affaires publiques. Chaque café était un club; chaque club avait ses orateurs. Les plus hardis déclaraient que si la cour persistait dans sa résistance, la noblesse dans son refus de se joindre aux deux autres ordres et l'Assemblée des États dans son immobilité, le peuple ferait bien d'agir par lui-même. La disette contribuait à entretenir cette fermentation. Des nouvelles inquiétantes circulaient de bouche en bouche. Les troupes se massaient entre Paris et Versailles. Pourquoi ce déploiement de forces? Pourquoi dans l'état de détresse où étaient les finances de la nation, faisait-on venir des frontières, à grands frais, des trains formidables d'artillerie? Il fallait du pain, on apportait des boulets!
A Versailles, le sentiment national était plus calme; mais il était aussi ferme. On s'attendait à un acte d'autorité royale, à un coup d'État. La situation était telle qu'elle ne pouvait se prolonger. L'entêtement et la violence des conservateurs devait, d'un jour à l'autre, provoquer la lutte. Le bien allait-il sortir de l'excès du mal? Les Communes, entravées dans leur marche par la résistance passive des deux autres ordres, le haut clergé et la noblesse, enveloppées par les intrigues de la cour, à bout de patience, mettaient une lenteur désespérante dans la vérification des pouvoirs.
Les députés du tiers, comme étant les plus nombreux, avaient pris possession de la grande salle. C'est là qu'ils sommaient les deux autres ordres de se réunir à eux; mais toutes les tentatives de rapprochement avaient échoué. L'Assemblée existait depuis un mois, et elle n'avait pas encore de nom. On en proposa plusieurs qui furent écartés. Enfin l'abbé Sieyès obtint qu'elle s'intitulât ASSEMBLÉE NATIONALE. Près de cinq cents voix consacrèrent cet acte de hardiesse.—Qu'était l'abbé Sieyès? Un esprit profond, marchant droit à son but par des voies souterraines, l'homme de la révolution bourgeoise, un grand logicien qui avait posé le fameux axiome du tiers état, entre tout et rien. Contrarié par la volonté de ses parents, dans le choix d'une carrière, il se soumit à épouser tristement l'Église. Ce fut un mariage de raison. Comme chez lui la passion était dans la tête, le jeune homme se livra tout entier aux charmes austères de l'étude. Il contracta dans ce commerce une mélancolie sauvage et une morne insensibilité. Au sortir du séminaire de Saint-Sulpice où l'étude stérile de la théologie n'avait point absorbé toutes ses forces, il se livra à de profondes recherches sur la marche égarée de l'esprit humain. Ses méditations se tournèrent vers la politique. Quand les vieilles institutions sociales furent attaquées, il se montra tout à coup sur la brèche. Son caractère était timide, effet inévitable de la solitude dans laquelle il avait vécu; mais il possédait la hardiesse de l'esprit. Taciturne, il gardait en lui-même ses pensées, et quand le moment de les dire était venu, il les acérait comme des flèches.
L'Assemblée, réduite au tiers état par l'absence volontaire de la noblesse et du clergé, poursuivait ses travaux. Cette marche inquiéta sérieusement la cour, qui résolut de suspendre les séances. Une mesure aussi arbitraire était bien faite pour jeter la consternation dans Versailles et la guerre civile dans Paris. On annonça une séance royale pour le 23 juin. Puis, sous prétexte de travaux à faire pour la décoration du trône, un détachement de soldats s'empare de la salle des États, et en défend l'entrée: la nation est mise à la porte de chez elle.
Où aller?
Les députés ahuris ouvrirent entre eux des avis différents. Déjà plusieurs brochures avaient émis le voeu que l'Assemblée nationale eût son siége à Paris. S'y transporterait-on? Les sages reculèrent devant cette résolution extrême. Les uns voulaient s'assembler sur la place d'Armes et délibérer à ciel ouvert; invoquant en faveur de leur opinion les souvenirs de notre histoire, ils proposaient de tenir un champ de mai. D'autres criaient: «A la terrasse de Marly!» On flottait entre ces avis contradictoires, quand on apprit que Bailly, d'après le conseil du député Guillotin, avait choisi pour lieu de la séance la salle du Jeu-de-Paume.—Bailly avait la figure longue, grave et froide, un peu le profil calviniste. Son opposition à l'ancien régime était aussi calme qu'inflexible. Il avait obtenu très-longtemps le prix de sagesse; on désignait ainsi une pension accordée aux écrivains sérieux et tranquilles. Astronome, il avait étudié la marche de la Révolution tout en suivant le mouvement des corps célestes. De même que les mondes observés dans l'espace, l'esprit humain est soumis à des lois: c'est un équivalent de ces lois que Bailly, homme d'ordre, aurait voulu introduire dans la société de son temps. Revenons aux députés errants dans les rues de Versailles par une journée pluvieuse et triste. Le peuple escorte avec respect et en silence ces représentants de la nation blessés dans leurs droits et dans leur dignité. La salle du Jeu-de-Paume, triste et nue, convenait à la circonstance. Tous les membres influents des commumes étaient réunis. On remarquait surtout parmi eux un ministre protestant, Rabaud Saint-Etienne; un chartreux, dom Gerle; un curé, l'abbé Grégoire [Note: Un jour le statuaire David accompagnait à Versailles l'abbé Grégoire. L'ancien membre de l'Assemblée nationale voulait revoir cette salle du Jeu-de-Paume, muet témoin d'un si grand acte de courage. Il la retrouve. Tel ses souvenirs l'oppressent, il garde un religieux silence que son compagnon a la délicatesse de respecter. Quand David leva les yeux, il vit de grandes larmes rouler noblement sur les joues du vieillard. «Si jamais mon amour de la liberté pouvait s'affaiblir, s'écria l'abbé Grégoire, pour le rallumer, je tournerais les regards vers cette salle!»]. Ce fut un modéré, Mounier, de Grenoble, qui proposa le serment du Jeu-de-Paume: «Les membres de l'Assemblée nationale jurent de ne se séparer jamais jusqu'à ce que la constitution du royaume et la régénération de l'ordre public soient établies et affermies sur des bases solides.» Bailly, d'une voix distincte et haute, lit la formule du serment, et en sa qualité de président jure le premier. Alors tous les bras se lèvent. L'ivresse du patriotisme éclate de toutes parts; on s'embrasse; les mains cherchent les mains; tous les coeurs palpitent, l'enthousiasme déborde. Cependant le ciel fait fureur; de larges gouttes de pluie tombent sur le toit de l'édifice; à l'une des fenêtres défoncées un rideau est tordu par l'orage; le jour est si sombre qu'on y voit à peine dans la salle. Un éclair déchire cette obscurité sinistre; le tonnerre gronde. Quel moment et quelle grandeur! Un orage au dehors, une révolution dans l'assemblée. A peine les députés du tiers eurent-ils accompli cet acte de sagesse virile et d'autorité, qu'effrayés eux-mêmes de leur audace ils poussèrent le cri de Vive le roi! L'illusion de la monarchie constitutionnelle n'était point alors évanouie. Quoi qu'il en soit, l'effet de cette séance fut électrique; les curieux firent entendre au dehors leurs applaudissements prolongés qui allèrent se perdre dans les derniers éclats de la foudre. Les représentants s'étaient montrés dignes de la nation: tout était sauvé.