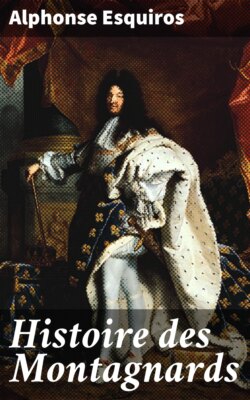Читать книгу Histoire des Montagnards - Alphonse Esquiros - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Etat des esprits.—Première émigration.—La disette.—Mort de Foulon et de Bertier.—Conduite du clergé français dans les premiers temps de la Révolution.
Paris livré à lui-même, Paris lâché dans l'ivresse de sa victoire, inspirait de graves inquiétudes à certains membres de l'Assemblée nationale. Le sentimental et larmoyant Lally fit une motion qui tendait à calmer l'effervescence des habitants de la grande ville. Réprimer trop tôt l'esprit public, dans les temps de révolution, c'est quelquefois l'amollir. Robespierre se leva. On trouve, dans les premiers mots qu'il fit entendre, les principaux traits de son caractère politique: respect et amour de la nation, horreur de l'intrigue. Il la poursuit, cette intrigue, sous le masque du parti de la cour, comme il la poursuivra dans la suite sous le masque des Girondins. Cet homme arrivait à la Révolution, armé de toutes pièces par l'intégrité de ses principes. Jusqu'ici du reste rien ne le désigne à l'attention; il se confond, il s'efface dans la pâle multitude des orateurs. Le dénouement de la Révolution était dans cet homme à part; mais il se montrait encore trop couvert d'ombre pour qu'on pût distinguer toute sa valeur.
Un autre député, alors inconnu, tour à tour ami et ennemi de Robespierre, siégeait sur les mêmes bancs; son nom était Barère. Voici le portrait qu'en trace madame de Genlis: «Il était jeune, jouissait d'une très-bonne réputation, joignait à beaucoup d'esprit un caractère insinuant, un extérieur agréable, et des manières à la fois nobles, douces et réservées. C'est le seul homme que j'aie vu arriver de sa province avec un ton et des manières qui n'auraient jamais été déplacés dans le grand monde et à la cour. Il avait très-peu d'instruction, mais sa conversation était toujours aimable et toujours attachante: il montrait une extrême sensibilité, un goût passionné pour les arts, les talents et la vie champêtre. Ses inclinations douces et tendres, réunies à un genre d'esprit très-piquant, donnaient à son caractère et à sa personne quelque chose d'intéressant et de véritablement original.» Enfant des Pyrénées, il aimait la constitution de ces montagnes, décrétée il y a des siècles par la nature, ces vallées embellies par des moeurs candides et pastorales; il aimait jusqu'aux torrents et aux ours, car tout cela c'était le pays. Son enfance avait été rêveuse; sa jeunesse fut mélancolique. «On ne fait pas, écrit-il lui-même, assez attention aux préliminaires des grands accidents de la vie. Ce sont pourtant des avertissements que la Providence nous donne, mais dont nous profitons rarement, soit qu'ils passent inaperçus, soit qu'ils arrivent trop tard. Lors de mon mariage, en 1785, qui fut une grande fête de famille à Vic et à Tarbes, j'allais à l'autel avec ma jeune fiancée; c'était au milieu de la nuit; l'église était resplendissante de lumières; une société nombreuse de parents et d'amis nous entourait. Une profonde tristesse me serrait le coeur, et, lorsque je prononçai le oui solennel, des larmes coulèrent involontairement sur mes joues décolorées. Il n'y eut que ma mère qui s'en aperçut, et qui, après la messe des épousailles, me prit la main et la serra contre sa poitrine.» Ce mariage fut malheureux: attachée à la cause de l'aristocratie par goût et par tradition de famille, la jeune femme ne pardonna pas à son mari d'avoir embrassé la cause de la nation. Barère exerçait la profession d'avocat quand le mouvement de la France l'envoya aux États généraux. Il était alors pour la monarchie tempérée. Doué d'une imagination vive, mobile, chauffée au soleil du Midi, il avait essayé sa plume dans quelques ouvrages peu connus, couronnés par l'Académie de Toulouse. A Paris, il rédigeait, depuis l'ouverture des États, une feuille intitulée le Point du Jour. Nature vive, sémillante, la variété des impressions s'opposait chez lui à la durée. Barère avait dans l'esprit la grande qualité des femmes, la pénétration. Le mouvement rapide de ses idées et de ses sentiments ne lui permit point de se fixer à un principe. Fin, rusé, grand comédien, voulant à tout prix sauver sa tête, cet homme d'État fut, selon le cours des événements, le caméléon des diverses nuances révolutionnaires.
Dans son journal, le Point du Jour, il attaquait avec ardeur le parti de la cour, dénonçait à l'indignation publique les menées et les conduites occultes d'un parti qui préférait renoncer à la France que d'abandonner ses prétentions et ses priviléges. Déjà, en effet, le mouvement de l'émigration avait commencé. Le frère de Louis XVI, le comte d'Artois, les Condé et les Conti, les Polignac, les Vaudreuil, les de Broglie, les Lambesc et d'autres étaient passés à l'étranger. Une lourde responsabilité pèse sur la tête de ces hommes. Déserter son pays parce que la cause à laquelle on avait rattaché ses intérêts est en péril, se faire étranger par le coeur, se fermer volontairement la France, quel triste exemple donnait alors la haute aristocratie! Ce sauve qui peut avait d'ailleurs une autre signification: ces princes, ces nobles, passaient avec toute vraisemblance pour bien connaître la pensée de Louis XVI.
Le roi trompait-il donc le peuple de Paris quand il lui disait: «Vous pouvez avoir confiance en moi?»
Revenons à Paris. La ville était calme à la surface, mais, sous le repos même, on distinguait les dernières agitations de l'orage. Une circonstance souleva de nouveau toute cette masse d'hommes. Parmi les accapareurs de blés, qu'on accusait d'être les auteurs de la misère et de la disette, la clameur publique dénonçait surtout un nommé Foulon. Abhorré dès le dernier règne, il n'avait vécu jusqu'à soixante ans que pour entasser sur sa tête les accusations les plus graves. Ses monopoles odieux le couvraient de l'indignation publique: c'était son vêtement, sa chemise de soufre. Il fallait que cet homme se jugeât lui-même bien coupable envers le peuple, puisqu'il avait fait répandre partout le bruit de sa mort et enterrer, à sa place, le cadavre d'un de ses domestiques. Bien vivant, il avait quitté Paris le 19 juillet et s'était caché dans une terre de M. de Sartines, à Viry, petit village situé sur la route de Fontainebleau. C'est là qu'il fut aperçu et saisi par des paysans qui lui attachèrent sur le dos, par dérision, une botte de foin avec un bouquet de chardons. C'était une allusion à un propos atroce qu'avait tenu le misérable: «Ces gens-là, avait-il dit en parlant de ses vassaux, peuvent bien manger de l'herbe, puisque mes chevaux en mangent.» Il avait ajouté «qu'il ferait faucher la France».
Conduit en cet état à l'Hôtel de Ville de Paris, il fut confronté, interrogé. On trouva sur lui les morceaux d'une lettre qu'il avait déchirée avec ses dents. Pas une voix ne s'éleva pour le justifier, Bailly, La Fayette, les membres du Comité de l'Hôtel de Ville, tout le monde le jugeait très-coupable; et d'un autre côté ces honorables citoyens voulaient éviter l'effusion du sang. Il avait été décidé qu'au tomber de la nuit il serait transféré secrètement dans les prisons de l'Abbaye-Saint-Germain.
—Foulon! nous voulons Foulon! N'a-t-il pas lui-même signé sa sentence en passant pour mort?
Voilà ce que la foule, accrue d'instant en instant, ne cessait de crier sur la Grève. Au milieu de cette multitude hâve, affamée, il y avait des hommes qui avaient vu mourir une soeur, un enfant, une femme, d'épuisement et de misère: la nature les rendait féroces. Le malheureux entendait gronder à ses oreilles ce mugissement terrible d'un peuple justement irrité.
Le Comité de l'Hôtel de Ville insistait toujours, et avec raison, pour qu'il fût jugé. «Oui, oui, crie-t-on de toutes parts, jugé sur-le-champ et pendu!» Un simulacre de tribunal s'improvisa; il était composé de sept membres; mais quelle impartialité devait-on attendre de juges délibérant sous la pression de telles circonstances? La Fayette intervint: il était encore dans tout l'éclat de sa popularité.
—Je ne puis blâmer, dit-il, votre indignation contre cet homme. Je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours regardé comme un grand scélérat, et il n'est aucun supplice trop rigoureux pour lui…. Mais il a des complices; il faut que nous les connaissions. Je vais le faire conduire à l'Abbaye. Là nous instruirons son procès et il sera condamné à la mort infâme qu'il n'a que trop méritée.
Vains efforts! La foule grossissait toujours; l'impatience croissait; bientôt des murmures, ensuite les fureurs. C'est sans résultat que des citoyens, émus de pitié et voulant qu'on respectât les formes de la justice, traversent les groupes et représentent qu'il ne faut pas verser le sang.
—Le travail du peuple est du sang aussi, reprend cette multitude indignée, et le traître l'a bu; il s'est nourri, engraissé de la faim publique!
Des groupes nouveaux débordent du dehors; cette marée vivante pousse devant elle la foule qui emplissait la salle. Tous s'ébranlent, tous se portent avec l'impétuosité de l'océan vers le bureau et vers la chaise où Foulon était assis. La chaise est renversée.
—Qu'on le conduise en prison! commande La Fayette d'une voix qui cherchait encore à dominer la tempête.
Des mains implacables ont déjà saisi le malheureux qui demandait grâce; on lui fait traverser la place de l'Hôtel de Ville. Arrivé sous le réverbère qui se trouvait en face de l'édifice, il est attaché à une corde. La corde casse: «Qu'on en cherche une autre!» On recommence jusqu'à trois fois pour le hisser à ce gibet improvisé. Une bande de furieux met à prolonger les horreurs du supplice cette sorte d'obstination et d'acharnement qu'on déploie contre un fléau public. Ce qu'ils s'imaginaient pendre dans cet homme, c'était la famine.
Le même jour, Bertier, gendre de Foulon, intendant de Paris, arrivait de Compiègne par la porte Saint-Martin. Le peuple avait divers motifs de haine contre lui. Bertier passait pour avoir donné à Louis XVI le conseil de faire avancer les troupes sur Paris. C'était en outre un administrateur dur et hautain, un coeur de bronze. Il parut tout à coup entouré d'un rassemblement formidable, assis dans un cabriolet dont on avait brisé la capote, afin qu'il demeurât exposé à la vue de tous. Un électeur, Étienne de La Rivière, le protégeait au péril de sa vie contre l'indignation populaire. Des morceaux de pain noir tombaient dans la voiture.
—Tiens, criaient des voix étouffées par la colère, tiens, brigand! voilà le pain que tu nous as fait manger!
Il fut conduit à l'Hôtel de Ville, où Bailly l'interrogea. Sur l'avis du bureau, le maire dit:
—A l'Abbaye!
Il était plus facile de donner un pareil ordre que de le faire exécuter. Traîné sous la lanterne où l'on avait pendu Foulon, Bertier résiste, saisit un fusil et tombe percé de cent coups de baïonnette.
Quoiqu'un affreux souvenir s'attache à ces deux exécutions sommaires, il faut pourtant reconnaître que les auteurs de ces actes à jamais regrettables se montrèrent désintéressés. «Les meurtriers, dit Bailly, respectèrent la propriété et les effets de ceux à qui ils s'étaient permis d'ôter la vie. Tous ces effets, même les plus précieux, et l'argent, ont été rapportés.» [Note: Ce qui étonne est la froideur des écrivains du temps vis-à-vis de ces exécutions sommaires. Voici tout ce qu'elles inspirent à l'un d'entre eux: «En voyant ces restes dégoûtants, je me disais: Qui croirait que ces corps (ceux de Foulon et de Bertier), maintenant horribles, ont été tant de fois baignés, étuvés, embaumés, et que ce qui révolte la nature a si souvent prononcé des actes d'autorité, tant humilié d'honnêtes gens, et fait souffrir un si grand nombre de malheureux!»]
L'ancien régime n'a-t-il point d'ailleurs, dans ces massacres, sa part de responsabilité? N'est-ce point lui qui avait entretenu le peuple dans l'ignorance, mère de toutes les barbaries? La vue des supplices ordonnés par les juges du roi n'était-elle point bien faite pour endurcir le coeur des masses? Se souvient-on de Ravaillac et de tant d'autres, tenaillés en place de Grève, aux mamelles et aux gras des jambes, la main droite brûlée, les plaies injectées de plomb fondu, d'huile bouillante, de poix résine et de soufre, puis reconduits en prison, pansés et médicamentés, jusqu'au jour où leurs membres étant renouvelés de manière à endurer de nouvelles tortures, on les ramenait en Grève pour y être roués vifs ou tirés à quatre chevaux? Les douces moeurs que devaient inspirer au peuple de tels spectacles!
Détournons nos regards de ces scènes sanglantes et reportons-les sur la
France.
Il est un fait qu'il importe de bien établir, c'est que le bas clergé ne se montra point hostile à la Révolution naissante; des services furent célébrés dans les églises pour les citoyens morts au siége de la Bastille. L'abbé Fauchet leur prodigua les trésors de son éloquence. Il avait choisi pour texte de son sermon ces paroles de saint Paul: Vocati estis ad libertatem, fratres: «Frères, vous êtes tous appelés à la liberté.»
L'orateur faisant allusion à l'état général des esprits s'écriait du haut de la chaire: «C'est la philosophie qui a ressuscité la nation…. L'humanité était morte par la servitude; elle s'est ranimée par la pensée; elle a cherché en elle-même et elle y a trouvé la liberté. Elle a jeté le cri de la vérité dans l'univers; les tyrans ont tremblé; ils ont voulu resserrer les fers des peuples…. Ils auraient égorgé la moitié du genre humain, pour continuer d'écraser l'autre…. Les faux interprètes des divins oracles ont voulu, au nom du Ciel, faire ramper les peuples sous les volontés arbitraires des chefs. Ils ont consacré le despotisme; ils ont rendu Dieu complice des tyrans! Ces faux docteurs triomphaient, parce qu'il est écrit: Rendez à César ce qui appartient à César. Mais ce qui n'appartient pas à César, faut-il aussi le lui rendre? Or la liberté n'est point à César, elle est à la nature humaine.» Ce fier langage fut diversement apprécié; les princes des prêtres et les pharisiens modernes crièrent au scandale; mais un tel discours transporta d'enthousiasme tous ceux qui tenaient encore pour l'alliance du christianisme et de la Révolution. Une compagnie de garde nationale reconduisit l'abbé Fauchet jusqu'à sa sortie de l'église. On portait devant lui une couronne civique.
Prêtre janséniste et mystique, il avait embrassé de bonne foi et avec tout l'élan d'une imagination ardente le nouveau dogme de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Son tort, et il l'expia cruellement, fut de croire qu'on put allier deux ordres d'idées inconciliables.
L'influence de cette erreur propagée par quelques autres ecclésiastiques, tels que le curé de Saint-Étienne-du-Mont, fit reculer l'esprit public jusqu'aux formes les plus superstitieuses et les plus naïves. On mit la Révolution naissante sous la protection de sainte Geneviève; on la voua au blanc. Chaque jour, c'étaient des processions solennelles: le bataillon du quartier, avec de la musique, les femmes du marché, les jeunes filles, allaient porter des actions de grâces et un bouquet à la patronne de Paris. Au retour, elles se rendaient chez le maire.
«Tous les jours, raconte Bailly, j'avais des compliments et des brioches; j'étais bien fêté et bien baisé par toutes ces demoiselles.»
Les citoyens du district du faubourg Saint-Antoine se réunirent quand leur tour fut venu: à leur tête marchaient les jeunes vierges vêtues de blanc; tout le cortége allait faire bénir un modèle de la Bastille. Les vainqueurs entouraient fièrement ce simulacre d'une forteresse détruite par la main du peuple; quelques-uns portaient en trophée les drapeaux et les armes des vaincus. On ne doutait pas que ces dépouilles ne fussent agréables au dieu de la liberté.
Il est aujourd'hui permis de se demander si ces gages de sympathie donnés par le clergé de 89, au réveil d'un grand peuple, étaient bien sincères. Nous avons mille motifs pour en douter. Un contemporain, Rabaut-Saint-Étienne, ministre protestant, est d'ailleurs plus à même que tout autre de nous renseigner à cet égard. «Le clergé, dit-il, cherche encore, dans une religion de paix, des prétextes et des moyens de discorde et de guerre; il brouille les familles dans l'espoir de diviser l'État: tant il est difficile à ce genre d'hommes de savoir se passer de richesses et de pouvoir!»
Nous verrons d'ailleurs plus tard jusqu'où le bas clergé suivit la
Révolution Française et à quelle borne il s'arrêta.