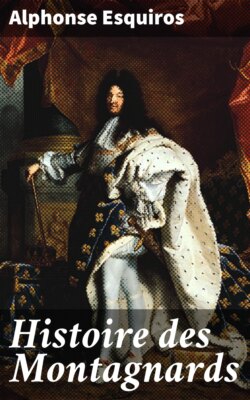Читать книгу Histoire des Montagnards - Alphonse Esquiros - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеTable des matières
Adoucissement des moeurs.—Le journalisme.—Marat et Camille Desmoulins.—Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.—La prérogative royale et le véto.—Système des deux Chambres.—Obstacles que rencontrait le travail de la Constitution.—Brissot et Danton.
O Révolution! comment ont-ils pu te couvrir du masque de la haine, toi dont le premier battement de coeur fut pour l'humanité tout entière? Non, tes ennemis ont beau dire, tu n'as point la première tiré le glaive du fourreau. Tu as commencé par éclairer le monde, par lui donner le baiser de paix; mais le monde ne t'a point connue. Les maîtres du passé se sont cachés dans leur ombre, pour ne point voir la lumière de tes bienfaits; ils ont voulu te mettre à mort, parce que ta clarté importune révélait leurs actions mauvaises. Qu'ils soient éclairés à leur tour, et toi, Révolution, sois saluée par la reconnaissance de toutes les nations de la terre.
La Révolution avait en quelques mois renouvelé le caractère français, adouci les moeurs. Un criminel devait être exécuté à Versailles: déjà la roue était disposée; pâle, consterné, défait, le misérable était déjà étendu sur l'échafaud, lorsque des cris de: Grâce! Grâce! s'élèvent de toutes parts: voilà l'homme sauvé. On chercherait à tort une contradiction entre cette démence du peuple et les actes de cruauté qui venaient de répandre l'effroi dans Paris. On appelait alors de telles voies de fait des exemples, des justices armées qui passent, comme la foudre, sans même laisser après elles la trace du sang.
De l'agitation prodigieuse des esprits, tournés vers les affaires publiques, un nouveau pouvoir venait de sortir, le journalisme. Deux hommes s'y faisaient surtout remarquer, l'un par l'excentricité de son talent, l'autre de son caractère, c'étaient Camille Desmoulins et Marat.
Camille, nature flottante, mais qui s'appartient dans sa mobilité même, un peu femme, mais surtout homme du peuple. Écrivain, il manie comme admirablement l'arme à deux tranchants du sarcasme! Je vois errer sur ses lèvres ondoyantes le rire d'une nation qui a souffert; son arbre nerveux frissonne à tous les vents, vibre à toutes les émotions. Trop d'esprit, pas assez de tête.
«Mon cher Camille, lui écrivait l'Ami du peuple, vous êtes encore bien neuf en politique. Peut-être cette aimable gaieté, qui fait le fond de votre caractère, et qui perce sous votre plume dans les sujets les plus graves, s'oppose-t-elle au sérieux de la réflexion. Je le dis à regret, combien vous serviriez mieux la patrie si votre marche était ferme et soutenue; mais vous vacillez dans vos jugements; vous blâmez aujourd'hui ce que vous approuverez demain; vous paraissez n'avoir ni plan ni but.»
Cette légèreté faisait à la fois le charme et le principal défaut de
Camille, l'enfant gâté de la Révolution:—elle le perdit.
Né de parents obscurs, Marat avait apporté en venant au monde, dans ses membres faibles et maladifs, des souffrances invétérées. Voyageur, il n'avait rencontré, le long de son chemin, qu'esclaves fouettés de verges, que pauvres servant à essuyer les pieds des riches, que nations pressurées selon le bon plaisir d'un seul, comme la grappe sous la vis du pressoir. Plongé au fond de l'Océan amer, sa nature molle et absorbante s'emplit des misères du peuple comme l'éponge de la bourbe de l'eau. Son premier discours aux hommes fut un cri de douleur. Plus tard, il secoua de ses mains crispées et rebelles les haillons de l'indigent, pour en chasser la poussière sur le front des privilégiés; médecin, il revêtit la chemise mouillée de sueur froide et tâchée de sang. Le journal et l'homme ne faisaient qu'un: dans l'Ami du peuple, l'exagération du sentiment de la justice va quelquefois jusqu'à la fureur. Un homme se portait-il à des violences contre son semblable plus faible que lui, Marat eût tout donné pour punir de mort ce lâche agresseur. Bonne ou mauvaise, sa feuille était nécessaire: sans elle, quelque chose aurait manqué à la Révolution, et si le rédacteur de l'Ami du peuple n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Il fallait à la crise sociale ce phénomène nerveux. Inégal, emporté, lui seul avait la conscience de sa logique. [Note: On retrouva, en fouillant dans les papiers du comte d'Artois, une lettre écrite en 1763, et adressée à un Anglais: «Si la nation française, y dirait-on, est avilie, c'est par le défunt d'autrui; souvenez-vous, mylord, qu'elle ne sera pas vile dans vingt ans.»—Qui avait écrit cette lettre? Jean-Jacques Rousseau.]
«La chaleur de son coeur, écrivait-il en parlant de lui-même, lui donne l'air de l'emportement; l'impossibilité où il est presque toujours de développer ses idées et les motifs de sa démarche l'a fait passer, auprès des hommes qui ne raisonnent pas, pour une tête ardente; il le sait: mais les lecteurs judicieux et pénétrants qui le suivent dans ses bonds savent bien qu'il a une tête très-froide. La crainte extrême qu'il a de laisser échapper un seul piége tendu contre la liberté le réduit toujours à la nécessité d'embrasser une multitude d'objets, et à les indiquer plutôt que de les faire voir.»
Après la prise de la Bastille, après la nuit du 4 août, d'où pouvaient donc venir les alarmes des écrivains populaires? Le voici: le 14 juillet avait été le triomphe de la classe moyenne; la Constituante était son assemblée, la garde nationale sa force armée, la mairie son pouvoir actif; il y avait en un mot une infusion de sang nouveau dans les veines du gouvernement du pays; mais il n'y avait pas de peuple souverain. Les ombrageux voyaient dans les institutions naissantes le germe d'une aristocratie qui voulait se substituer à l'ancienne noblesse. Qu'avait gagné le peuple à la Révolution du 14 juillet? Le travail, déjà languissant, venait de tomber tout à coup; les principaux consommateurs étant passés à l'étranger, le commerce se trouvait frappé de stupeur. On lit continuellement, dans les feuilles du temps, ces paroles navrantes: «Il a été aujourd'hui très-difficile de se procurer du pain.» Au milieu de cette crise universelle, quelques corps d'état s'agitèrent; la garde nationale, d'accord avec la municipalité, dissipa leurs mouvements par la force. Des patrouilles bourgeoises, enflées par un premier succès, voulurent mettre la police dans le jardin du Palais-Royal. Ces mesures d'ordre rencontrèrent des résistances, soulevèrent des murmures. Les feuilles démocratiques rendirent Lafayette et Bailly responsables des voies de fait qui avaient été commises envers les citoyens. On crût voir dans les attaques de la classe moyenne l'exercice d'un nouveau pouvoir qui s'essayait à la domination. Le froid et doux Bailly n'avait à coup sûr rien d'un tyran; la pauvre tête de Lafayette fléchissait déjà sous son laurier; mais leur autorité n'en éveilla pas moins des défiances parmi les sentinelles avancées de l'opinion publique.
L'Assemblée nationale discutait, pendant ce temps, la Déclaration des droits. C'était le fondement de toute la Constitution. L'abbé Grégoire voulait qu'on plaçât en tête le nom de la Divinité. «L'homme, disait-il, n'a pas été jeté au hasard sur le coin de terre qu'il occupe, et s'il a des droits, il faut parler de celui dont il les tient.» Il demandait aussi une déclaration des devoirs: «On vous propose de mettre en tête de votre Constitution une déclaration des droits de l'homme: un pareil ouvrage est digne de vous; mais il serait imparfait si cette déclaration des droits n'était pas aussi celle des devoirs. Il faut montrer à l'homme le cercle qu'il peut parcourir et les barrières qui doivent l'arrêter.»
En parlant ainsi, le curé d'Emberménil était sans doute d'accord avec son caractère et avec ses convictions; mais ne poursuivait-il point une chimère? Nous avons déjà dit ce qui manquait à l'esprit religieux pour réveiller chez l'homme le sentiment de l'indépendance.
«Le plaisir d'être libre, déclare Bossuet, quand il s'attache à nous-mêmes, étant un fruit de notre amour-propre, le chrétien doit craindre de s'abandonner à cette douceur trop sensible.»
La théologie avait fait de l'homme un être dépendant; masquant partout les droits, elle ne lui parlait que de ses devoirs. Il fallait donc reprendre les choses par un autre côté. La philosophie, s'appuyant sur la nature, déclarait, au contraire, l'homme un être doué de forces imprescriptibles: être, c'est pouvoir. De la notion des forces sortit celle des droits. La Révolution Française consacra tout le travail de l'esprit humain au XVIIIe siècle; elle fut le triomphe de la philosophie sur le mysticisme, des idées sur les croyances, de l'avenir sur le passé. [Note: Le voeu de l'abbé Grégoire fut néanmoins réalisé en partie. «L'Assemblée nationale, dit le préambule de la Déclaration, reconnaît et déclare, en présence de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.»]
Une autre question divisait l'Assemblée: il s'agissait de limiter les pouvoirs, jusque-là mal définis, de la représentation nationale et ceux de la couronne. Le parti monarchique voulait que le roi put opposer son véto aux décrets de l'Assemblée qui n'auraient point son assentiment: c'était simplement le droit de suspendre l'exercice de la puissance législative. Les deux souverains se trouvaient en présence, je veux dire le roi et la nation. Entre les deux, l'opinion publique n'hésitait pas: elle se disait que la volonté d'un seul ne peut pas balancer celle de vingt-quatre millions d'hommes. C'était la doctrine du Contrat social qui s'élevait fière, menaçante, contre les envahissements du trône constitutionnel: Jean-Jacques, du fond de sa tombe, présidait aux débats.
Le véto était évidemment l'arme du despotisme. Aussi une lutte violente éclata dans l'Assemblée. D'un côté étaient ceux qui espéraient regagner par le roi ce qu'ils avaient perdu par la victoire du peuple. De l'autre se rangeaient les ennemis déclarés de l'arbitraire. La Constituante se déchira en deux camps, et cette scission passa dans tout le royaume.
Une autre question divisait les esprits: l'Assemblée nationale resterait-elle une et indivisible, ou aurait-on deux Chambres? Le haut clergé et une partie de la noblesse tenaient pour ce dernier système. Les uns réclamaient un Sénat à vie, les autres un Sénat à temps, tiré de la Constituante elle-même. Enfin l'Assemblée décréta, à la majorité de neuf cents voix contre quatre vingt-dix-neuf, qu'il n'y aurait qu'une seule Chambre. Elle statua, en outre, que le Corps législatif se renouvellerait tous les deux ans par de nouvelles élections.
De pareilles discussions n'étaient point de nature à calmer l'opinion publique. L'inquiétude et la défiance persistaient malgré les assurances pacifiques du roi. A Paris, la fermentation augmentait chaque jour en raison même des moyens employés pour rétablir l'ordre. La garde nationale montrait trop de zèle. Ce déploiement de forces irritait les citoyens désarmés; ces patrouilles de nuit, ces mesures inutiles prises contre l'émeute absente, blessaient les susceptibilités des esprits ombrageux. «Quand je rentre à onze heures du soir, écrivait Camille Desmoulins, on me crie: Qui vive?—Monsieur, dis-je à la sentinelle, laissez passer un patriote picard. Mais il me demande si je suis Français, en appuyant la pointe de sa baïonnette. Malheur aux muets! Prenez le pavé à gauche! me crie une sentinelle; plus loin, une autre crie: Prenez le pavé à droite! Et, dans la rue Sainte-Marguerite, deux sentinelles crient: Le pavé à droite! le pavé à gauche! J'ai été obligé, de par le district, de prendre le ruisseau.» Les noms de Lafayette et de Bailly se trouvaient mêlés aux soupçons du mécontentement public. Les écrivains du parti démocratique demandaient à la nation si elle avait détruit les priviléges de la noblesse pour leur substituer les priviléges de la bourgeoisie. «Le droit d'avoir un fusil et une baïonnette, ajoutait le sémillant Camille, appartient à tout le monde.»
D'un autre côté, la famine sévissait toujours: la porte des boulangers était assiégée du matin au soir. Dans plusieurs quartiers de Paris, on faisait des distributions de riz pour suppléer au pain qui manquait. L'Assemblée nationale, sur laquelle la multitude s'était reposée, n'avait point amélioré l'état des subsistances. «Le Corps législatif, écrivait Marat dans sa feuille, ne s'est occupé qu'à détruire, sans réfléchir combien il était indispensable de construire le nouvel édifice avant de démolir l'ancien. Abolir était chose aisée: mais aujourd'hui que le peuple ne veut payer aucun impôt qu'il ne connaisse son sort, comment les remplacer? Et comment, dans ces jours d'anarchie, pourvoir aux besoins pressants des vrais ministres de la religion? Comment soutenir le poids des charges publiques? Comment faire face aux dépenses de l'État? Un autre inconvénient est d'avoir négligé le soin des choses les plus urgentes: le manque de pain, l'indiscipline et la désertion des troupes, désordres portés à un tel degré que, sous peu, nous n'aurons plus d'armée, et que le peuple est à la veille de mourir de faim.» Ces réflexions très-sages étaient semées par toute la France. L'Assemblée nationale, au milieu de ses embarras, montrait aux citoyens la mauvaise humeur de l'impuissance irritée. La grande voix de Mirabeau s'était-elle donc endormie? Le bruit courait déjà que cet homme débauché était à la veille de vendre l'orateur. Des citoyens disaient tout haut dans les groupes: «Il faut un second accès de révolution.» Le corps politique était malade de la division des volontés; il ne pouvait sortir de là que par une crise.
Quelques accapareurs de l'ancien régime, furieux de voir la France leur échapper, ne cessaient de faire sur la misère publique des spéculations honteuses: ils espéraient prendre la Révolution par la famine. Les accaparements, les manoeuvres de l'industrie usuraire, désolaient la population aux abois. «Quoi! s'écriait Desmoulins, en vain le ciel aura versé ses bénédictions sur nos fertiles contrées! Quoi! lorsqu'une seule récolte suffit à nourrir la France pendant trois ans, en vain l'abondance de six moissons consécutives aura écarté la faim de la chaumière du pauvre; il y aura des hommes qui se feront un trafic d'imiter la colère céleste! Nous retrouverons au milieu de nous, et dans un de nos semblables, une famine, un fléau vivant.»
A côté du mal était le bien. La détresse générale ouvrait les coeurs à des actes continuels de désintéressement. Les citoyens venaient en aide à l'État, cet être de raison auquel la Révolution de 89 a véritablement donné naissance. Les dons patriotiques pleuvaient de tous les coins de la France sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Les femmes détachaient leurs colliers pour en orner le sein de la patrie nue.—La noblesse avait abdiqué; maintenant, c'était le tour de la coquetterie. Parmi ces présents, il y avait quelquefois le denier de la veuve, plus souvent encore les parures de la courtisane. L'une d'elles envoya ses bijoux avec cette lettre:
«Messeigneurs, j'ai un coeur pour aimer; j'ai amassé quelque chose en aimant: j'en fais, entre vos mains, l'hommage à la patrie. Puisse mon exemple être imité par mes compagnes de tous les rangs.»
L'esprit de la Révolution avait touché ces nouvelles Madeleines: émues, elles venaient répandre à l'envi les parfums de la charité sur la tête du peuple.
Deux des principaux acteurs de la Révolution, quoique dans des rôles bien différents, commençaient dès lors à se dégager de l'obscurité de la foule: l'un était Brissot, l'autre Danton.
Dans les temps de révolution, toute déclaration imprudente s'attache, si l'on ose ainsi dire, à la chair et aux os de l'homme d'État. C'est pour lui la robe de Nessus. Brissot, rédacteur du Patriote français, venait de communiquer aux commissaires de l'Hôtel de Ville un plan de municipalité, avec un préambule dans lequel on remarquait le passage suivant:
«Les principes sur lesquels doivent être appuyées ces administrations municipales et provinciales, ainsi que leurs règlements, doivent être entièrement conformes aux principes de la constitution nationale. Cette conformité est le lien fédéral qui unit toutes les parties d'un vaste empire.»
Pourquoi l'autour a-t-il souligné lui-même le mot fédéral?—Nous nous souviendrons de ce fait, quand Brissot sera devenu le chef du parti de la Gironde.
Danton, lui, naquit à Arcis-sur-Aube le 26 octobre 1759. Son père était procureur au bailliage de la ville. La plupart des révolutionnaires sortaient des mains du clergé: le futur Conventionnel fit ses études chez les Oratoriens. On ne sait presque rien de son enfance, très-peu de sa jeunesse, sinon qu'il exerçait la profession d'avocat. En 1787, il se maria et, avec la dot de sa femme, acheta une charge aux conseils du roi.
«Avocat sans cause,» dit madame Roland. Pourquoi pas? Son genre d'éloquence n'était guère fait pour plaider en faveur du mur mitoyen. A ce fougueux orateur, il fallait la tribune ou la place publique. Lors des élections aux États généraux de 89, il avait été choisi comme président par l'un des soixante districts de Paris. Ce district était celui des Cordeliers qui faisait trembler les modérés. Danton était déjà, dans son quartier, l'âme des hommes d'action. Tout en lui respirait la force et l'audace: une crinière de lion, une large face ravagée par la petite vérole, des épaules d'Atlas;—il est vrai qu'il portait un monde!