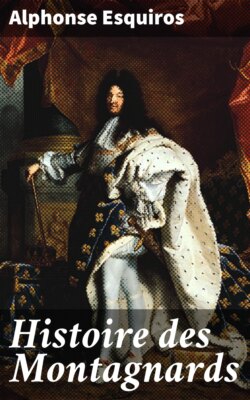Читать книгу Histoire des Montagnards - Alphonse Esquiros - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
La séance royale—Paroles de Mirabeau—Necker—Troubles à
Paris—Conduite des députes—Pris de la Bastille.
Le lendemain (2l juin 1789) était un dimanche; on respecta le jour du repos. Le lundi, l'Assemblée n'avait point encore trouvé où s'abriter; la salle du Jeu-de-Paume ne convenait nullement comme lieu de réunion: ni siéges, ni banquettes. Le comte d'Artois l'avait d'ailleurs fait retenir pour son agrément. Le tiers tint séance dans l'église Saint-Louis.
L'Assemblée des communes ne cessait de sommer le clergé, au nom du Dieu de paix, de se réunir à elle. La noblesse était surtout attachée à ses titres, le clergé à ses intérêts; mais il y a tels moments où la force des doctrines désarme l'amour-propre des plus obstinés. L'abbé Grégoire, ce généreux transfuge, qui avait assisté la veille à la fameuse séance du Jeu-de-Paume, rejoignit son ordre dans l'intention de la ramener. Vers une heure, la majorité du clergé, l'archevêque de Bordeaux en tête, fut introduite dans le choeur. La joie et les applaudissements éclatèrent; lorsque l'on prononça le nom de l'abbé Grégoire, l'air retentît d'acclamations universelles. L'Assemblée fit entendre, par la bouche de son président, des paroles d'union. Bailly exprima en ces termes le regret de ne pas voir la noblesse siéger avec les communes et avec le clergé: «Des frères d'un autre ordre manquent à cette auguste famille.» Comment pouvait-on supposer des passions haineuses et subversives chez des hommes qui tenaient un langage si conforme à l'esprit évangélique? L'Assemblée augmentait ses forces par la lutte et les délais; la cour épuisait les siennes. C'est la seule fois peut-être que l'inaction fut mise au service du progrès. Quelques semaines auparavant, le clergé avait voulu forcer cette inaction salutaire, en proposant à l'Assemblée de s'occuper de la misère publique et de la cherté des grains. Cette démarche n'était qu'un piége; l'Assemblée ne s'y trompa pas, et elle eut le courage d'y résister. Le clergé croyait le peuple disposé à vendre son droit d'hommes libres pour un morceau de pain; il se trompait. Les grandes conquêtes morales ne s'achètent que par le sacrifice; la France de la Révolution préférait encore à la nourriture matérielle le pain de la parole qui fait les justes, et le pain de la liberté qui fait les forts.—Le 9, l'Assemblée avait d'ailleurs institué un Comité de subsistances.
La séance royale eut enfin lieu le 23 juin. On commença par humilier les communes. Quelle est cette procession d'hommes noirs qui attendent dehors, sous une pluie battante, l'ouverture de la salle?—Annoncez la nation!
Le despotisme, banni depuis quelques mois des affaires du pays, reparut tout à coup sous des formes si odieuses, que les plus modérés furent contraints d'ouvrir les yeux. Le roi tint un langage sévère, inconvenant: il menaça les députés, et leur fit entendre qu'il se passerait de leur concours, s'il rencontrait chez eux une résistance inébranlable. Il cassa les arrêtés de l'Assemblée, qu'il ne reconnut que comme l'ordre du tiers; les libertés que la représentation nationale s'était données depuis un mois se trouvaient violemment reprises, confisquées. «Le roi veut, était-il dit, que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit conservée en entier, comme essentiellement liée à la constitution du royaume.» Ces déclarations furent accueillies comme elles devaient l'être, par le silence. Dans les temps de révolution, l'ombre du passé marche à côté du présent; elle le dépasse même quelquefois, mais c'est pour s'évanouir. «Je vous ordonne, messieurs, avait dit le roi en finissant, de vous séparer tout de suite.» Presque tous les évêques, quelques curés et une grande partie de la noblesse obéirent; les députés du peuple, mornes, déconcertés, frémissant d'indignation, restèrent à leur place. Ils se regardaient, cherchant, dans ce moment-là, non une résolution, mais une bouche pour la dire. Mirabeau se lève: «Messieurs, s'écrie-t-il, j'avoue que ce que vous venez d'entendre pourrait être le salut de la patrie, si les présents du despotisme n'étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature? l'appareil des armes, la violation du temple national, pour vous commander d'être heureux! Qui vous fait ce commandement? votre mandataire! Qui vous donne des lois impérieuses? votre mandataire, qui doit les recevoir de nous, messieurs, qui sommes revêtus d'un caractère politique et inviolable; de nous, enfin, de qui vingt-cinq millions d'hommes attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté des voix délibératives est enchaînée: une force militaire environne les États! Où sont les ennemis de la nation? Catilina est-il à nos portes? Je demande qu'en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment: il ne nous permet de nous séparer qu'après avoir fait la constitution.» Alors le grand-maître des cérémonies, petit manteau, frisure à l'oiseau royal, surmonté d'un chapeau absurde, s'avançant vers le bureau, prononce quelques mots d'une voix basse et mal assurée: Plus haut! lui crie-t-on. «Messieurs, dit alors M. de Brézé, vous avez entendu les ordres du roi.» Bailly allait discuter; mais Mirabeau: «Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes!» Il accompagna ces paroles d'un geste de majesté terrible. Brézé voulut répliquer; il balbutia, perdit contenance et sortit. «Vous êtes aujourd'hui, ajouta Sieyès avec calme, ce que vous étiez hier; délibérons…» Mirabeau, pour couronner la séance, propose aux députés de déclarer infâme et traître envers la nation quiconque prêterait les mains à des attentats ordonnés contre eux. Par cet arrêté, l'Assemblée élevait une barrière morale entre l'arbitraire des ministres et sa sûreté personnelle. L'inviolabilité, ce caractère essentiel du souverain, passait aux élus de la nation.
Necker n'assistait point à la séance royale. Cette absence le rendit populaire. La nouvelle d'une disgrâce, encourue par ce ministre, augmenta le trouble des esprits. Il y eut émeute à Versailles. L'apparition de bandes armées jetait la terreur dans les provinces. Des hommes qui semblaient sortir de terre et y rentrer, tant leurs traces se perdaient dans les ténèbres, saccageaient les blés verts. La cour se montrait toujours prête à agir; mais la difficulté de déterminer le roi était extrême. La noblesse, abandonnée du clergé, résistait seule et refusait encore de se réunir au tiers. Son attachement à ce qu'elle appelait ses droits était fortifié chez elle par le sentiment de l'hérédité qui n'existait pas dans l'Église. Le 25, une minorité de la noblesse vint prendre siége dans l'Assemblée. Le 27, le roi écrivit lui-même aux Ordres, les invitant à ne point se séparer du noyau qui s'était formé dans la grande salle des séances. On assure que la veille Louis XVI avait fait appeler le duc de Luxembourg, président des députés de la noblesse. Celui-ci déroula aux yeux du roi un plan de défense. Le roi, frappé de l'incertitude du succès, aurait répondu: «Non, je ne souffrirai pas qu'un seul homme périsse pour ma querelle.» Ce mot, s'il est vrai, montre l'état d'isolement où la couronne s'était placée. Les intrigues de la reine et de sa cour n'avaient réussi qu'à mettre le souverain à la tête d'un parti. La noblesse ne se soumit à l'invitation du roi qu'avec une répugnance extrême. Quelques gentilshommes affectaient de dire tout haut qu'il fallait préférer la monarchie au monarque. La réunion s'opéra néanmoins; à chaque membre de l'aristocratie qui allait se confondre, sur les banquettes, avec le reste de l'Assemblée, l'ancien régime s'évanouissait comme un fantôme.
Les craintes, les soupçons, les alarmes n'en continuaient pas moins d'augmenter à la vue des préparatifs de guerre civile qui frappaient les plus confiants dans la loyauté de Louis XVI. La royauté songeait-elle à se défendre? Tout l'indique et pourtant elle n'était pas encore attaquée; ce fut là son erreur et l'une des causes de sa perte. L'Assemblée en masse était alors royaliste. L'historien distingue bien ça et là, dans les profondeurs de la salle, des acteurs qui joueront tout à l'heure un autre rôle: pour les contemporains, cet avenir était voilé. La Montagne était en formation dans l'Assemblée nationale, mais c'était une formation latente. Que font là-bas ces trente voix muettes qui parleront si haut dans la suite? Leur heure n'est pas encore venue. Pour les partis comme pour les hommes prophétiques, il faut la préparation du silence. Alors les membres des communes se croyaient d'accord, parce qu'ils attaquaient ensemble les abus de l'ancienne société. Les dissentiments devaient sortir de la victoire. En attendant, contentons-nous de résumer la situation présente. A peine les États généraux furent-ils constitués, qu'il se déclara tout de suite trois pouvoirs en France: la cour, qui voulait empêcher la Révolution de s'organiser;—l'Assemblée, qui marchait dans la voie des réformes avec cette lenteur prudente qu'exige la dignité représentative;—l'opinion, qui, maîtresse d'elle-même, était toujours contre la cour et en avant de l'Assemblée. Ces trois pouvoirs avaient chacun leur siége: la cour tenait son quartier général au palais de Versailles; l'Assemblée rayonnait en dehors des murs du château; l'opinion trônait à Paris.
Necker, enivré des suites de cette séance royale, où son absence avait obtenu tant de succès, faisait courir la nouvelle de sa retraite. La cour s'était en effet tournée contre lui; chassé, puis rappelé, il montrait une hésitation factice à reprendre les rênes embarrassées du gouvernement.
—Nous vous aiderons, s'écria Target se donnant le droit de parler au nom de tous, et pour cela même il n'est point d'efforts, de sacrifices que nous ne soyons prêts à faire.
—Monsieur, lui dit Mirabeau avec le masque de la franchise, je ne vous aime point, mais je me prosterne devant la vertu.
—Restez, monsieur Necker, s'écria la foule, restez, nous vous en conjurons.
—Parlez pour moi, monsieur Target, dit le ministre sensiblement ému, car je ne puis parler moi-même.
—Hé bien, messieurs, je reste! s'écria alors Target; c'est la réponse de M. Necker.
Il resta.
Le peuple de Versailles était très-loin d'aimer l'ancien régime monarchique, il l'avait vu de trop près pour cela. Malgré quelques témoignages de reconnaissance donnés au roi, à la reine même, pour le maintien du ministre, tout rentra dans une opposition taciturne. Chaque jour les frayeurs augmentaient avec l'arrivée continuelle des troupes. Une armée pesait sur l'Assemblée naissante. Celle-ci, de son côté, était réduite à l'impuissance. Elle ne pouvait sortir de cet état critique sans l'intervention de la force.—Paris se leva.
Les mouvements commencèrent le 30. Le peuple est femme, plebs.—Accessible aux émotions, son premier acte est presque toujours dirigé par le coeur. Cette révolution, qu'on accuse d'avoir peuplé les cachots, commença par en ouvrir les portes. Onze soldats du régiment des gardes-françaises étaient détenus à la prison de l'Abbaye, comme faisant partie d'une société secrète dont les membres avaient juré d'épargner le sang de leurs concitoyens. Ils devaient être transférés, la nuit même, à Bicêtre, ainsi que de vils scélérats. On court à l'Abbaye, on les délivre. Quelques autres prisonniers militaires sont mis en liberté. On distinguait parmi eux un vieux soldat qui, depuis plusieurs années, était renfermé à l'Abbaye. Ce malheureux avait les jambes extrêmement enflées et ne pouvait que se traîner. On le mit sur un brancard et des bourgeois le portèrent. Accoutumé depuis un grand nombre d'années à n'éprouver que les rigueurs des hommes:—Ah! messieurs, s'écria le vieillard, je mourrai de tant de bontés!
Il y eut, dès ce moment, les soldats de la patrie (les gardes-françaises) et les soldats du roi,—qui étaient pour la plupart étrangers.
Le lendemain, une députation de jeunes gens se rendit à Versailles pour réclamer l'intercession de l'Assemblée nationale en faveur des braves qu'on venait de soustraire à la brutalité de leurs chefs. Cette démarche était alors contraire à tous les usages de la monarchie. C'était la première fois que des citoyens, dépourvus de tout caractère public, prenaient sur eux-mêmes l'initiative et la responsabilité d'une pareille démarche. Il y eut des murmures. On promit néanmoins d'invoquer la clémence du roi. [Note: Les gardes-françaises obtinrent en effet leur grâce du roi, après s'être reconstitués d'eux-même prisonniers.] La situation de l'Assemblée était difficile, placée qu'elle était entre une cour factieuse et un peuple à la veille de se révolter.
La contagion des idées nouvelles avait gagné l'armée. La cour ne pouvait plus compter que sur les régiments suisses, allemands; triste et singulier spectacle que celui du Champ-de-Mars occupé par une milice étrangère! Paris était remué d'un souffle inconnu. Les royalistes consternés, stupéfaits, ne comprenant rien à ce soulèvement des grandes eaux populaires, se livraient à mille terreurs chimériques; les uns accusaient le duc d'Orléans, les autres Mirabeau; leurs imaginations malades voyaient partout des complots ourdis contre leurs priviléges. En fait de complots, il n'y en avait qu'un seul: la nation tout entière conspirait au grand jour contre un régime décrépit et abhorré.
A Paris, la disette croissait toujours. La présence des troupes augmentait encore la rareté des subsistances. On s'arrachait avec une sorte de rage, à la porte des boulangers, un morceau de pain noir, amer, terreux. Des rixes fréquentes éclataient entre les marchands et la population affamée. Les ateliers étaient déserts.
Le 6 juillet, l'assemblée des électeurs de Paris se réunit à l'Hôtel de Ville. La situation devenait de plus en plus menaçante. Trente-cinq mille hommes étaient échelonnés entre Paris et Versailles. On en attendait, disait-on, vingt autres mille. Des trains d'artillerie les suivaient. Le maréchal de Broglie venait d'être nommé commandant de l'armée réunie sous les murs de la ville. Les ordres secrets, des contre-ordres précipités, jetaient l'alarme dans tous les coeurs.
Il se préparait visiblement une attaque à main armée contre les citoyens. La stérilité avait déjà désolé la terre des campagnes; maintenant c'était la guerre qui allait promener la faux sur nos villes. La main qui semait tous ces maux était connue. «Je demande, disait l'abbé Grégoire, qu'on dévoile, dès que la prudence le permettra, les auteurs de ces détestables manoeuvres, qu'on les dénonce à la nation comme coupables de lèse-majesté nationale, afin que l'exécration contemporaine devance l'exécration de la postérité.» On nommait ouvertement la reine, le comte d'Artois, le prince de Condé, le baron de Bezenval, le prince de Lambesc. A l'exemple de cet insensé despote qui faisait fouetter la mer, la cour voulait châtier la Révolution.
Paris était dans la plus grande fermentation; un écrit avait paru qui cherchait à calmer les esprits et à les armer de patience. «Citoyens, s'écriait l'auteur, les ministres, les aristocrates soufflent la sédition; vous déconcerterez leurs perfides manoeuvres. Soyez paisibles, tranquilles, soumis au bon ordre, et vous vous jouerez de leur horrible fureur. Si vous ne troublez pas cette précieuse harmonie qui règne à l'Assemblée nationale, la Révolution la plus salutaire, la plus importante se consomme irrévocablement, sans qu'il en coûte ni sang à la nation, ni larmes à l'humanité.» Cet écrit, plein de modération, sortait des mains d'un homme qui n'avait encore soulevé de bruit que par ses livres de science, Marat.
La Révolution, faite sans une goutte de sang, était le rêve de toutes les âmes généreuses; mais au point où en étaient arrivées les animosités de la cour et celles de la ville, un conflit devenait inévitable. Du 11 au 12, le bruit court que les brigands (lisez le peuple) viennent de mettre le feu aux barrières de la Chaussée-d'Antin. Des ouvriers, que la cherté des vivres réduisait au désespoir, croyaient abolir ainsi les droits d'entrée. Des gardes-françaises, envoyés pour repousser les assaillants, restèrent tranquilles spectateurs du désordre. Le moyen de tirer sur des hommes qui, réduits à lutter depuis longtemps contre les horreurs de la faim, n'étaient plus que des cadavres vivants!
La cour n'abandonnait pas ses projets sinistres. Des régiments suisses et des détachements du Royal-Dragon campaient au Champ-de-Mars avec de l'artillerie! Provence et Vintimille occupaient Meudon; Royal-Cravate tenait Sèvres. Ainsi serré, Paris ne bougerait pas. On espérait alors profiter de son inaction pour casser les États généraux. Les membres de l'Assemblée, enlevés pendant la nuit, devaient être dispersés dans le royaume. Les plus mutins paieraient pour les autres. Une liste de proscription était arrêtée dans le comité de la reine. Soixante-neuf députés, à la tête desquels figuraient Mirabeau, Siéyès, Bailly, Camus, Barnave, Target et Chapellier, devaient être renfermés dans la citadelle de Metz, puis exécutés comme coupables de rébellion. [Note: On trouva plus tard dans le cabinet du stathouder le texte d'une espèce de jugement contre les députés récalcitrants que la cour avait décidé de pendre, de rouer et d'écarteler; ce sont les termes mêmes de la sentence.]
Le signal convenu pour cette Saint-Barthélemy des représentants de la nation était le changement de ministère. Un événement ne tarda point à justifier ces bruits et à prouver qu'ils n'étaient pas dépourvus de fondement. Necker allait se mettre à table, quand il reçut l'ordre de quitter le royaume; il lut la lettre du roi et dîna comme à l'ordinaire; après dîner, sans même avertir sa famille, il monta dans sa voiture et gagna la route de Flandre. L'Assemblée se trouvait tout à fait découverte par la retraite du ministre constitutionnel. Assise au milieu d'un camp, elle délibérait sous les baïonnettes. Un mouvement de plus, et la représentation allait périr. La nouvelle du renvoi de Necker arriva le 12 à Paris.
Le Palais-Royal était rempli d'une foule agitée. D'abord un triste et long murmure, bientôt une rumeur plus redoutable s'y fit entendre.
—Qu'y a-t-il donc?
—Et que voulez-vous qu'il y ait de plus? M. Necker est exilé.
Le peuple est comme les femmes, il faut toujours qu'il aime quelqu'un; Necker, le favori du moment, avait aux yeux de tous le mérite très-réel de sa disgrâce. L'opinion depuis quelques jours grondait; la fatale nouvelle mit le feu au volcan.
En ce moment, il était midi, le canon du palais vint à tonner. La foule était tellement préparée aux événements extraordinaires que ce bruit pénétra toutes les âmes d'un sombre sentiment de terreur. Un jeune homme, Camille Desmoulins, monte sur une table. L'héroïsme de la liberté est peint sur son visage. Les cheveux au vent, la tête à demi renversée, les yeux pleins d'une sainte indignation: «Citoyens, s'écrie-t-il, nous allons tous être égorgés, si nous ne courons aux armes!» A ces mots, il agite une épée nue et montre un pistolet. «Aux armes!» répète avec transport toute cette multitude entraînée. Il fallait un signe de ralliement. L'orateur attache une feuille verte à son chapeau. Tout le monde l'imite. En un moment, les marronniers du jardin sont dépouillés. Voilà le peuple debout!
On envoie des ordres pour fermer les spectacles, les salles de danse. En même temps, un groupe de citoyens se rend chez Curtius qui tenait un cabinet de figures en cire. On enlève les bustes de Necker et du duc d'Orléans, qu'on disait également frappé d'un ordre d'exil. On les couvre d'un crêpe noir en signe d'affliction publique, et on les porte dans les rues au milieu d'un nombreux cortége d'hommes armés de bâtons, d'épées, de pistolets ou de haches. Cette sorte de procession tumultueuse traverse les rues Saint-Martin, Grenétat, Saint-Denis, la Ferronnerie, Saint-Honoré, en désordre, mais avec une certaine solennité. On enjoint à tous les citoyens qu'on rencontre de mettre chapeau bas. Cette marche, tout à la fois funèbre, déguenillée et menaçante, était précédée de tambours voilés en signe de deuil. On arrive sur la place Vendôme. En ce moment, un détachement de dragons, qui stationnait devant les hôtels des fermiers généraux, fond sur cette foule. Le buste de Necker est brisé. Tout le monde se disperse: un garde-française sans armes demeure ferme et se fait tuer.
Une autre foule ayant été chargée, au milieu du jardin des Tuileries, par le prince de Lambesc, alla porter l'effroi dans les rues et les faubourgs. La ville n'eut plus qu'un cri: «Aux armes!» Dans la soirée, les gardes-françaises se réunirent au peuple. Sous la blouse, sous l'uniforme, n'était-ce pas le même coeur? L'incendie des barrières continua. Terrible spectacle que la capitale si violemment agitée, et entourée d'une ceinture de feu! Quelle vision! Le Palais-Royal, cet oeil vigilant des opérations publiques, resta ouvert toute la nuit. On défonça quelques boutiques d'armuriers. Telle était, du reste, la grandeur du sentiment national, que dans Paris, cette ville bloquée, sans tribunaux, sans police, à la merci de cent mille hommes errant au milieu de la nuit et la plupart manquant de pain, il ne se commit pas un seul vol, un seul dégât. L'ordre venait de sortir du désordre; un pouvoir nouveau naissait de l'insurrection: quelques patrouilles bourgeoises se montraient dans les rues, et à six heures du soir les électeurs de Paris s'étaient rendus à l'Hôtel de Ville, où ils tinrent conseil. Un homme du peuple en chemise, sans bas, sans souliers, le fusil sur l'épaule, montait bravement la garde à la porte de la grande salle.
Le même soir, six ou sept cents députés se réunirent, à Versailles, dans la salle des séances. En l'absence du président, l'abbé Grégoire, l'un des secrétaires, occupa le fauteuil. Les vastes galeries étaient remplies de spectateurs; la nouvelle des troubles qui agitaient Paris causait une inquiétude indescriptible; la plupart des physionomies étaient sombres. Grégoire crut qu'il fallait rassurer tout ce monde par une sortie vigoureuse contre les ennemis de la paix. «Le ciel, s'écria-t-il, marquera le terme de leurs scélératesses; ils pourront éloigner la Révolution, mais, certainement, ils ne l'empêcheront pas. Des obstacles nouveaux ne feront qu'irriter notre résistance; à leurs fureurs, nous opposerons la maturité des conseils et le courage le plus intrépide. Apprenons à ce peuple qui nous entoure que la terreur n'est pas faite pour nous…. Oui, messieurs, nous sauverons la liberté naissante qu'on voudrait étouffer dans son berceau, fallût-il pour cela nous ensevelir sous les débris fumants de cette salle! Impavidum ferient ruinae!» Un applaudissement général couvrit ce discours. Il fut aussitôt décidé que la séance serait permanente: elle dura soixante-douze heures. Des vieillards passèrent la nuit sur leurs siéges. A chaque instant, la salle pouvait être militairement envahie; tous les membres de l'Assemblée étaient décidés à mourir plutôt que de quitter leur poste. Il est bon de se reporter à ces nuits d'alarmes: voilà pourtant ce que l'enfantement de la liberté coûta d'angoisses, de veilles et de dévouement aux conscrits de 89!
La journée du 13, à son lever, éclaire une ville menaçante. Le tocsin sonne, Paris demande toujours des armes; les serruriers forgent des piques; les plombiers coulent des balles: mais où sont les fusils? On va en demander à l'Hôtel de Ville, aux Chartreux: rien! on ne trouve rien. Quelques-uns courent au garde-meuble et enlèvent les armes qu'on y conservait: ces armes étaient en général fort belles, mais en petit nombre. L'épée de Turenne, l'arquebuse de Charles IX, les pistolets de Louis XIV, passent aux mains obscures du peuple. Les engins du despotisme se retournent contre les oppresseurs. [Note: Ces armes, ainsi que celles qui avaient été prises dans la boutique des armuriers, furent fidèlement remises apres le combat.] Les prisons de la Force sont ouvertes et les prisonniers délivrés, excepté les criminels. Du fer et du pain, c'est tout le voeu de ces hommes qui courent les rues en chemise et la manche retroussée. Un amas de blé ayant été trouvé au couvent des Lazaristes, on le fait conduire à la halle dans des voitures.
L'événement de la journée est l'organisation d'une garde bourgeoise pour rétablir la sûreté dans la ville. «C'est le peuple, avait dit un député, qui doit garder le peuple.» Le curé de Saint-Étienne-du-Mont marche au milieu de ses paroissiens capables de porter les armes. «Mes enfants, leur dit-il, cela nous regarde tous; car nous sommes tous frères.» Un bateau chargé de poudre à canon ayant été découvert, un autre abbé se charge d'en faire la distribution au peuple. Les cloches mêmes des églises servent à donner au mouvement un caractère solennel: ces grandes voix d'airain qui convoquaient les hommes à la prière les appellent maintenant à la conquête de leurs droits et de leurs libertés.
La nuit descend sur Paris inquiet, éveillé. Des divisions de soldats du guet, des gardes-françaises, des patrouilles bourgeoises parcourent les rues; quelques bandes continuent à errer, demandant du pain et des armes. La sombre attitude de ces hommes dont les desseins sont inconnus, le bruit des crosses de fusil sur le pavé, les feux allumés sur les places publiques, tout redouble l'effroi des vieux royalistes. Les mots d'ordre échangés ça et là entre les patrouilles donnent quelquefois lieu à des méprises et à des fausses alertes qui se transmettent d'un quartier de la capitale à l'autre. Tout s'émeut, puis tout rentre dans le silence. Ce calme n'est plus interrompu que par le sinistre hoquet du tocsin. Un rang de lampions posés sur les croisées du premier étage borde toutes les maisons de chaque rue et aide à surveiller les manoeuvres des traîtres. De moment en moment, on entend retentir ce cri; «Soignez vos lampions; l'ennemi est dans les faubourgs.» Des signaux convenus indiquent quand il faut les éteindre et quand il faut rallumer. Des hommes armés de leviers, de sabres, de bâtons, de fourches, montés jusque sur le toit des maisons, guettent l'ombre même d'un danger possible. Des femmes, des jeunes filles presques nues, un jupon serré autour de la taille, arrachent péniblement tous les pavés de leur cour et, pliant sous le fardeau, les transportent dans leur chambre. Gare aux soldats qui passeront sous leurs fenêtres!
Que l'ennemi vienne maintenant, il trouvera une ville fermement résolue à se défendre!
L'Assemblée, depuis deux jours, accusait hautement la cour et l'invitait à éloigner cet appareil de guerre qui tenait la ville en agitation; mais elle n'en obtenait que des réponses vagues ou menaçantes.
«On nous fit attendre dans une salle, raconte Barère: le roi passa dans son cabinet, dont les rideaux cramoisis, mal joints ou mal fermés, nous laissèrent voir le jeu des physionomies des ministres et les mouvements des princes, qui semblaient portés à des actes de sévérité. Tous les membres de la députation voyaient cette pantomime politique à travers les grands verres de Bohême qui sont à ces croisées.» L'irrésolution du roi tenait à son caractère; l'obstination de la reine à un orgueil de femme: l'ignorance où ils étaient tous les deux des forces réelles de l'opinion publique acheva de les perdre. Louis XVI ne comprenait rien à ce qui se passait, depuis deux mois, autour de lui: son insouciance ne fut pas un instant ébranlée. Il écrivait un journal dont voici quelques feuillets:
«Le 1er juillet 1789.—Mercredi. Rien. Députation des États.
«Jeudi 2.—Monté à cheval à la porte du Maine, pour la chasse du cerf à
Port-Royal. Pris un!
«Vendredi 3.—Rien.
«Samedi 4.—Chasse du chevreuil au Butard. Pris un et tué vingt-neuf pièces.
«Dimanche 5.—Vêpres et salut.
«Lundi 6.—Rien.
«Mardi 7.—Chasse du cerf à Port-Royal. Pris deux.
«Mercredi 8.—Rien.
«Jeudi 9.—Rien. Députation des États.
«Vendredi 10.—Rien. Réponse à la députation des États.
«Samedi 11.—Rien. Départ de M. Necker.
«Dimanche 12.—Vêpres et salut. Départ de MM. de Montmorin,
Saint-Priest et de la Luzerne.
«Lundi 13.—Rien.» Il avait pris médecine.
Il est probable que le roi ne savait rien ou presque rien de ce qui se passait dans la capitale. Averti par les députés du tiers, il croyait que ces hommes avaient intérêt à le tromper, à grossir le caractère des événements. De perfides conseillers profitaient de cette faiblesse d'esprit pour obscurcir son jugement et lui déguiser la vérité. Il se trouva même un certain baron de Breteuil, qui, s'érigeant en messie royaliste, promit de raffermir, en trois jours, le temple de l'autorité ébranlé par les factieux. Or, le troisième jour, le peuple était maître de Paris et du roi.
Le 14 juillet 1789, la grande ville poussa deux cris; «Aux Invalides!—A la Bastille!» On alla d'abord à l'Hôtel des Invalides où l'on savait qu'il y avait des armes. Les volontaires du Palais-Royal, des Tuileries, de la Basoche, de l'Arquebuse, marchaient en rangs serrés et le fusil sur l'épaule. La veille c'était une cohue, aujourd'hui c'est une armée. Cette armée, assemblée à la hâte, connaissait mal sans doute les règles de la discipline; mais la puissance invisible de l'esprit public la soulevait. Personne ne commandait; tout le monde sut obéir. Ce n'était pas une expédition sans danger: on savait que trois régiments étaient campés au Champ-de-Mars; le gouverneur des Invalides avait des armes, des munitions, et un fort détachement du régiment d'artillerie de Toul avec ses pièces. Qui prit tout cela? L'opinion. Le soldat se sentait circonvenu, caressé, supplié par ces hommes du peuple qui étaient ses frères, par ces jeunes filles qui étaient ses soeurs. L'ennemi n'était déjà plus l'ennemi; il riait, il buvait, il était charmé; les déserteurs sont désormais ceux qui restent sous le drapeau de la cour au lieu de se rallier aux couleurs de la patrie. On enleva de l'Hôtel 28 000 fusils et 20 pièces de canon: tout ce qui n'était pas arme de guerre fut respecté. On distribua sur-le-champ des fusils et de la poudre: voilà le peuple armé.
Vers onze heures, le ciel, jusque-là voilé, se découvrit. Un soleil révolutionnaire chauffait toutes les têtes. Alors sortit de la foule une grande voix qui disait: «A la Bastille! A la Bastille!»
Cette forteresse était détestée. Le peuple se montra désintéressé dans la haine qu'il lui portait; car, après tout, elle ne lui avait rien fait à lui. Cette sombre prison d'État n'avait point été construite pour des manants. Il fallait être à peu près gentilhomme pour avoir l'honneur d'y être renfermé, ou comme Voltaire, Mirabeau et tant d'autres, avoir écrit pour la cause du peuple et de la liberté. C'était un des motifs de la haine du peuple. Cette forteresse inquiétait d'ailleurs les Parisiens à d'autres titres. Du haut de ses huit grosses tours ne pouvait-elle écraser la foule sous la mitraille de ses bouches à feu, foudroyer certains quartiers de la ville? Le faubourg Saint-Antoine avait cette citadelle-là sur le coeur. L'importance de la Bastille était grande au point de vue stratégique, mais bien plus grande encore était la signification qui s'y rattachait. Elle représentait la prérogative royale et l'ancien régime. C'était la contre-révolution énorme, massive et scellée dans la pierre. La destruction de tout autre édifice public n'eut été qu'un acte de vandalisme; la Bastille renversée, tout ce qui restait en France du pouvoir absolu s'écroulait. Cette vérité fut aussitôt comprise de tous: le peuple a des éclairs de génie; il ne raisonne point, il devine.
Parmi les assaillants, quelques hommes déterminés avaient réussi à rompre les chaînes du pont-levis qui gardait l'entrée de la première avant-cour de la Bastille; c'est alors que le feu commença. Tout le monde se lança dans un tourbillon de fumée. Devant ces remparts hérissés de canons, les citoyens se confondirent dans un même élan, dans la même détermination de vaincre ou de mourir. Des enfants (le gamin de Paris existait déjà), même après les décharges du fort, couraient ça et là pour ramasser les balles ou la mitraille. Furtifs et pleins de joie, ils revenaient s'abriter et présenter ces munitions de guerre aux gardes-françaises qui les renvoyaient, par la bouche du canon, aux assiégés. Les femmes, de leur côté, secondaient les opérations avec une ardeur incroyable. On distinguait parmi elles, en agile amazone, robe de drap bleu, chapeau à la Henri IV sur l'oreille, large sabre au côté, deux pistolets à la ceinture, une jolie Liégeoise. La fumée de la poudre l'enivre; elle pousse, elle exalte les assaillants. Son histoire était celle de toutes les femmes galantes: aimée, puis trahie. Dans ses emportements et ses fureurs de chatte, elle jette mille imprécations contre la Bastille. On voit à côté d'elle, dans la foule, d'autres grandes pécheresses, qu'un sentiment nouveau, extraordinaire, immense, venait aussi de convertir. Aujourd'hui, elles n'ont plus qu'un amant: le peuple. Leur coeur est tout à la Révolution; et comme les anciennes Gauloises, elles inspirent les combattants. Parmi ces derniers, il y a des gens sans aveu et à figure livide: le feu purifie tout. La plupart se montrent héroïques. Frappés, ils tombent en criant: «Nos cadavres serviront du moins à combler les fossés!»
Au milieu de ce dévouement général et de cette ardeur, un trait particulier de courage sur mille mérite d'être signalé par l'histoire. Les assaillants avaient cessé le feu; à un signal donné, une planche est jetée sur l'un des fossés qui entouraient la Bastille: un citoyen s'élance et tombe; un autre, le fils d'un huissier, Maillard, s'avance sans broncher sur ce pont étroit et dangereux. Tout à coup un cri s'élève: «La Bastille se rend!» Elle, cette forteresse que Louis XI, Louis XIV et Turenne jugeaient imprenable,—oui, la Bastille demande à capituler.
Pendant ce temps-là, les électeurs délibéraient à l'Hôtel de Ville; hommes de peu de foi, ils regardaient le siége de cette forteresse comme une entreprise téméraire. Soudain un autre grand cri s'élève dans les airs: «La Bastille est prise!»
Hommes, femmes et enfants se précipitent alors comme un torrent vers la place de Grève. Des citoyens bizarrement armés, noirs de poudre, portent en triomphe dans leurs bras un jeune officier des gardes-françaises, Élie, dont la conduite avait été magnanime. Les vainqueurs affectèrent de défiler devant le buste de Louis XIV qui était alors sur la place, en face de l'Hôtel de Ville. Lui absent, la fête n'eût point été complète; il fallait à la monarchie, pour témoin de sa défaite, le plus absolu des rois.
Bientôt toute cette tempétueuse foule pénètre dans la salle où un comité d'électeurs appartenant à la classe moyenne s'étaient réunis: les murs tremblent, les boiseries craquent. Un homme porte les clefs et le drapeau de la Bastille; un autre, le règlement de la prison pendu à la baïonnette de son fusil. A la prière de l'intrépide Hullin, d'Élie et des gardes-françaises, qui s'étaient signalés pendant le siége, on couvre les prisonniers d'un généreux pardon.
Quelques représailles avaient eu lieu dans l'intérieur de la forteresse: le misérable de Launay, gouverneur de la Bastille, qui avait fait tirer sur le peuple, fut mis à mort; un traître, Flesselle, prévôt de Paris, qui avait amusé depuis deux jours les Parisiens, pour se donner le temps de les surprendre, fut abattu dans la foule par une main restée inconnue. L'horreur de ces exécutions disparut dans l'ivresse de la victoire.
Un architecte, le citoyen Palloy, qui était au siége de la terrible forteresse, fut chargé de détruire le repaire de la tyrannie. Cet homme, qui n'est guère connu, fit une grande chose dans sa vie, une seule: il démolit la Bastille.
La chute de cette célèbre prison d'État eut dans le monde un retentissement prodigieux. En France, on crut entendre tomber, d'une extrémité du territoire à l'autre, le pouvoir monstrueux de la force. Dès que la nouvelle s'en répandit à Versailles, [Note: Dans la nuit du 14 juillet, une députation s'était rendue chez le roi sans rien obtenir. Louis XVI fixa les yeux constamment sur M. de Mirabeau. Le roi du passé regardait tout étonné le roi de la Révolution.] la cour, qui tenait encore ferme dans ses projets d'attaque, fut anéantie. La terreur passa en un instant du peuple aux agresseurs. Les régiments, campés au Champ-de-Mars, déguerpirent pendant la nuit et prirent la fuite, comme si l'épée de la colère divine s'était étendue sur eux. On ramena, de ces lieux occupés naguère par une armée, plusieurs voitures chargées de tentes, de pistolets, de manteaux. Le succès au contraire fit de tous les citoyens un peuple de frères. On s'embrassait, on était heureux. Les religieux de divers couvents avaient pris la cocarde aux couleurs de la nation, blanc, bleu et rouge; ils formèrent des détachements; le temps de la Ligue et de la Fronde était revenu. Le curé de Saint-Étienne-du-Mont avait marché tout le temps à la tête de ses paroissiens. Ces guerriers, en soutane, en froc et en capuchon, attestaient l'unanimité de sentiments qui faisait agir toute la ville. Il se trouvait là des nobles, des bourgeois, des abbés, des hommes du peuple: ils n'avaient tous qu'une volonté, qu'une âme. Comme on n'était pas encore rassuré sur les intentions de la cour, on dépava les rues, on éleva des barricades; précautions très-sages sans doute: mais que pouvait désormais la faction royaliste en face d'une Assemblée souveraine, d'un peuple en insurrection, d'une armée évanouie?
Pendant que l'on se battait encore à la Bastille, un nombreux détachement de dragons et de cavalerie allemande, reçu dans Paris aux acclamations de la multitude, venait de reconnaître le quartier Saint-Honoré et traversait le Pont-Neuf. Un chef d'escadron commande alors à ses soldats de faire halte, pour haranguer les citoyens: il annonce comme une bonne nouvelle la prochaine arrivée du corps de dragons, de hussards, et de Royal-Allemand, toute cavalerie qui vient, dit-il, se réunir au peuple. Un applaudissement, mêlé de cris de joie, accueille son discours. Un seul assistant remue la lèvre en signe de doute. Il s'élance du trottoir, fend la foule jusqu'à la tête des chevaux, saisit par la bride celui de l'officier et somme celui-ci de mettre pied à terre. L'officier interdit descend de cheval. L'inconnu, quoique petit et grêle, exige que le chef remette ses armes et celles de ses soldats dans les mains du peuple. L'officier garde un silence qui donne à penser. Ce refus tacite confirme dans ses soupçons le citoyen ombrageux, qui se met alors à semer l'alarme parmi les assistants. Ses gestes et ses paroles répandent la méfiance. La foule enjoint sur-le-champ aux cavaliers de faire volte-face, et les conduit à l'Hôtel de Ville d'où le comité les renvoie tous à leur camp sous bonne garde.
Cet homme, dont le coup d'oeil vigilant avait peut-être éventé une ruse et déjoué une entreprise perfide des royalistes, était Jean-Paul Marat.
Le 14, Louis XVI avait écrit sur ses tablettes: «Rien.»
La nouvelle de la prise de la Bastille jeta dans le camp de l'aristocratie un tel découragement que les choses à Versailles changèrent de face: le roi n'eut d'autre moyen de salut que de venir lui-même au milieu de l'Assemblée nationale. La Bastille prise, il se rendait: l'insurrection de Paris consacra définitivement la victoire des droits sur les priviléges; sans elle, tout ce qui avait été fait jusque-là manquait d'une sanction décisive. Le serment du Jeu-de-Paume, l'opposition à la fameuse séance royale étaient des actes courageux; mais ces germes auraient pu être stériles: il fallait le concours de Paris pour les féconder et pour leur donner les caractères d'une révolution. L'Assemblée avait mis dans sa résistance la force du raisonnement; le peuple y mit celle du sentiment et de l'action: alors tout fut dit. Les révolutions se font encore plutôt par le coeur que par la tête.
Le roi vint à Paris. Il traversa une foule immense: deux cent mille citoyens formaient sur son passage une haie hérissée de baïonnettes, de piques, de faux, de bâtons ferrés: gardes-françaises, milice bourgeoise, religieux, tous étaient confondus sous les armes, tous étaient amis. On se traitait de frères: les riches accueillaient les pauvres avec bonté; les rangs n'existaient plus, tous étaient égaux. Quel beau jour! les femmes du haut des balcons, des croisées, jetaient à pleines mains des cocardes patriotiques, des touffes de rubans. La fraternité respirait sur tous les visages. Le roi venait chercher la paix dans cette ville, où, quelques jours auparavant, il avait fait entrer la guerre. Le peuple avait le droit de se montrer sévère; il fut clément. On reçut d'abord Louis XVI dans un silence morne et solennel, les armes hautes; mais quand il eut pris des mains de Bailly la cocarde nationale, quand surtout il sortit de l'Hôtel de Ville où il était entré sans gardes et avec confiance, la sérénité revint sur tous les visages, et les armes s'abaissèrent. Il fut reconduit avec tous les honneurs militaires par les vainqueurs de la Bastille. Les femmes de la halle crièrent le long du chemin: Vive le roi!
Cependant il devenait clair que cet homme indécis, épousant tour à tour la cause de la noblesse par inclination, celle du peuple par raison et par nécessité, était un grand obstacle à la marche des événements. Or les révolutions n'ont qu'une manière d'agir avec les obstacles; elles les suppriment.
Deux pouvoirs démocratiques étaient sortis de l'insurrection, la municipalité de Paris et la garde nationale; deux hommes avaient dû leur élection aux circonstances, Bailly et La Fayette.
La vieille France, rajeunie par le sentiment du droit, aimait à tourner ses regards vers le Nouveau-Monde. Le marquis de La Fayette, qui avait concouru à l'affranchissement des États-Unis, fut le héros du jour. Triste rayon de popularité qui pâlit bientôt sur son front!
L'élan de Paris se communiqua comme l'étincelle électrique aux provinces; de toutes parts, les citoyens se réunirent et s'associèrent.—Je m'arrête: la France, depuis l'ouverture des États généraux, a fait une belle étape dans la voie qui conduit à la liberté. La Révolution est demeurée pure d'excès. Sa première victoire n'a point coûté une larme; en sera-t-il ainsi dans la suite?
Vain espoir! Ses ennemis ne négligent rien pour la provoquer et lui mettre le glaive à la main.