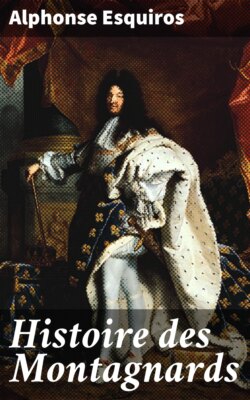Читать книгу Histoire des Montagnards - Alphonse Esquiros - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
Suite de l'émotion populaire.—La détente.—Nuit du 4 août.—Quelle est sa portée.—Abolition des dîmes.—Conduite du roi et de la cour.
L'ancien régime avait semé la servitude; il récoltait la révolte.
Seule l'Assemblée constituante était à même de ramener le calme et la paix: unique pouvoir dans lequel on eût confiance, elle surnageait au milieu du naufrage de toutes les vieilles institutions. Malheureusement, les membres de l'Assemblée n'étaient guère d'accord entre eux. Malgré l'apparente fusion des ordres, il restait toujours dans l'Assemblée le parti des intérêts et le parti des idées, l'aristocratie et la nation. De toutes parts, cependant, le régime féodal s'écroulait. Les droits prélevés par la noblesse et le clergé sur le travail de la classe agricole avaient été dénoncés comme injustes, dans les cahiers de doléances, et les députés du Tiers avaient reçu le mandat impératif d'en poursuivre l'abolition. L'esprit public avait, comme toujours, devancé l'Assamblée: il finit par l'entraîner.
Nous sommes à la nuit du 4 août. Quelques voix éloquentes et désintéressées sonnent le tocsin d'une Saint-Barthélémy des abus. Bientôt l'enthousiasme et l'émulation du renoncement gagnent tous les coeurs. C'est à qui fera son offrande; celui-ci propose d'abolir les justices seigneuriales; celui-là, les corvées, les droits de chasse, de pêche et de colombier, le droit de retrait féodal, les banalités, les cens, les lods, etc., etc. L'affranchissement des servitudes personnelles est décrété: qui croirait que le nombre des serfs montait encore à quinze cent mille? Un curé, Thibault, apporte à la patrie le denier de la veuve: il propose le sacrifice du casuel. On le refuse. Il ne s'agit encore que des priviléges de la noblesse.
Les titres féodaux étant abolis, viennent les titres des provinces; plusieurs d'entre elles jouissaient de certaines immunités, de certains avantages dont l'origine se perdait dans la nuit des temps; nouvelle immolation. Elles déclarent se résigner à rentrer dans le droit commun. Puis ce fut le tour des villes; par la voix de leurs députés, elles vinrent, l'une après l'autre, offrir le sacrifice de leurs antiques chartres. Ainsi l'arbre féodal tombait feuille par feuille, branche par branche; ainsi s'abaissaient les barrières qui s'étaient opposées trop longtemps à l'unité nationale. Il n'y avait plus de classes ni de provinces; il y avait une seule famille, une seule et même patrie.
La séance avait commencé à huit heures du soir; elle se prolongea jusqu'à deux heures du matin, au milieu des transports d'enthousiasme; se démunir, se dévouer, tel était le véritable esprit de la Révolution Française, et cet esprit souffla, celle nuit-là, sur toutes les têtes de l'Assemblée. C'était beau, c'était grand. La conscience des nobles semblait soulagée d'un poids énorme: ne venait-elle point de rejeter le fardeau des anciennes iniquités sociales?
Tous les coeurs étaient attendris. L'archevêque de Paris demande qu'on chante, dans quelques jours, un Te Deum pour remercier Dieu d'avoir inspiré aux élus du peuple un tel acte de désintéressement et de justice.
Au moment où tombait pierre à pierre l'édifice de la féodalité, un vieillard murmurait tout bas dans un des coins de la salle: «Ils ne laisseront rien debout!» Ce vieillard se trompait: ils ont laissé après eux la France une et régénérée.
Quand les débats de la séance du 4 août furent connus, la France entière tressaillit. «L'ivresse de la joie, raconte l'auteur des Révolutions de Paris, s'est aussitôt répandue dans tous les coeurs; on se félicitait réciproquement; on nommait avec enthousiasme nos députés les Pères de la Patrie. Il semblait qu'un nouveau jour allait luire sur la France… Il s'est formé des groupes dans presque toutes les grandes rues. Près de tous les ponts, on attendait les passants pour leur apprendre ce qu'ils auraient peut-être ignoré jusqu'au lendemain. On était aise de partager sa joie, de la répandre. La fraternité, la douce fraternité régnait partout. C'était surtout lorsqu'on rencontrait quelques gardes-françaises que les démonstrations de joie étaient plus vives. On en a vu embrasser des bourgeois qui les serraient dans leurs bras. Oui, il est des moments dans la vie des peuples, comme dans celle des hommes, qui font oublier des années de douleur et de calamité.» On voit à quel degré le sentiment national était ému. La Révolution Française fut par-dessus tout un épanouissement du coeur.
La nuit du 4 août n'avait qu'un tort: elle venait trop tard. Les seigneurs ont trop attendu. Que n'ont-ils abdiqué leurs priviléges avant la révolte des paysans, avant le pillage des châteaux, avant les attaques à main armée contre les armoires de fer dans lesquelles ils conservaient leurs anciens titres! Fallait-il donc qu'éclatât l'incendie pour qu'ils se décidassent à faire la part du feu? Ne peut-on leur reprocher d'avoir lâché une proie qui leur échappait?
D'un autre côté, tenons bien compte d'un fait important, c'est que le gouvernement du roi ne fut pour rien dans ce grand acte de réparation et d'humanité. Lors de l'ouverture des États généraux, Louis XVI, faisant allusion au cri général des communes et au voeu des cahiers, disait, le 23 juin 1789: «Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées, et, sous le nom de propriété, nous comprenons expressément les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux terres ou aux fiefs, ou appartenant aux personnes.»
Le roi, instruit par les événements, avait-il depuis ce temps-là changé d'avis?
Il est permis d'en douter. La nouvelle de la fameuse séance du 4 août porta le deuil et la consternation à la cour de Versailles. Quelques nobles incorrigibles, qui poursuivaient la guerre des priviléges contre le bien public, crurent tout perdu, et ils appelèrent le monarque au secours des institutions de l'ancien régime.
«J'invite l'Assemblée nationale, déclarait Louis XVI le 18 septembre 1789, à réfléchir si l'extinction des cens et des droits de lods et ventes convient véritablement au bien de l'État.»
Ces paroles, bien claires, furent interprétées comme un désaveu des résolutions prises par l'Assemblée nationale. Les intentions personnelles du roi, ses sympathies secrètes, se dévoilent encore mieux dans une lettre écrite à l'archevêque d'Arles:
«Je ne consentirai jamais, lui disait-il, à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai point une sanction à des décrets qui les dépossèdent.»
Durant plus d'un mois, en effet, la cour usa de toute son influence pour jeter, comme on dit, des bâtons dans les roues. Elle voulait que l'Assemblée revînt sur ses déclarations du 4 août, ou tout au moins qu'elle les modifiât. Parmi les représentants de la noblesse, plusieurs avaient peut-être été dupes de leur générosité; on espérait les ramener au bon sens, à l'intelligence de leurs véritables intérêts. Les résolutions adoptées dans un élan d'enthousiasme devaient maintenant passer par la longue filière des travaux législatifs. Le système féodal était bien mort; il restait toutefois à chercher les moyens de liquider sa succession. Un comité fut constitué: il se composait des juristes les plus versés dans le droit des fiefs. Après bien des lenteurs sortit enfin de leurs débats cette conclusion:
«Le régime féodal est aboli en tant que constitutif des droits seigneuriaux; mais ses effets sont maintenus en tant qu'ils dérivent du droit de propriété.»
Un décret des 3 et 4 mai 1790 déterminait en conséquence le mode et le taux des rachats, pour certains droits qu'on devait croire abolis. C'était une dérision. Comment des paysans écrasés, ruinés, sucés jusqu'à la moelle des os par l'ancien régime, auraient-ils jamais pu se racheter?
De tous les impôts, le plus lourd et le plus impopulaire dans les campagnes était la dîme ecclésiastique. Ce fut pourtant celui que les membres du clergé défendirent à l'Assemblée constituante avec le plus d'opiniâtreté. La discussion se rouvrit le 6 août 1789. Sieyès parla contre l'abolition de la dîme sans rachat. Un autre prêtre, qu'on s'étonna de voir prendre en main les intérêts de l'Église, fut l'abbé Grégoire.
Curé d'Emberménil, petite commune rurale située sur le ruisseau des Amis (Meurthe), il avait appris à aimer les humbles, les paysans, étant né lui-même de parents pauvres. Janséniste, il avait souvent pleuré sur les ruines de Port-Royal. Ses principes étaient ceux de Pascal et de Fénelon. Il cherchait en quelque sorte des ennemis pour les envelopper dans le pardon et dans la tolérance. Tous les réprouvés de l'Église étaient ses enfants de prédilection. La solitude avait fortifié les méditations de cet esprit austère et droit. Il admirait, en désirant l'imiter, la bonté du Créateur, qui étend sa prévoyance aux oiseaux du ciel et aux lis des champs. N'ayant d'autre richesse que celle de l'esprit, il cherchait à communiquer ses lumières aux ignorants. Les jours de fête, sa simple et fraîche éloquence jetait plus de fleurs que les pruniers sauvages, dont les rameaux entraient par les vitres cassées jusque dans l'église. Il avait formé une bibliothèque pour ses paroissiens; aux enfants, il distribuait des ouvrages de morale; il leur expliquait surtout le grand livre de la nature. L'alliance du christianisme et de la démocratie lui semblait si naturelle qu'il ne comprenait pas l'Évangile sans le renoncement aux priviléges. Tout le travail de son esprit était de mettre le sentiment religieux en harmonie avec les institutions républicaines. Aimé, il l'était de tous ses paroissiens, qu'il chérissait lui-même comme des frères. Quand le moment de nommer des représentants aux États généraux fut venu, il partit chargé de leurs recommandations et de leurs doléances. L'abbé Grégoire avait, dans sa démarche et dans toutes ses manières, cette rare distinction qui vient de la noblesse de l'âme. Assis sur les bancs de l'Assemblée, il s'efforça d'améliorer le sort des nègres, des enfants trouvés, des domestiques. Allant avec un zèle héroïque au-devant de tous les proscrits, il osa même défendre la cause des Juifs: Jésus-Christ, par la bouche de son ministre, venait de pardonner une seconde fois à ses bourreaux.
Comment donc se fait-il que la dîme n'inspirât point à cet honnête homme la même horreur qu'aux autres citoyens? Grégoire était prêtre; il avait épousé l'Église; le moyen d'échapper aux noeuds des serpents qui étouffèrent Laocoon!
Malgré la résistance du clergé, après trois jours d'aigres discussions, la dîme fut abolie sans rachat, pour l'avenir.
L'acte qui consacrait l'abolition des droits féodaux et des dîmes fut porté au roi par l'Assemblée tout entière. Louis XVI l'accepta et invita les députés à venir avec lui rendre grâces à Dieu, dans son temple, des sentiments généreux qui régnaient dans l'Assemblée.
Était-il de bonne foi en parlant ainsi? peu nous importe. Les priviléges étaient abolis; la justice, exilée depuis des siècles, venait de redescendre sur la terre.