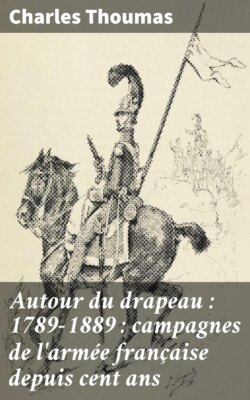Читать книгу Autour du drapeau : 1789-1889 : campagnes de l'armée française depuis cent ans - Charles Antoine Thoumas - Страница 12
NEERWINDEN ET MAYENCE
ОглавлениеLes glorieux résultats de la campagne de 1792 ne tardèrent pas à être compromis par des causes diverses qui faillirent entraîner la ruine de la France. L’armée se désorganisait; les régiments de ligne, dont la source de recrutement était tarie, ne pouvaient réparer leurs pertes; les volontaires de 1791, dont l’engagement expirait le 1er décembre, prétendaient d’autant plus être libres, que le but de cet engagement était atteint par l’expulsion des armées étrangères; tous les efforts pour les retenir sous les drapeaux échouèrent vis-à-vis du plus grand nombre d’entre eux. Les autres volontaires, les fédérés surtout, poussaient l’indiscipline jusqu’à ses dernières limites; leurs cadres étaient généralement détestables. A Spire, lors de l’entrée des troupes de Custine, c’est un capitaine qui, à la tête de sa compagnie, avait donné le signal et l’exemple du pillage.
Les dilapidations administratives réduisaient l’armée à la misère; elle manquait de tout. Le ministre de la Guerre, Pache, avait rempli les bureaux de ses créatures, qui semblaient s’être porté le défi de voler ou de laisser voler à qui mieux mieux. C’est de ce temps-là que datent les souliers à semelles de carton, les chemises en toile d’emballage, les vieux effets achetés et distribués comme neufs. Dumouriez avait proposé un système d’après lequel son armée serait nourrie, habillée et équipée en Belgique. Ce système fut repoussé. La misère rendit les soldats pillards et maraudeurs; faute de bois de chauffage, ils arrachaient les portes et les fenêtres des maisons et brûlaient les arbres fruitiers. Les Belges aspiraient après le départ de cette armée, qu’ils avaient accueillie d’abord en libératrice.
La mort de Louis XVI, condamné par la Convention et exécuté le 21 janvier, détermina le départ d’un grand nombre d’officiers pour l’émigration. Ceux qui restaient devinrent suspects. Les généraux qui avaient servi sous la Monarchie furent en butte aux attaques les plus violentes. Enfin les ennemis de la France doublèrent de nombre, et une coalition redoutable fut soudoyée contre elle par l’or de l’Angleterre. Cette puissance et la Hollande ayant manifesté leur indignation au sujet de la condamnation de Louis XVI, la Convention décréta, le 1er février, que la République était en guerre avec elles. Le roi d’Espagne, un Bourbon, avait offert sa neutralité en échange de la liberté du roi de France; cette offre ayant été repoussée avec dédain, il déclara la guerre à la France le 23 mars.
Pour résister à toute l’Europe, cinq cent mille hommes étaient jugés nécessaires. Or c’est à peine si l’on comptait dans le rang deux cent mille soldats et volontaires, répartis entre huit armées. Une levée de 300,000 hommes est décrétée: Beurnonville, nommé ministre de la Guerre, est chargé de l’exécution de ce décret; on décide en outre que les bataillons de ligne seront amalgamés avec les bataillons de volontaires, à raison de un pour deux; mais cette fusion, jugée impraticable tant que dureront les hostilités, est ajournée jusqu’à la fin de la campagne.
Dumouriez, sollicité par les révolutionnaires de Hollande qui s’étaient réfugiés à Anvers, avait projeté la conquête de ce pays. Son plan d’invasion était très audacieux; le succès ne pouvait en être assuré que par le secret le plus absolu. Il porte le gros de ses forces sur Aix-la-Chapelle et Maëstricht et installe son quartier général à Liège, où se rendent tous ses aides de camp et son état-major. En même temps, il réunit rapidement à Anvers un corps de 14,000 hommes, à la tête duquel il se met lui-même avec un état-major improvisé, excite ses soldats en leur offrant pour perspective la conquête d’un pays riche, et entre en Hollande.
Le succès lui sourit d’abord; les places de Bréda et de Gertruydenberg se rendent à la première sommation. Déjà Dumouriez s’apprêtait à traverser, sur les bateaux qu’il a fait réunir, le petit bras de mer de Dordrecht, pour pénétrer au cœur du pays, lorsqu’il est impérieusement rappelé en Belgique. Les troupes qu’il y avait laissées, attaquées par les Autrichiens, avaient pris la fuite, et dans leur déroute elles réclamaient à grands cris le vainqueur de Jemmapes. Dumouriez, abandonnant malgré lui la proie qu’il croyait tenir, revient rallier l’armée, relève son moral par le brillant combat de Tirlemont, et croit pouvoir attaquer l’ennemi fortement établi à Neerwinden.
Dans cette bataille, livrée le 16 mars 1793, les deux armées occupent, en face l’une de l’autre, un front de deux lieues; Miranda commande la gauche des Français, le duc de Chartres le centre, Dampierre la droite; huit colonnes marchent à l’attaque des positions ennemies. La droite et le centre sont vainqueurs, une lutte acharnée s’engage pour la possession du village de Neerwinden; mais, après un premier succès, la gauche est repoussée; les volontaires qui en font partie sont pris d’une panique et s’enfuient jusqu’à deux lieues en arrière du champ de bataille; le centre, pris en flanc, est écrasé, et Dumouriez se voit forcé d’ordonner la retraite, qui s’opère en assez bon ordre sous la protection de la droite. Il laissait sur le terrain 4,000 tués ou blessés, 2,500 prisonniers, un matériel considérable. La Belgique était perdue; une période de désastres commençait pour les armes françaises.
Dumouriez, poursuivi par la haine des Jacobins, se sentait perdu. Pour se sauver, il entre résolument dans la voie de la trahison; il conclut avec le prince de Cobourg, général en chef de l’armée alliée, une convention qui lui permet de ramener ses troupes dans les places de la frontière, et dont un article secret lui assure le concours d’un corps d’armée pour marcher contre la Convention. Quatre commissaires de cette Assemblée, et le ministre de la Guerre lui-même, arrivent à son quartier général de Saint-Amand, pour l’arrêter. C’est lui qui les fait arrêter par des soldats dévoués à ses projets et qui les livre aux Autrichiens comme otages. Mais, si les troupes de ligne lui sont en général favorables, les volontaires s’insurgent contre lui, et il se voit forcé de chercher un asile dans l’armée ennemie.
Il part, accompagné du duc de Chartres, des généraux Valence et Thouvenot, de son fidèle Renard, des demoiselles Fernig, et escorté par les hussards de Berchiny. Les volontaires de l’Yonne, commandés par Davout, rencontrant ce cortège, l’accueillent et le poursuivent à coups de fusil. Dumouriez, assez mauvais cavalier, paraît-il, ne peut faire franchir à son cheval un fossé plein d’eau, il prend celui d’un domestique du duc de Chartres; Thouvenot, dont le cheval est tué, monte en croupe derrière Renard, les deux sœurs Fernig n’ont plus qu’un cheval pour elles deux; la rapidité de leur fuite disperse les compagnons de Dumouriez, et c’est dans cet équipage qu’ils arrivent auprès du prince de Cobourg. Vivement sollicité par le prince de donner suite aux projets concertés entre eux, Dumouriez s’y refuse pour ne pas courir à un échec certain ét part pour l’Angleterre, où il doit vieillir et mourir dans l’exil, laissant une mémoire méprisée, en dépit de ses talents militaires et des services qu’il avait rendus à son pays. Sa trahison a tout effacé aux yeux de la postérité et de l’histoire.
Après la fuite de Dumouriez, Dampierre, nommé général en chef, ramène l’armée au camp de Famars, sous Valenciennes. Officier expérimenté, il veut laisser le temps à ses troupes démoralisées de se refaire, et reste sur la défensive en se contentant de harceler l’ennemi; mais la méfiance dont les généraux étaient l’objet, avait inspiré à la Convention une mesure qui exerça plus d’une fois sur les opérations militaires l’influence la plus fâcheuse, tout en doublant dans une foule de circonstances l’énergie de la lutte. Des membres de l’Assemblée sont envoyés aux armées à titre de commissaires, avec pleins pouvoirs, pour surveiller les généraux et stimuler leur ardeur. Ceux de ces commissaires qui accompagnaient l’armée du Nord intiment à Dampierre l’ordre de prendre l’offensive. Le général cherche d’abord à dégager la place de Condé qui venait d’être investie: il est repoussé avec une perte de 2,000 hommes. Les soldats eux-mêmes demandent à grands cris de marcher de nouveau à l’ennemi pour se venger; Dampierre ordonne une attaque générale; le feu meurtrier de l’ennemi écrase son centre, ses ailes sont tournées, il se replié sur le camp de Famars. Les commissaires de la Convention le forcent encore d’en sortir le 11 avril; les positions de l’ennemi sont vigoureusement attaquées, mais un boulet frappe Dampierre, lui emportant la cuisse, et le général expire le lendemain.
Lamarche, qui le remplace provisoirement, assailli le 23 mai par toute l’armée autrichienne, se défend bravement jusqu’à la nuit; mais accablées par le nombre, sur le point d’être forcées dans leur dernier retranchement, ses troupes abandonnent le camp et se réfugient sous les murs de Bouchain; la place de Valenciennes est investie.
En apprenant la mort de Dampierre, Cou thon, un des membres les plus actifs du parti jacobin, avait dit: «Il a bien fait de mourir, car son acte d’accusation était déjà dressé.» En effet, l’ère des persécutions exercées contre les généraux et les officiers supérieurs de l’ancienne armée avait commencé lors de la défection de Dumouriez. Le colonel Philippe de Vaux, son aide de camp, les généraux Miacsenski et Lescuyer, accusés d’avoir participé à ses complots, furent condamnés et exécutés. Plus heureux, les généraux Miranda, Stengel et Lanoue, poursuivis pour la déroute de l’armée de Belgique, furent acquittés.
Westermann lui-même, un produit de la Révolution, nommé colonel pour avoir dirigé l’émeute du 10 août, se trouva impliqué dans les poursuites. Il s’était fait un ennemi acharné dans la personne du trop célèbre Marat, en lui infligeant, aux applaudissements des passants, une correction à coups de fourreau de sabre, pour avoir médit de lui dans son journal. Westermann échappa cependant, pour cette fois, à une arrestation, grâce à la protection du Comité de salut public qui venait d’être nommé par la Convention. Ce n’était pas encore là le fameux Comité qui devait exercer une si terrible dictature. Composé d’hommes énergiques et pleins d’ardeur, celui-ci prit des mesures habiles; mais ses décrets restèrent souvent lettre morte par suite de la mauvaise volonté des bureaux du ministère de la Guerre, où Bouchotte, successeur de Beurnonville, avait rappelé les créatures de Pache.
Le Comité de salut public décida la mise sur pied de onze armées, savoir: armée du Nord, général en chef, Custine; de la Moselle, Houchard; du Rhin, Beauharnais; des Alpes, Kellermann; d’Italie, Brunet; des Pyrénées orientales, Flers; des Pyrénées occidentales, Servan; des côtes de la Rochelle, Biron; des côtes de Brest, Canclaux; des côtes de la Manche, Félix Wimpfen. Mais ces généraux expérimentés devaient bientôt faire place aux protégés des Jacobins. Six d’entre eux, Custine, Houchard, Brunet, Beauharnais, Flers, Biron, périrent sur l’échafaud révolutionnaire. Le Comité fit aussi décréter par la- Convention les moyens pratiques d’opérer la levée de trois cent mille hommes, précédemment ordonnée; ces moyens se résument dans la réquisition forcée. Les autorités locales renchérirent, pour la plupart, sur les mesures arbitraires de la Convention, et soulevèrent les plus vives réclamations.
Nous venons de voir que Custine avait été appelé au commandemeht en chef de l’armée du Nord; il prend le commandement dans les circonstances les plus critiques. L’armée réfugiée au camp de César, entre Bouchain et Cambrai, était dans un état complet de désorganisation. Les mesures énergiques du nouveau général y ramènent la discipline et l’ordre,mais il déclare ne pas pouvoir agir sans un renfort de 20,000 hommes d’infanterie et 10,000 de cavalerie. Il est mandé à Paris, le 15 juillet, pour donner des explications; mis en jugement comme coupable de n’avoir pas secouru Mayence quand il commandait l’armée du Rhin, condamné, malgré son dévouement à la République, et exécuté. Cependant la place de Condé, assiégée depuis les premiers jours d’avril, s’était rendue le 12 juillet, après une défense des plus vigoureuses. La disette était telle dans la place, que la ration journalière des soldats de la garnison avait été réduite à deux onces de pain, deux onces de viande de cheval, une once de riz et un tiers d’once de suif.
Bientôt vient le tour de Valenciennes, après un des sièges les plus meurtriers dont l’histoire fasse mention. Le bombardement avait duré quarante-cinq jours sans interruption. L’ennemi, commandé par le duc d’York, avait lancé sur la place 200,000 boulets, 30,000 obus et 42,000 bombes. Toutes les maisons étaient plus ou moins endommagées; les brèches étaient si larges et si praticables, que la cavalerie ennemie pouvait entrer par ces brèches dans la ville. 6,500 soldats de la garnison avaient péri par le feu de l’ennemi ou par la maladie; l’armée assiégeante, d’après les rapports officiels, avait perdu plus de 15,000 hommes.
Cette belle résistance était due à l’énergie du gouverneur, le général Ferrand, vieux guerrier de soixante-douze ans, et à la solidité de la garnison. Les habitants n’imitèrent pas l’exemple donné en 1792, par leurs voisins de Lille. Après s’être montrés tièdes dans les premiers jours du siège, ils réclamèrent instamment la capitulation dès que le bombardement fut commencé. La fermeté de Ferrand et la bonne contenance de ses troupes, soutenues par l’espoir de voir Custine venir à leur secours, dominèrent les plaintes des citoyens; mais le 25 juillet, au soir, l’ouvrage à cornes de la porte de Mons ayant été enlevé par l’assiégeant après un combat acharné, les soldats s’écrièrent qu’ils étaient trahis et se joignirent aux bourgeois pour assaillir de leurs clameurs le gouverneur et le conseil de défense qui, reconnaissant l’impossibilité de prolonger la résistance, signèrent enfin la capitulation le 28 juillet. La garnison, réduite à 10,000 hommes, resta libre, sous la condition de ne point servir d’un an contre les troupes alliées.
Le sort des armes n’avait pas été plus favorable à la France sur la frontière du Rhin. Après avoir soutenu plusieurs combats honorables, Custine, cédant au nombre, s’était retiré derrière les lignes de Wissembourg. C’est ainsi que l’on nommait une suite de retranchements élevés sous le règne de Louis XIV, le long du cours de la Lauter, pour couvrir la basse Alsace contre une attaque venant du Palatinat. Limitées à gauche par les montagnes, à droite par le Rhin, près de Lauterbourg, ces lignes étaient appuyées au centre par la place de Wissembourg, protégées en avant par la forêt de Bienwald, soutenues en arrière par la hauteur de Geisberg. Custine s’y maintint, grâce surtout à son excellente artillerie, qui lutta plus d’une fois avec avantage contre celle de l’ennemi. En se retirant, il avait laissé dans Mayence une garnison de 22,000 hommes, trop faible pour tenir la campagne, trop nombreuse pour la défense de la place, dont elle devait dévorer rapidement les approvisionnements.
Dès le 6 avril, le maréchal prussien de Kalkreuth, ancien lieutenant du grand Frédéric, commençait l’investissement de Mayence; deux mois plus tard, le roi de Prusse venait prendre en personne le commandement de l’armée, forte de 70,000 hommes, et le siège régulier commençait. Lé général Doyré commandait en chef dans la place; Aubert-Dubayet dirigeait la défense sur la rive gauche du Rhin; le général Meunier, qui venait de s’illustrer en défendant à outrance la forteresse de Kœnigstein, commandait la tête du pont de Cassel, sur la rive droite. Les représentants du peuple Merlin et Rewbell animaient la garnison du souffle de leur patriotisme. Custine, nommé au commandement de l’armée du Nord, et voulant remettre à son successeur Beauharnais une armée victorieuse, fit une tentative pour dégager Mayence; il fut ramené vivement dans les lignes de Wissembourg. Beauharnais, à son tour, chercha à secourir Mayence par une marche combinée avec l’armée de la Moselle, que commandait Houchard; mais pendant que ces deux généraux achevaient, un peu trop lentement peut-être, leurs préparatifs, ils apprirent tout à coup que Mayence avait capitulé le 23 juillet.
La résistance avait été opiniâtre; chaque jour fut marqué par un combat, surtout devant le fort de Cassel. Frappé à la jambe dans une sortie, Meunier avait succombé, le 13 juin, aux suites de sa blessure. Kléber, peu connu jusque-là, s’était distingué parmi tous les généraux et s’était rendu populaire dans la garnison. Lors de la mort de Meunier, le roi de Prusse, voulant montrer son estime pour ce brave soldat, ordonna de cesser le feu pour ne pas troubler ses funérailles. Déjà la garnison souffrait de la famine. On ne vivait plus dans Mayence que de chair de cheval. Les chats, les rats, les souris, étaient regardés comme des mets de luxe. La soupe du soldat se faisait avec de l’huile de poisson. Plus d’un périt pour y avoir ajouté des herbes vénéneuses. Le général Doyré, ému des souffrances des habitants, leur permit de quitter la ville; 2,000 personnes, hommes, femmes, vieillards et enfants, franchirent les portes; mais, repoussées par les Prussiens, au nom des dures lois de la guerre, elles passèrent la nuit sur les glacis, exposées au double feu des assiégeants et des assiégés. Au jour, Doyré eut encore une fois pitié d’elles et leur fit rouvrir les portes. Enfin, réduits par la famine, les commissaires de la Convention et les généraux se résignèrent à une capitulation, qui fut signée au quartier général du roi de Prusse. La garnison obtint les honneurs de la guerre et resta libre, comme celle de Valenciennes, sous la condition de ne pas servir d’un an contre les alliés.
On serait tenté de croire que cette garnison, à sa rentrée en France, fut accueillie avec enthousiasme et saluée avec admiration. Il n’en fut pas ainsi; les orateurs des clubs crièrent à la trahison; on accusa les généraux d’avoir capitulé avant l’épuisement complet des approvisionnements. Doyré, Aubert-Dubayet, Kléber, furent arrêtés et emprisonnés; les troupes se virent, dans les villes qu’elles traversaient, l’objet du mépris de la populace et faillirent se révolter pour exiger la mise en liberté de leurs chefs. Le représentant Merlin dut monter à la tribune pour expliquer la conduite des défenseurs de Mayence; la Convention, suffisamment édifiée, décréta que la garnison de cette place avait bien mérité de la patrie, les généraux furent mis en liberté et dirigés avec leurs troupes sur la Vendée, où ils devaient rendre d’immenses services à la cause républicaine.
Les choses n’allaient pas mieux sur les autres frontières. Montesquiou, qui commandait l’armée des Alpes, avait été. forcé d’émigrer pour éviter d’être incarcéré comme aristocrate. Kellermann était venu le remplacer: la faiblesse de ses effectifs le réduisait à l’inaction. Brunet, commandant sur le Var, était également dans l’impossibilité de rien tenter, n’ayant que 20,000 hommes dénués de tout, et la présence des flottes ennemies l’empêchant de se ravitailler par mer.
Les troupes manquaient presque absolument sur la frontière des Pyrénées, où les Espagnols prenaient l’initiative des attaques. On parvint cependant à réunir quelques bataillons d’infanterie et de volontaires, à Bayonne d’une part, à Perpignan de l’autre. En y joignant des corps francs formés dans le pays, on eut le noyau des armées des Pyrénées occidentales et des Pyrénées orientales, commandées, la première par Servan, ancien ministre de la Guerre, la seconde par Fiers, jeune général, élève de Dumouriez.
Du côté de Bayonne, les Espagnols attaquèrent mollement; il y eut cependant quelques combats de montagne assez vifs, dans lesquels se distinguèrent particulièrement le futur maréchal Moncey, chef d’une compagnie de chasseurs basques, et La Tour-d’Auvergne, représentant d’une des familles les plus nobles de France, simple capitaine au régiment d’Angoumois, 80e de ligne, commandant une troupe de grenadiers, qui mérita par ses exploits le nom de Colonne infernale.
Dans les Pyrénées orientales, l’Espagne, qui visait toujours à recouvrer ses anciennes provinces du Roussillon, mit plus de monde en ligne. Le général Ricardos s’empara de Fort-les-Bains et de Bellegarde, qui se défendirent énergiquement. La forteresse de Bellegarde avait soutenu un bombardement de quinze jours, à la suite duquel les fortifications étaient complètement démantelées. Sur 44 canons, 32 étaient démontés. Aux termes de la capitulation signée le 24 juin, la garnison fut envoyée prisonnière en Espagne. Villefranche, qui se rendit le 4 août suivant, fut loin d’être aussi bien défendue; le commandant capitula après quinze heures seulement du tir des batteries ennemies. La garnison, peu nombreuse et composée de recrues, avait été, il est vrai, surprise en se voyant canonner par des pièces de gros calibre, hissées sur une montagne en apparence inaccessible, qui dominait la place; mais le commandant fut, avec assez de vraisemblance, accusé de trahison ou tout au moins de tiédeur pour la cause républicaine.
Quelques jours avant la reddition de Villefranche, Ricardos avait échoué devant le camp de l’Union, où le général Flers avait établi sa petite armée pour couvrir Perpignan. Là se fit remarquer le colonel Pérignon, chef d’un corps franc, devenu plus tard maréchal de France. Voyant ses chasseurs, sourds à ses exhortations, battre précipitamment en retraite, il prit un fusil et combattit en soldat dans les rangs du régiment de Champagne, dont la ferme contenance arrêta l’ennemi; il se remit ensuite à la tête de ses chasseurs repentants. L’excellente artillerie des Français força les Espagnols à se retirer sans avoir pu aborder le camp. Le général Flers se garda bien de les suivre dans la plaine; cette sagesse lui fut imputée à crime; accusé de lâcheté par les clubistes de Perpignan, il fut condamné à mort et exécuté.
Ce n’était pas assez pour la France d’avoir à lutter contre toute l’Europe; elle devait trouver dans son propre sein des ennemis plus redoutables encore, et les Vendéens la mirent à deux doigts de sa perte. Nous n’avons pas à apprécier la guerre de la Vendée au point de vue politique, mais dans une histoire militaire il est impossible de passer sous silence cette guerre dans laquelle les deux partis, si différents d’opinion et de sentiments, se signalèrent par un même courage, par un même dévouement à leurs causes respectives, par une même fidélité au drapeau, qu’il fût blanc ou tricolore. «La guerre de la Vendée, » a dit le général Foy, orateur et écrivain libéral, «a revêtu d’une splendeur incomparable quelques pages de notre histoire. On n’a vu nulle part ailleurs tant de noble vaillance et une pareille unanimité de dévouement.»
Tout en combattant l’armée française, les Vendéens déployèrent les mêmes qualités et les mêmes défauts; des deux côtés on vit des actes d’héroïsme sublime, des paniques incroyables et de nobles élans de générosité au milieu de représailles cruelles. Si les républicains eurent dans Carrier un proconsul cruel et farouche, Souchu fut un Carrier royaliste, et la grandeur d’âme de Marceau n’eut d’égale que la magnanimité de La Rochejaquelein. L’histoire a confondu les noms ennemis de Charette et de Hoche, de Kléber et de Bonchamp.
Chez les Vendéens comme chez les républicains, ou pour parler le langage d’alors, chez les blancs aussi bien que chez les bleus, les dissentiments et les jalousies des chefs compromirent plus d’une fois le succès des opérations. Les discordes de l’armée républicaine conduisirent à l’échafaud Biron et Duhoux; mais les dissensions des Vendéens amenèrent l’assassinat juridique de Marigny, fusillé sur l’ordre de Stofflet.
L’insurrection de la Vendée éclata le 12 mars, à Saint-Florent le Vieil, où les jeunes gens du pays et leurs parents étaient réunis pour le tirage au sort ordonné au sujet de la levée des 300,000 hommes. La foule se formait en rassemblements menaçants; la gendarmerie veut la dissiper, les paysans résistent; un coup de canon à mitraille est tiré sur eux; tête baissée, armés de leurs bâtons, ils s’élancent sur le canon et s’en emparent, chassent les autorités et brûlent les papiers de la ville.
Dès le lendemain, les insurgés avaient trois chefs: Cathelineau, un marchand de laines, Stofflet et Tonnelet, deux gardes-chasse; le rassemblement grossit, et chaque jour est marqué par un succès des paysans de l’Anjou. Le château de Jallais, Chemillé, Chollet, tombent successivement en leur pouvoir avec plusieurs pièces de canon.
Les gentilshommes du pays prennent la tète du mouvement. Le plus jeune des chefs vendéens, Henri de La Rochejaquelein, rassemble les paysans dé sa terre, des Aubiers, bat la colonne du général Quétineau, et se joint à deux chefs illustres, Bonchamp et Lescure, pour aller attaquer la ville de Thouars. La cavalerie vendéenne passe le Thouet à la nage et se porte sur le flanc de la division républicaine qui, après un combat acharné de dix heures, met bas les armes et se rend prisonnière.
Dans le Poitou, d’Elbée se met à la tète d’un fort rassemblement, se porte sur Fontenay et est repoussé par le général Chalbos: mais Bonchamp, La Rochejaquelein, Lescure, Cathelineau accourent à son aide, et la défaite des républicains est complète; ils perdent 42 canons. Bientôt 40,000 Vendéens, conduits par les mêmes chefs, attaquent Saumur, défendu par le général Menou, avec 11,000 hommes, dont 5,000 sont tués et blessés; les blancs restent maîtres de la ville et du château. C’est dans cette bataille que le général Coustard, ordonnant au commandant Weissen, de la légion germanique, de charger avec ses cuirassiers, Weissen lui demande: «— Où m’envoyez-vous? — A la mort,» répond Coustard, «le salut de la République exige ce sacrifice.» — Weissen part au galop et s’empare d’une batterie qui foudroyait l’armée républicaine; mais l’infanterie, fatiguée, refuse de le suivre, et il revient grièvement blessé avec une poignée de cavaliers; le reste a succombé.
Dans la basse Vendée, Charette, ancien officier de marine, celui de tous les chefs de la Vendée dont le nom est resté le plus populaire, a jusque-là combattu isolément; il consent à joindre son corps d’armée aux autres pour attaquer Nantes. A cette occasion, les chefs de l’insurrection conviennent de nommer un généralissime. C’est Cathelineau, le marchand de laine, qui obtient cet honneur.
Le général Canclaux, un officier de l’ancienne armée, commande à Nantes; il n’a, pour défendre cette grande ville ouverte, que 5,000 hommes de troupes de ligne et 5,000 gardes nationaux; autour de lui tout le monde parle d’abandonner la ville. Il tient bon, et, assisté du général Beysser, qui partage noblement sa résolution, il prend des mesures si habiles et si énergiques, que tous les efforts de Cathelineau avec la grande armée vendéenne sur la rive droite, de Charette et de son corps d’armée sur la rive gauche, viennent échouer devant une résistance opiniâtre. La mort de Cathelineau, frappé par une balle, décide la retraite des Vendéens.
Deux armées sont formées pour combattre l’insurrection: l’armée des côtes de Brest, commandée par Canclaux; celle des côtes de la Rochelle, qui a pour chef Biron, l’ancien duc de Lauzun, jeté par le dépit dans le parti de la Révolution. Westermann, qui commande l’avant-garde de Biron, vainqueur d’abord à Châtillon, est battu à plate couture, quelques jours plus tard, sur le même champ de bataille. Cette victoire éclatante des Vendéens détruit l’effet moral produit par la résistance de Nantes. Accusé à tort d’avoir fait incarcérer Rossignol, ancien ouvrier orfèvre, nommé colonel pour sa participation à l’émeute du 10 août, Biron, devenu suspect aux Jacobins, est rappelé à Paris, jugé, condamné et exécuté. On lui donne pour successeur le même Rossignol, ignorant, incapable et ivrogne. Les montagnards de la Convention accueillent la nouvelle de cette étrange nomination par des clameurs enthousiastes...
Telle était la situation de la France au moment où le second Comité de salut public et l’illustre Carnot allaient entrer en scène. Nous verrons dans le prochain chapitre comment notre pays sortit victorieux et fort de cette situation en apparence désespérée.