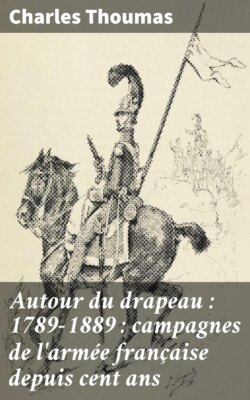Читать книгу Autour du drapeau : 1789-1889 : campagnes de l'armée française depuis cent ans - Charles Antoine Thoumas - Страница 15
WATTIGNIES, WISSEMBOURG ET TOULON
ОглавлениеLe deuxième Comité de salut public fut nommé le 10 juillet 1793. En se partageant les attributions, les membres de ce conseil reconnurent qu’aucun d’eux n’avait la compétence voulue pour régler les questions militaires, et, par une décision qu’on peut à bon droit qualifier d’heureuse, ils s’adjoignirent le 13 août deux officiers du génie, membres de la Convention, Carnot et Prieur, de la Côte-d’Or. Ceux-ci se mirent immédiatement à l’œuvre.
Le plus pressé était de porter l’effectif de l’armée au chiffre nécessaire pour soutenir la lutte. Carnot n’hésite pas à proposer la levée en masse, c’est-à-dire l’appel de tous les jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans, sans exception. Cette mesure est votée par la Convention dans sa séance du 23 août. Accueillie d’abord avec étonnement, elle est bientôt exécutée sans murmures. C’était un contingent de 450,000 hommes environ qui allait grossir l’armée; mais les bataillons formés avec ces nouvelles recrues n’avaient aucune consistance; leurs cadres étaient absolument ignorants des premiers éléments du métier militaire; aussi, dès leur arrivée aux armées, ces nouveaux venus furent-ils versés dans les, anciens bataillons de volontaires qui étaient destinés, d’ailleurs, à se fondre avec les bataillons de ligne.
Carnot eut encore une idée féconde en grands résultats. Les ennemis étaient nombreux et ils avaient pour eux la force que donne toujours le succès, mais ils étaient lents dans leurs mouvements, indécis et divisés entre eux. Au lieu de chercher à leur résister sur tous les points de la frontière, on décida de les attaquer vigoureusement sur quelques points bien choisis, et de rompre, par un effort grandiose, le cercle dont ils entouraient la France. Enfin, pour la réussite de ce plan, il était indispensable de remplacer les généraux ineptes mis à la tète des armées sous l’influence de l’esprit de parti, par des officiers capables, dont le mérite s’était affirmé à la guerre. Ce fut là le point le plus délicat de la tâche imposée à Carnot. Les événements montreront comment il s’en acquitta
Il ne suffisait pas d’avoir des hommes, de les encadrer et de leur donner des chefs capables; il fallait encore les habiller, les équiper, les pourvoir de munitions. La loi sur la levée en masse parait à cette nécessité, en obligeant les citoyens de tout âge et de tout sexe à concourir, par leur travail et leur fortune, à la défense nationale. Des ateliers d’armes, des fabriques de poudre et de canons furent improvisés; les chevaux nécessaires pour monter la cavalerie furent requis par l’intermédiaire des municipalités; on provoqua les dons patriotiques pour la fourniture des vêtements, du linge, des chaussures, etc. Prieur, de la Côte-d’Or, fut chargé, au Comité de salut public, de toute cette partie matérielle. Son activité égala celle de Carnot, et leurs noms sont restés associés dans l’histoire.
Les mesures prises, si énergiques qu’elles fussent, n’eurent cependant pas des effets immédiats. Il y eut même, après l’entrée de Carnot et de Prieur dans le Comité de salut public, une période pendant laquelle les revers l’emportèrent sur les succès, et la victoire ne revint que progressivement sous les drapeaux de la France.
Après la perte de Valenciennes, l’armée du Nord opéra sa retraite sur le camp de Gavarelle, situé entre Douai et Arras. C’est là que Houchard, nommé en remplacement de Custine, vint en prendre le commandement. Heureusement les alliés, au lieu de marcher sur Paris, dont la route leur était ouverte, voulurent assiéger Dunkerque, convoitée par l’Angleterre. Le duc d’York, avec les Anglais et les Hanovriens, fut chargé de cette opération, tandis que le prince de Cobourg, avec le reste de l’armée, bloquait le Quesnoy et Landrecies, tout en menaçant Maubeuge.
La lenteur du duc d’York permit à Houchard d’arriver à temps pour secourir Dunkerque, conformément aux injonctions du Comité de salut public et aux instructions de Carnot.
Le siège était couvert à Ost-la-Chapelle par le maréchal de Freytag avec 16,000 hommes, et à Menin par le prince d’Orange avec 15,000 autres. 32,000 Anglais se trouvaient devant Dunkerque même; Houchard, renforcé par 15,000 hommes tirés des armées du Rhin et de la Moselle, vint attaquer le 6 septembre les avant-postes de Freytag. Le combat dura trois jours. Ce ne fut pas à proprement parler une bataille, mais une série d’engagements dans lesquels la valeur des soldats joua un plus grand rôle que les combinaisons du général Houchard, bon officier de partisans, dépourvu des talents nécessaires pour commander en chef. Il encourut un premier reproche, le 6 septembre, en ordonnant la retraite après les succès de la division Jourdan.
Le 7, l’attaque se prononce contre le village de Hondschoote; elle échoue devant la ferme contenance de l’ennemi. Houchard, découragé, veut renoncer à l’offensive. Sur les instances de son état-major et des commissaires de la Convention, il entame le 8 une action générale, ses tirailleurs occupent les taillis de Hondschoote et déciment à coups de fusil les défenseurs du village. Jourdan, Vandamme, Colaud, les représentants Levasseur et Delbrel, le sabre en main, se mettent en tète des colonnes d’attaque; Houchard lui-même entraîne un régiment de cavalerie tenu en réserve; tous entonnent la Marseillaise et le chant de la Carmagnole. En même temps une partie de la garnison de Dunkerque, habilement conduite par Hoche, tombe sur les derrières des Anglais; toutes les positions sont enlevées. Houchard n’ose pas poursuivre les ennemis; mais le duc d’York, craignant de voir son armée coupée en deux, lève précipitamment le siège de Dunkerque.
La Convention décréta que l’armée du Nord avait bien mérité de la patrie; mais quelques jours après, une déroute partielle, occasionnée par l’apparition subite de l’ennemi, servit de prétexte au Comité de salut public pour faire arrêter Houchard, coupable d’avoir vaincu malgré lui, et de n’avoir pas su profiter de sa victoire. Comme son prédécesseur Custine, il fut condamné à mort et exécuté.
Cependant la place du Quesnoy s’était rendue au prince de Cobourg, qui n’attendait plus que la chute de Maubeuge pour marcher sur Paris. Cette place était défendue, non seulement par sa garnison, mais par un corps d’armée de 20,000 hommes campé sous ses murs. Ainsi que nous l’avons déjà fait observer à propos de Mayence, c’était trop peu pour tenir la campagne et beaucoup trop pour les approvisionnements de la place. Ces 20,000 hommes ne se laissèrent pourtant pas renfermer facilement dans le camp retranché ; il y eut autour de Maubeuge plusieurs combats des plus vifs; mais enfin le nombre l’emporta: la place et le camp furent étroitement bloqués, et Maubeuge ne dut compter pour son salut que sur les secours extérieurs. Ces secours ne lui firent pas défaut.
Jourdan, signalé pour sa belle conduite à Hondschoote, venait d’être appelé au commandement de l’armée du Nord; il reçut l’ordre de réunir toutes ses troupes éparses dans plusieurs camps, d’y joindre les renforts venus de l’armée des Ardennes, et de marcher contre le prince de Cobourg avec 50,000 hommes. Le prince en avait 80,000, mais l’équilibre devait être rétabli, pensait-on, par l’intervention des 20,000 hommes du camp retranché.
Carnot vint en personne assister Jourdan de ses conseils; l’armée fut réunie à Guise et mise en route le 10 octobre; le 14, les avant-gardes se rencontrent et se canonnent sans aucun résultat; l’attaque des positions ennemies est résolue pour le lendemain. Ces positions étaient formidables, tant par le relief et les escarpements du terrain, que par les nombreuses batteries étagées en amphithéâtre qui couvraient son front et les redoutes sur lesquelles s’appuyaient ses défenseurs.
Les colonnes françaises, précédées et flanquées de nombreux tirailleurs, suivant la nouvelle tactique, marchent résolument sur les retranchements ennemis à travers une grêle de boulets et d’obus. Arrivés au pied des escarpements, accueillis par une décharge meurtrière de mitraille, les soldats de Jourdan s’élancent à la baïonnette. Pendant trois heures on se bat avec acharnement. Deux fois les Français pénètrent dans les redoutes, deux fois ils en sont chassés; la nuit vient, Jourdan remet l’attaque décisive au lendemain, et les deux armées bivouaquent sur le champ de bataille.
Le 16 au matin, les Français, favorisés par un brouillard épais, prennent de nouvelles dispositions. Une nombreuse artillerie couronne les hauteurs dont Jourdan s’était emparé la veille; des batteries légères accompagnent les colonnes d’attaque, et, démasquées à propos, portent le désordre dans les rangs des Autrichiens. Le centre, conduit par le général Du-quesnoy, s’empare des hauteurs qui lui font face et en tourne l’artillerie contre le camp de Wattignies, qui est ainsi presque pris en flanc, tandis que Carnot et Jourdan l’attaquent de front avec les colonnes de droite. Saisissant le moment favorable, ils enlèvent leurs troupes et entrent en vainqueurs dans le camp. Les Autrichiens battent en retraite.
L’effet moral de cette victoire en dépassa les résultats matériels, qui auraient pu être décisifs si les troupes du camp retranché avaient fait une sortie; mais ces troupes ne bougèrent pas. Carnot s’en plaignit dans son rapport, et Chancel, un vieil et brave général qui commandait le camp, fut arrêté et condamné à mort, quoique seul, dans le conseil de défense, il eût opiné pour la sortie, et soutenu énergiquement son opinion. La victoire de Wattignies permit à l’armée du Nord de se reconstituer tranquillement, mais l’armée autrichienne ne fut pas poursuivie.
Le Comité de salut public, contrairement à l’avis de Carnot, prescrivit à Jourdan de. se porter en avant pour envahir la Belgique; Jourdan objecta les difficultés de l’opération et faillit être arrêté à son tour; le titre de vainqueur de Wattignies le protégea, et il fut seulement mis à la retraite, d’où heureusement il ne devait pas tarder à sortir.
La Vendée n’était pas le seul point du territoire français où la guerre civile exerçât ses ravages. Lyon, la seconde ville dû pays, s’était déclarée ouvertement contre la Convention, dont elle avait chassé les représentants. 25,000 de ses citoyens formaient, sous les ordres de M. de Précy, ancien officier supérieur, une armée résolue à se défendre vigoureusement.
Kellermann reçut l’ordre de marcher sur Lyon avec la majeure partie de l’armée des Alpes, à laquelle se joigirent les gardes nationales des départements voisins. La ville rebelle fut ainsi investie par 60,000 hommes, dont 15,000 de troupes régulières avec 100 pièces de canon.
Le siège fut mené d’abord avec lenteur par Kellermann, qui espérait réussir par la voie de la conciliation; mais ce général fut bientôt rappelé en Savoie par les progrès de l’armée piémontaise, cherchant à opérer une diversion en faveur des Lyonnais; il battit cette armée à Saint-Maurice.
Pendant son absence, le commandement fut exercé par Doppet, ancien médecin, général révolutionnaire d’une incapacité notoire; mais les opérations du siège furent en réalité conduites avec talent par le conventionnel Dubois-Crancé, ancien officier.
Le 9 octobre, après un violent bombardement qui réduisit en cendres le beau quartier de Bellecour, les troupes républicaines prirent possession de la ville. Kellermann, accusé de mollesse vis-à-vis des insurgés de Lyon, fut arrêté et incarcéré. Sa mise en jugement ne fut ordonnée qu’après la chute de Robespierre, et, plus heureux que les autres généraux du début de la Révolution, il ne subit ni l’exil ni l’échafaud.
Le général Brunet, brave soldat qui avait succédé à Anselme dans le commandement de l’armée du Var, n’eut pas la même chance. Forcé par les commissaires de la Convention, malgré ses observations, d’attaquer avec des troupes démoralisées la position de Saorgio, il échoua et paya de sa tête la panique de ses soldats, ainsi que l’erreur des représentants du peuple.
Des événements plus graves s’étaient passés dans le Midi. A la nouvelle du soulèvement des Lyonnais, les royalistes de Marseille s’étaient réunis en armes pour marcher à leur secours. Leur rassemblement, grossi en route des citoyens de plusieurs autres villes, arrêté un instant par les patriotes avignonnais au passage de la Durance, avait poursuivi sa route jusqu’à Orange, où il rencontra le général révolutionnaire Carteaux, envoyé au devant des insurgés avec une division de l’armée des Alpes. Les royalistes furent battus, poursuivis, et battus de nouveau le 24 août, sur les hauteurs de Septêmes. Les troupes républicaines firent une entrée triomphale dans Marseille, où de sanglantes exécutions marquèrent la victoire de la Convention.
A cette nouvelle, les habitants de Toulon, qui s’étaient joints aux Marseillais, voulant éviter le même sort, proclamèrent Louis XVII roi de France et ouvrirent leur port à l’escadre anglo-espagnole, devenue ainsi maîtresse du plus grand arsenal de la marine française.
Le coup était terrible pour la Convention; elle ne se découragea pas. Une armée fut organisée pour la reprise de Toulon. Le général Carteaux, ancien peintre, dépourvu de toute intelligence des choses de la guerre, en fut nommé le commandant en chef, grâce à l’influence du parti jacobin. Bonaparte, alors chef de bataillon, fut désigné pour diriger l’artillerie du siège. Il arriva au camp le 11 septembre, et trouva pour toutes ressources: deux batteries à pied de campagne, trois batteries à cheval et huit canons de 24. Il s’occupa de former un équipage de siège, et, en moins de six semaines, 100 bouches à feu de gros calibre et des mortiers à grande portée étaient réunis avec les approvisionnements nécessaires.
Comme il n’y avait pas d’officier du génie dans l’armée, Bonaparte cumula les fonctions d’ingénieur avec celles d’officier d’artillerie; il gagna par son activité et son sang-froid la confiance de toute l’armée, et le 14 octobre les assiégés ayant fait une grande sortie, tous les soldats réclamèrent à grands cris Bonaparte pour les commander et repousser l’ennemi.
L’inepte Carteaux voulut ressaisir son autorité, mais il prit des mesures si ridicules, que les commissaires de la Convention n’hésitèrent pas à le faire destituer. Le successeur qui lui fut donné ne valait pas mieux; Carteaux avait été peintre, Doppet était médecin. Son incapacité absolue éclate dès le premier jour. Bonaparte lui ayant persuadé qu’il fallait attaquer le fort Musgrave, il autorise cette attaque, et au moment où elle allait réussir, il envoie de son quartier général, d’où il n’avait pas bougé, l’ordre impératif de battre en retraite. Les troupes indignées reculent, et Bonaparte légèrement blessé, l’oeil enflammé de colère, se précipite au devant du général en chef en s’écriant: «Le jean-f.... qui a ordonné la retraite nous a fait manquer la prise de Toulon.»
Cette fois, Doppet est remplacé par un des meilleurs généraux qu’ait eus la République, Dugommier, qui accorde toute sa confiance à Bonaparte. Une brillante attaque, dans la nuit du 25 au 26 novembre, dirigée par Dugommier et Bonaparte, les rend maîtres du fort du petit Gibraltar, la clef de la rade de Toulon. L’armée anglo-espagnole veut le reprendre, elle est battue et forcée de se rembarquer. L’ennemi se décide alors à évacuer Toulon, mais avant dé s’éloigner, il met le feu à l’arsenal et incendie dans le port 9 vaisseaux de haut bord avec 4 frégates. Enfin, le 17 décembre, à dix heures du soir, les troupes françaises entrent dans Toulon et courent immédiatement à l’arsenal, où 800 galériens travaillaient depuis plusieurs heures à éteindre l’incendie. Une. partie des richesses que renfermait ce bel établissement fut ainsi arrachée aux flammes.
Par un décret en date du 24 décembre, la Convention déclara que l’armée dirigée contre Toulon avait bien mérité de la patrie; une fêté nationale fut instituée pour célébrer cet événement. Bonaparte fut nommé général de brigade.
Fermons les yeux sur les vengeances exercées dans la malheureuse ville de Toulon par la Convention triomphante.
Nulle part, pendant cette fin de l’année 1793, la lutte ne fut plus sanglante et-plus acharnée que dans la Vendée. La manière de combattre des paysans de l’armée royaliste convenait admirablement à leur pays, coupé de haies et couvert d’arbres; en plaine, ils perdaient tous leurs avantages. La désunion des chefs causa aussi plus d’une fois leur défaite. Tandis que d’Elbée, nommé généralissime après la mort de Cathelineau, et Charette, voulaient porter la guerre en Poitou, Bonchamp et le prince de Talmont projetaient de passer la Loire pour faire soulever la Bretagne: Ils se séparèrent. Charette et d’Elbée marchèrent sur Luçon et engagèrent, le 10 août, la bataille contre les troupes du général Tuncq. Celui-ci les battit complètement, grâce à d’habiles manœuvres et à l’emploi judicieux de son artillerie légère, qui dans ce pays de plaine étonna les Vendéens. Ceux-ci éprouvèrent rarement, pendant toute la guerre, un échec aussi complet. Par contre, la déroute de Coron, occasionnée le 18 juillet par l’impéritie de Santerre, l’ancien brasseur du faubourg Saint-Antoine, devenu général après avoir commandé la garde nationale de Paris, fut des plus honteuses pour l’armée républicaine.
Le combat de Beaulieu, livré le 19 septembre, donna ce spectacle tout naturel dans une guerre civile, de deux proches parents, l’oncle et le neveu, à la tète des deux armées opposées l’une à l’autre. Le général Duhoux et les troupes républicaines furent battues par les Vendéens que commandait le chevalier Duhoux. Le vaincu, accusé de s’être entendu avec le vainqueur, fut traduit en jugement et condamné à mort.
L’arrivée des troupes de la garnison de Mayence vint relever en Vendée le prestige des armées républicaines.
Les Mayençais, comme on les appelait, débutèrent cependant par une défaite. Canclaux, sous les ordres duquel ils avaient été placés, ayant combiné une opération d’ensemble pour écraser les Vendéens, les colonnes que devait fournir l’armée des côtes de la Rochelle manquèrent au rendez-vous. Kléber, laissé seul, fut attaqué le 19 septembre à Torfou par toutes les forces catholiques réunies. La résistance fut d’abord couronnée de succès. Bonchamp, voyant fuir les soldats de Charette, mit pied à terre et s’écrie: «N’y a-t-il donc pas parmi vous 400 braves pour mourir avec moi?» Il s’en présente 1,500 avec lesquels Bonchamp rétablit le combat. Kléber, grièvement blessé, se vit forcé d’ordonner la retraite, qui se fit dans un ordre parfait sur une distance de six lieues.
C’est dans cette retraite que, prescrivant au commandant Schouardin, du bataillon de chasseurs de Saône-et-Loire, de défendre le pont de Clisson sur la Sèvre, avec son bataillon et deux pièces de canon, Kléber lui dit: «Faites-vous tuer là avec votre troupe! — Oui,» répondit simplement le commandant, et il se fit tuer avec 100 de ses hommes, permettant à l’armée de Kléber, par son dévouement, d’échapper à une perte complète.
Ce triomphe des Vendéens eut peu de lendemains. Canclaux fut destitué comme noble, le lendemain du jour où il avait battu Bonchamp, et remplacé à la tête de l’armée des côtes de Brest par l’inepte Léchelle; mais Kléber avec ses Mayençais, Westermann avec les troupes de l’armée de la Rochelle, poursuivirent sans relâche les divisions de Bonchamp, de d’Elbée, de La Rochejaquelein et de Lescure. Les défaites successives de la Tremblaye, de Chollet, de Beaupréau, la mise hors de combat de d’Elbée, de Bonchamp, de Lescure, blessés mortellement, semblèrent rendre la cause royale absolument désespérée. Acculés à la Loire, près de Saint-Florent, les Vendéens, au nombre de 80,000, hommes, enfants, vieillards et femmes, passèrent sur la rive droite, où la prévoyance de leurs chefs leur avait ménagé le poste de Varades. Con. duits par Henri de La Rochejaquelein qui, malgré son extrême jeunesse, avait été proclamé généralissime après d’Elbée et Bonchamp, ils occupèrent successivement Château-Gontier, Laval, Ernée, Fougères, infligèrent aux républicains la défaite sanglante d’Eutrames, et vinrent mettre le siège devant Granville, où ils espéraient voir débarquer, lorsqu’ils seraient maîtres du port, un prince de la maison royale.
La résistance énergique des habitants ruina ce projet. L’armée vendéenne fut forcée de battre en retraite; les soldats demandaient avec instance à être ramenés dans leur pays.
Victorieuse d’abord à Pontorson et à Antrain, cette armée fut enveloppée au Mans, le 12 décembre, par Kléber, Marceau et Westermann. Malgré les. prodiges de valeur de La Rochejaquelein, la déroute des royalistes fut affreuse, 10 ou 12,000 Vendéens y périrent avec la plupart des chefs. Poursuivie jusqu’à Savenay, l’armée royaliste y trouva sa fin. Luttant avec le courage du desespoir, foudroyés par l’artillerie de Kléber, sabrés par la cavalerie de Westermann, écrasés par le nombre sans cesse croissant des soldats de Marceau, ses derniers combattants se dispersèrent dans tous les sens. La Rochejaquelein et Stofflet, son major général, se jetèrent dans une petite barque et traversèrent la Loire en fugitifs. L’armée vendéenne avait vécu, mais la Vendée vivait encore, et la lutte devait continuer, tout en prenant un nouveau caractère.
Il nous reste à parler des armées de la Moselle et du Rhin. La première s’était emparée, le 9 juin, de la ville d’Arlon, après un brillant combat; depuis lors elle était passée sous les ordres du général Moreaux, excellent officier, souvent confondu à tort avec le célèbre Moreau. Ce général se tenait sagement sur la défensive, occupé de l’instruction et de la discipline de ses troupes. En le forçant, malgré ses observations, d’attaquer les Prussiens dans la forte position de Pirmasens, protégée par plus de 100 pièces de canon, les commissaires de la Convention lui firent éprouver un sanglant échec.
L’armée du Rhin s’était retirée, comme nous l’avons vu, derrière les lignes de Wissembourg. Les généraux s’y succédaient, nommés un jour, destitués le lendemain. Le chef d’escadron Carleng, commandant un dépôt de dragons, appelé à l’armée, y devient en vingt-quatre Heures, par l’influencé des Jacobins, général de brigade, général de division et commandant en chef. Pendant qu’il s’amuse à faire promener ses bataillons de la gauche à la droite et de la droite à la gauche pour régulariser, dit-il, leur ordre de bataille, les alliés se préparent à forcer les lignes de Wissembourg.
Dans la nuit du 12 au 13 octobre, le prince de Waldeck franchit le Rhin au-dessus de Lauterbourg et s’empare de Seltz, en arrière des lignes; Wurmser attaque ces lignes avec cinq colonnes; les redoutes du Bienwald sont emportées. Les émigrés, conduits par le prince de Condé, s’élancent intrépidement sur les retranchements de Bergzabern, s’en emparent, y prennent 17 canons et forcent les républicains à évacuer Wissembourg. En même temps Brunswick, s’avançant par Lembach, à travers les défilés des Vosges, menace de prendre à revers la gauche des Français. Sur ce point seulement, Desaix et Ferrière soutiennent la retraite avec honneur; partout ailleurs, les troupes reculent en désordre. L’armée s’établit entre Strasbourg et Saverne.
A ces nouvelles, la consternation est générale en France; on croit déjà voir Landau, étroitement bloquée depuis le mois d’avril, tomber au pouvoir des coalisés. Le Comité de salut public veut à tout prix dégager cette place. Hoche, signalé par sa conduite à Dunkerque, est appelé au commandement en chef de l’armée de la Moselle, où sont envoyés les deux-représentants Lacoste et Baudot. L’armée du Rhin est donnée à Pichegru, qui s’est distingué dans le nord et qui est appuyé par les conventionnels Saint-Just et Lebas. Les deux armées doivent combiner leurs mouvements. C’est à Hoche qu’est réservé l’honneur de porter les premiers coups. D’après le plan convenu, il attaque, le 28 novembre, les Prussiens du duc de Brunswick, fortement établis à Kayserslautern; après trois jours de combats, soutenus de part et d’autre avec acharnement, il est réduit à reculer. Aux reproches que lui adressent alors les représentants du peuple, il répond en souriant: «Que ne prenez-vous un arrêté pour fixer la victoire?... Cessez de vous inquiéter; je puis prendre d’autres mesures, mais il faut me laisser agir.»
Hoche ne se tient pas pour battu. Malgré la rigueur de la saison, il traverse les Vosges par la route de Bitche, et se présente, le 21 décembre, devant les retranchements occupés, sur les hauteurs de Frœschwiller et de Wœrth, par le corps prussien de Hotze, et protégés par un triple rang de batteries. Les troupes hésitaient: «Camarades», s’écrie Hoche en parcourant les rangs, «à six cents livres les canons prussiens!» — «Adjugé !» répondent les soldats, et ils s’élancent; la première ligne d’ouvrages est franchie à travers une grêle de boulets, d’obus et de balles; les redoutes sont enlevées à la baïonnette; tous les obstacles sont renversés; l’ennemi se retire sur la hauteur.
Les deux armées de la Moselle et du Rhin étant alors réunies, Hoche est investi du commandement supérieur par les commissaires de la Convention. Il donne, le 26 décembre, le signal d’attaquer l’ennemi sur toute la ligne, et pour stimuler l’ardeur des troupes, il met à l’ordre la nouvelle de la prise de Toulon, qui vient de lui parvenir. Le château de Geisberg, le camp situé en arrière sur la hauteur sont successivement occupés. Les alliés, mécontents les uns des autres, abandonnent les lignes de Wissembourg. Hoche marche le 27 sur Landau, où les troupes françaises font leur entrée au milieu des transports d’enthousiasme. Le même enthousiasme éclate dans toute la France à la nouvelle de la victoire qui clôt si glorieusement la rude campagne de 1793.
Sur la seule frontière d’Espagne, les Français n’ont pas eu l’avantage. Dans les Pyrénées occidentales les deux partis ont conservé leurs positions respectives, mais dans les Pyrénées orientales, malgré quelques succès partiels obtenus par le vieux général Dagobert, la situation est plus mauvaise. Vainqueurs dans la sanglante bataille de Truillas et dans le combat de Céret, les Espagnols, admirablement commandés par le général Ricardos, se sont emparés du fort Saint-Elme, de Port-Vendres et de Collioure.
Dans le comté de Nice, Masséna avait, le 24 novembre, livré aux austro-sardes le brillant combat de Castel-Gineste et repoussé le corps d’armée qui menaçait la frontière du Var.