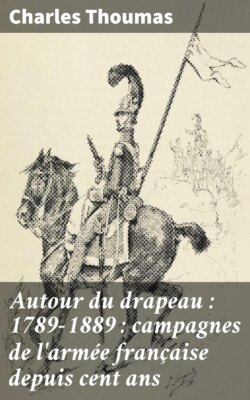Читать книгу Autour du drapeau : 1789-1889 : campagnes de l'armée française depuis cent ans - Charles Antoine Thoumas - Страница 21
AMSTERDAM ET LOANO
ОглавлениеLa fin de la campagne de 1794 peut être regardée comme marquant l’apogée de l’armée de la République, non seulement à cause d’un ensemble de victoires qui ne se retrouvera plus dans les campagnes suivantes, mais surtout pour les vertus militaires engendrées par le patriotisme, vertus qui ne seront que trop vite altérées par les jouissances de la conquête et les calculs de l’ambition personnelle. Les généraux qui nous ont légué dans leurs écrits le souvenir de cette grande époque, Gouvion-Saint-Cyr, Soult, Foy, Pelleport, etc., sont unanimes à le constater.
La discipline, et nous n’entendons pas exprimer seulement par ce mot l’obéissance des subordonnés à leurs chefs, mais surtout le respect des propriétés et des personnes en pays ennemi, cette discipline, établie par les mesures les plus rigoureuses, facilement entretenue par le bon esprit de la jeunesse appelée sous les drapeaux par la levée en masse, ne laissait rien à désirer. On a souvent cité comme exemple les grenadiers de la colonne infernale de Latour-d’Auvergne, campés dans les vergers de la Biscaye, et ne cueillant pas un fruit sur les arbres qui les abritaient. La garnison de Saint-Sébastien n’avait pour toute nourriture, pendant l’hiver de 1794 à 1795, que du riz en quantité insuffisante, tandis qu’aux devantures des boulangeries s’étalaient les pains les plus appétissants: pas un de ces pains ne fut dérobé... «Jamais», dit le maréchal Soult dans ses Mémoires, «les armées n’ont été plus obéissantes et animées de plus d’ardeur.» Sur la table du général en chef lui-même, au dire du général Foy, il ne paraissait pas d’autre pain que le pain du soldat, pas d’autre viande que la viande de distribution... A propos du blocus de Mayence, dont nous allons parler, Gouvion-Saint-Cyr fait remarquer que des souffrances inouïes, comparables à celles de la retraite de Russie, furent admirablement supportées par les troupes qu’animait alors le plus pur patriotisme.
La campagne de 1795 vit se dissoudre la coalition formée contre la France après la mort de Louis XVI. Depuis le début de la guerre, Autrichiens et Prussiens s’étaient rarement entendus. Des questions étrangères à la Révolution française divisaient leurs gouvernements, et plus d’une opération manquée avait donné lieu à des récriminations entre leurs généraux. La Prusse trouvait que l’Autriche ne fournissait pas à la coalition un appoint proportionné à sa puissance militaire et se plaignait avec raison d’avoir supporté les principaux efforts de la lutte. Déjà, pendant la dernière partie de la campagne de 1794, ses armées avaient observé une sorte de neutralité. Le roi Frédéric-Guillaume désirait évidemment la paix. Instruite de ce désir par la démarche autorisée d’un citoyen allemand, la Convention fit faire des ouvertures au Gouvernement prussien par l’intermédiaire de la Suisse. Ces ouvertures ayant été bien accueillies, les négociations se poursuivirent à Bâle, où le traité de paix fut signé le 5 avril. Aux termes de ce traité, les troupes de la République devaient occuper les Etats prussiens situés sur la rive gauche du Rhin.
Quelques jours plus tard, la Suède, la Toscane et la République de Venise accréditèrent des ministres auprès de la Convention. Quant à l’Espagne, son désir de conclure la paix était évident: à l’époque où Dugommier surveillait le blocus de Bellegarde, un trompette espagnol lui apporta une dépêche qu’il ouvrit devant les représentants du peuple. Cette dépêche, relative à la solde des prisonniers de guerre français, renfermait dans la première enveloppe un second pli cacheté ; Dugommier l’ouvrit aussi et y trouva une petite branche d’olivier, que les Commissaires de la Convention envoyèrent avec l’enveloppe au Comité de salut public.
La paix avec l’Espagne devait cependant être encore précédée de nombreux faits de guerre. Cette fois, les coups les plus sensibles à la cour de Madrid lui furent portés par l’armée des Pyrénées occidentales. Cependant, les troupes qui faisaient partie de cette armée, demeurées oisives dans de mauvais cantonnements, souffrirent beaucoup pendant l’hiver de 1794 à 1795, le plus rigoureux du siècle,- tandis que les Espagnols, se reposant dans leurs quartiers, vivaient dans l’abondance et n’avaient pas de malades. Malgré cette cause d’infériorité, et malgré quelques échecs partiels, l’armée française résista aux attaques de l’ennemi, et quand vint la belle saison, quand les corps de troupe eurent été réorganisés, Moncey, qui commandait encore cette armée, se porta résolument en avant, pénétra dans la Biscaye et dans le Guipuzcoa, et s’empara de Bilbao et de Vittoria; il s’établit ensuite à Miranda sur l’Èbre, où la nouvelle de la paix vint le trouver.
L’armée des Pyrénées orientales, toujours sous les ordres du général Pérignon, continua de se battre tout l’hiver et souffrit beaucoup moins de la mauvaise saison. Laissant Augereau à la garde de Figuières, Pérignon investit la place maritime de Roses. Cette place était protégée par une flotte espagnole à l’ancre dans sa rade, comprenant 13 vaisseaux et 45 bombardes; elle était couverte par le fort du Bouton-de-Rose qui, dominant tous les travaux des assiégeants, opposait à ces travaux un obstacle invincible. Il fallait donc, avant tout, s’emparer de ce fort. Pérignon donna l’ordre d’installer plusieurs batteries sur le plateau qui couronnait le Puig-Bon, à 4,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. — «C’est impossible,» objectèrent les ingénieurs. — «Eh bien! c’est l’impossible que je veux,» répliqua Pérignon. En moins de six jours, un chemin fut taillé dans le flanc de la montagne, les soldats y montèrent les canons à la prolonge, et bientôt trois batteries, armées ensemble de 12 canons, 14 obusiers et 8 mortiers, commencèrent le feu. Sous cette violente canonnade, les troupes qui occupaient le fort du Bouton s’empressèrent d’évacuer la place en s’embarquant sur des chaloupes.
Excités par l’exemple de Pérignon, les soldats supportaient avec constance toute la rigueur de la saison. Bientôt, la terre durcie par la gelée ne se prêta plus aux travaux des tranchées, et les officiers du génie eux-mêmes demandèrent l’attaque de vive force. «Qu’on se prépare!» dit alors Pérignon, «je serai demain à la tête des grenadiers.» Le lendemain, en effet, tous les ouvrages avancés furent enlevés sous une grêle de boulets et d’obus. Le feu des batteries de siège redouble alors d’intensité ; 3,000 échelles sont apportées de Figuières pour l’assaut définitif. Le gouverneur, jugeant qu’une plus longue résistance n’était pas possible, s’embarque pendant la nuit avec toute la garnison, laissant dans la place une arrière-garde de 300 hommes qui devaient s’embarquer les derniers; mais, dans le trouble de la fuite, ces 300 hommes sont oubliés. Se voyant abandonnés par la flotte qui s’éloigne du port, ils arborent le drapeau blanc et se rendent à discrétion.
Après avoir été l’objet d’un décret flatteur de la Convention pour cette importante conquête, Pérignon, qui depuis le début de la guerre servait dans l’armée des Pyrénées orientales, est remplacé par le général Schérer qui commet faute sur faute. L’armée se maintient cependant sur la défensive. Le traité conclu à Bâle, le 22 juillet, met fin à la guerre. La satisfaction causée par cette paix fut si grande en Espagne, que le premier ministre Godoï reçut du roi le titre de Prince de la Paix, sous lequel il est resté connu dans l’histoire.
Cependant la guerre civile tendait à s’éterniser dans l’Ouest. Après la chute de Robespierre et du Comité de salut public, le commandement en chef de l’armée des côtes de l’Ouest avait été rendu à Canclaux, renommé pour sa sagesse et sa modération. Deux des chefs de l’insurrection primitive, Charette en basse Vendée, Stofflet dans la haute Vendée, restaient seuls en armes, rivalisant de férocité avec les plus cruels représentants de la Convention, ennemis l’un de l’autre autant que de la République et s’étant voué réciproquement une haine mortelle. Canclaux, porté aux voies pacifiques, entame avec Charette des négociations qui aboutissent au traité de la Jaunais, signé le 17 février 1795 et auquel Stofflet refuse d’adhérer. Charette, qui n’a consenti à la paix que pour renouveler ses forces en vue d’une guerre plus acharnée que jamais, est reçu triomphalement dans la ville de Nantes par Canclaux et par la population. Stofflet, vivement poursuivi par les troupes républicaines qui s’emparent du château de Maulevrier, sa résidence, conclut à son tour la paix, à l’instigation du célèbre curé Bernier.
La Bretagne se prépare à remplacer la Vendée dans sa lutte contre la République. Les Chouans, partisans audacieux répartis dans les départements du nord-ouest, sont organisés en une vaste association sous la direction d’un habile intrigant, M. de Puysaye. Disciplinés par lui, ils observent une tranquillité trompeuse. Hoche, sorti de prison après le 9 thermidor, est nommé au commandement des armées réunies des côtes de Cherbourg et de Brest; il s’y rend et proclame l’amnistie. Tout à coup il apprend qu’une escadre anglaise a débarqué, dans l’étroite presqu’île de Quiberon, une armée d’émigrés qui s’est emparée du fort de Penthièvre.
Réclamant des secours de Canclaux et d’Aubert-Dubayet, qui commandaient à Nantes et à-La Rochelle, il marche sur Quiberon, où l’armée royale est détruite dans une des plus sanglantes catastrophes dont l’histoire de nos guerres civiles fasse mention. Hoche est alors investi du commandement en chef des quatre armées de Bretagne et de Vendée qui, réunies en une seule, prennent le nom d’armée de l’Ouest. La Vendée se soulève de nouveau; Charette surprend aux Essarts un des camps républicains; Stofflet refuse de participer à cette levée de boucliers, puis prend les armes pour son compte; il tombe au pouvoir des républicains, qui le fusillent à Angers. Charette, vivement pressé, est pris par le général Travot; conduit à Nantes, où cette fois il entre en captif, il y est fusillé solennellement le 29 mars 1796. Hoche se consacre alors tout entier à la pacification de la Vendée.
Nous avons laissé l’armée du Nord sur les frontières de Hollande, où elle semblait devoir prendre ses quartiers d’hiver, lorsqu’apprenant que le Wahal est complètement gelé, Pichegru revient se mettre à la tête de ses troupes, franchit le Wahal et s’empare de la place d’Heuden. Les anglo-hanovriens, effrayés de cette marche des Français, n’essaient même plus de leur résister. Craignant d’être tourné, le général Walmoden, qui les commande, découvre la Hollande par un changement de front en arrière. Rien ne s’oppose plus à la conquête de ce riche pays. Le stathouder, prince d’Orange, s’embarque pour l’Angleterre, après avoir recommandé à ses partisans de ne pas opposer aux Français une résistance désormais inutile.
Dès lors, ce n’est plus une conquête, mais l’occupation pacifique d’un pays qui se livre et accueille, avec tout l’enthousiasme dont est susceptible son peuple flegmatique, ses vainqueurs, ou plutôt ses libérateurs, car il y a, en Hollande, tout un parti qui répudie les anciennes institutions dès Provinces-Unies. Le 19 janvier, Utrecht est occupée par les troupes françaises, après une capitulation signée par les Commissaires de la Convention; enfin, le 20, Pichegru et les représentants du peuple entrent triomphalement dans Amsterdam, à la tête d’une division, aux cris de: Vive la France! Vive Pichegru! Cette entrée est restée célèbre dans l’histoire à plus d’un titre. Elle fut remarquable surtout par un contraste éclatant entre la superbe attitude des troupes, leur discipline irréprochable, et la misère des soldats accusée par les vêtements en lambeaux, les pieds sans chaussures, enveloppés dans des chiffons, et plus encore par les figures hâves et décharnées.
Rien n’avait été préparé pour leur logement: ils attendirent pendant plusieurs heures, serrés autour de leurs drapeaux, rangés en bon ordre sur les places publiques de la ville, calmes et dignes, sans proférer une plainte, sans donner un signe d’impatience. Nous verrons plus tard des entrées triomphales dans Berlin, dans Posen, dans Varsovie, dans Madrid, dans Moscou, l’armée de l’Empire y briller de toute sa splendeur, mais rien n’effacera pour nous le souvenir de ces héros déguenillés, aussi fiers, dans les rues d’Amsterdam, de leur constance au milieu des misères et des privations, que de la valeur déployée par eux dans les combats.
Pendant que Pichegru entrait dans Amsterdam, la division Bouneau s’emparait de Gertruydenberg, traversait sur la glace le bras de mer de Bies-Bosch, et prenait possession du bel arsenal de Dordrecht. Le général en chef et les Commissaires de la Convention venaient ensuite occuper Rotterdam et La Haye, où les représentants du peuple s’installaient dans le somptueux palais du prince d’Orange.
Restaient à conquérir les provinces de Zélande, de Frise et de. Groningue.
Les délégués de la Zélande concluent,, avec le général Michaud, une convention particulière. Pichegru marche alors sur Groningue et s’en empare, les dernières troupes anglaises qui tiennent encore sont tournées par la Westphalie; leur retraite devient une fuite. L’armée du Nord peut enfin se reposer: la Hollande est conquise. Mais le gouvernement de la Convention laisse à ce pays toute son indépendance; une République batave est fondée, à l’instar de la République française, et unie à elle par un traité d’alliance aux termes duquel la France met au service de la Hollande un corps auxiliaire de 30,000 hommes, et la Hollande livre aux troupes françaises les places de la Meuse et du Rhin.
Ce n’était pas assez pour l’armée du Nord d’avoir conquis le sol de la Hollande: la flotte batave tombe entre ses mains; et, fait unique dans les annales de l’histoire, cette capture importante est due à quelques escadrons de hussards.
La flotte était condamnée à l’immobilité par la gelée qui avait couvert d’une couche épaisse de glace la superficie du Zuyderzée: les hussards français, après avoir enveloppé de chiffons les sabots de leurs chevaux, galopent sur cette mer solide et somment hardiment les vaisseaux hollandais de se rendre. Réduits à l’impuissance, influencés d’ailleurs par l’attitude de leurs équipages, les commandants livrent leurs bâtiments à la cavalerie.
Nous avons vu que les ennemis n’occupaient plus sur la rive gauche du Rhin que les places de Luxembourg et de Mayence, ainsi que la tête de pont de Mannheim.
Luxembourg était investie, depuis le mois de novembre 1794, par trois divisions de l’armée de la Moselle, aux ordres de René Moreaux. Ce général distingué, dont la gloire a été absorbée par celle de son illustre homonyme, meurt prématurément, le 5 février. Les divisions de l’armée de la Moselle sont envoyées devant Mayence et remplacées sous Luxembourg par deux divisions de l’armée de Sambre-et-Meuse.
Le siège de cette place, qui passait pour la plus forte de l’Europe, dura plus de six mois. Le blocus avait été formé le 22 novembre. L’hiver fut excessivement pénible pour les assiégeants, réduits à une demi-ration de vivres, qui ne leur était même pas exactement distribuée. Le bombardement commença vers le 14 mai; les batteries de la place ripostèrent avec vigueur pendant douze jours; mais les dommages furent assez considérables pour amener les bourgeois à réclamer une capitulation; elle fut conclue le 1er juin 1795: la garnison, forte de 12,000 hommes, sortit avec les honneurs de la guerre, déposa ses armés sur les glacis et prêta le serment de ne pas servir contre la France ou ses alliés avant d’être échangée. L’armée de siège ne comptait pas plus de 11,000 hommes de toutes armes.
Le blocus de Mayence n’eut pas le même succès. L’armée du Rhin, renforcée de deux divisions de l’armée de la Moselle, s’établit autour de cette place, sous les ordres du général Michaud, et construisit une ligne de circonvallation d’un développement immense; mais la rive gauche restant absolument libre, et le fort de Cassel qui servait de tête de pont n’étant pas bloqué, la place conservait toutes ses communications avec le dehors et pouvait se ravitailler à volonté, tandis que, les assiégeants, bivouaquant par un froid terrible dans des trous creusés en terre, éprouvaient des souffrances inouïes. Bientôt les moyens de transport manquèrent pour les approvisionnements, parce que tous les chevaux mouraient. La disette fut portée à son comble; les soldats vivaient de racines arrachées avec leurs baïonnettes et dont plusieurs, étant vénéneuses, amenèrent des épidémies meurtrières. Le général Michaud fut grièvement blessé, le 26 mars 1795, en repoussant une sortie; Kléber le remplaça et eut lui-même pour successeur le général Schaal lorsqu’il retourna à l’armée de Sambre-et-Meuse.
Cette armée et celle du Nord n’avaient pas bougé depuis la conquête de la Hollande et la prise de Maëstricht; et lorsqu’on songe à tous les efforts déployés pendant la campagne de 1794, on se demande quelles purent être les causés de cette inaction, si fatale aux armes de la République. La cause principale; il faut bien le dire, fut la révolution survenue en France, le 9 thermidor, et la diminution des pouvoirs du Comité de salut public. La chute de Robespierre, Saint-Just et consorts, avait délivré la France d’une tyrannie cruelle; mais, eri même temps, elle avait enlevé aux opérations militaires cette impulsion énergique à laquelle on avait dû de si brillants résultats.
Carnot, comme pour mieux accentuer ce changement, sortit du Comité de salut public, le 5 mars, après avoir déroulé devant la Convention le magnifique tableau des succès remportés depuis la bataille de Hondschoote jusqu’au siège de Roses: 27 victoires, dont 8 en batailles rangées (Hondschoote, Watignies, Tourcoing, la Montagne-Noire, Geisberg, Fleurus, Aldenhoven), 129 combats de moindre importance, 8,000 ennemis tués, 91,000 faits prisonniers, 100 places fortes ou villes importantes prises, dont 36 après siège ou blocus, 230 forts ou redoutes enlevés, capture de 3,800 bouches à feu, 70,000 fusils, 93 drapeaux.
Une autre cause de l’inaction des armées fut la trahison de Pichegru, trahison qui ne saurait être mise en doute d’après la correspondance trouvée plus tard dans un des fourgons pris sur l’ennemi, et dans laquelle le conquérant de la Hollande s’engagea, au moment même où cette conquête venait de le placer, à bon marché d’ailleurs, au premier rang des généraux d’alors. Si le fait d’une entente coupable avec l’ennemi est bien prouvé, les procédés employés par Pichegru pour arriver à son but ressortent moins clairement des faits; on peutaffirmer cependant qu’ils consistèrent principalement dans l’inertie imposée aux troupes commandées par ce général.
Il venait précisément d’être appelé au commandement de l’armée formée par la réunion de l’armée du Rhin et de l’armée de la Moselle, sous le nom historique d’armée de Rhin-et-Moselle, et qui occupait toute la rive gauche du fleuve, depuis Bâle jusqu’à Mayence. L’armée de Sambre-et-Meuse bordait le fleuve depuis Bingen jusqu’à Uerdingen. Sur la proposition de Kléber et d’après l’insistance de Jourdan, il fut décidé que l’armée de Rhin-et-Moselle forcerait le passage du Rhin entre Huningue et Brisach,tandis que celle de Sambre-et-Meuse franchirait le fleuve de vive force vers Dusseldorf; mais Pichegru, suivant le système qu’il avait secrètement adopté, ne fit aucun mouvement, et les Autrichiens purent, avec la certitude de ne pas être tournés sur le haut Rhin, accumuler leurs forces vis-à-vis de l’armée de Sambre-et-Meuse; C’est à Kléber que fut confiée la tâche redoutable de franchir le fleuve dans des conditions aussi difficiles.
. Kléber avait sous ses ordres les quatre divisions Lefebvre, Tilly, Grenier et Championnet, formant la gauche de l’armée. Les préparatifs du passage, la réunion des bateaux amenés de Hollande ou recueillis dans le pays, demandèrent un certain temps et nécessitèrent de grands efforts. Grâce à l’activité de Kléber et au zèle des officiers de l’artillerie et du génie, toutes les difficultés furent surmontées. Pendant la nuit du 5 au 6 septembre, la division Lefebvre passe le Rhin sur des bateaux et des barques, et son avant-garde s’empare de Spire, en combattant sous les ordres du général Damas, qui est grièvement blessé. La division Tilly suit celle de Lefebvre, Grenier passe à Uerdingen, et Championnet débarque sous les glacis de la place de Dusseldorf, dont la garnison capitule.
Le 7 septembre, les quatre divisions de Kléber se trouvaient réunies en avant de Dusseldorf, obligées de se mouvoir dans la bande étroite de terrain limitée d’un côté par le Rhin, de l’autre par la ligne de démarcation des pays neutres. La division Lefebvre rencontra, le 13,- en avant d’Uckeradt, l’armée du prince de Wurtemberg, comprenant 20,000 hommes, fortement retranchée derrière une ligne de redoutes: le général d’Hautpoul, avec les 1er, 6e et 9e chasseurs, tourne ces redoutes par une manœuvre hardie, et s’en empare en y pénétrant par la gorge. L’ennemi, refoulé dans une série de brillants combats d’avant-garde, se retire derrière le Mein; les divisions de Kléber arrivent le 26 septembre devant Cassel; les deux divisions Bernadotte et Championnet sont chargées du blocus de ce fort, tandis que le reste de l’armée de Sambre-et-Meuse se concentre entre Hochstædt et Mayence.
Pendant ce temps, que faisait l’armée de Rhin-et-Moselle? Laissant une partie de sa gauche devant Mayence, Pichegru se portait vers Mannheim, dont il possédait déjà la tête de pont sur la rive gauche, et se rendait maître de cette place, qui capitulait devant une menace de bombardement; mais, au lieu de profiter de la possession de Mannheim pour y faire passer le gros de ses forces et les joindre à l’armée de Sambre-et-Meuse, il continua son système prémédité d’éparpillement; les suites en furent funestes. Les Autrichiens s’étaient concentrés; le ravitaillement des troupes de la rive droite était d’une difficulté extrême. Deux divisions que Pichegru envoya de Mannheim sur Heidelberg, en leur faisant suivre les deux rives du Mein, furent attaquées sans pouvoir se secourir mutuellement, battues et rejetées sur Mannheim. Les positions en face de Cassel durent être abandonnées, et l’armée de Sambre-et-Meuse se replia sur les ponts qu’elle avait jetés à Neuwied, afin de regagner la rive gauche.
Un incident dramatique marqua la fin de cette retraite. Au moment où Kléber arrivait en vue de Neuwied, avec les divisions Marceau, Bernadotte et Championnet, un bateau enflammé descendait le fleuve; il ne tarda pas à être suivi d’une trentaine d’autres; on activa le passage de l’artillerie et des équipages, et la division Marceau s’engagea sur le pont; elle l’avait en partie franchi quand le premier brûlot l’atteignit: le dommage qu’il causa fut vite réparé ; mais bientôt, la masse des brûlots, renversant tous les obstacles qu’on voulut leur opposer, détruisit complètement le pont. Or, ce n’était pas l’ennemi qui avait lancé ces bateaux enflammés; l’officier chargé par Marceau de détruire les embarcations qui se trouvaient sur la rive, les avait maladroitement abandonnées au courant. Marceau, désespéré, voulut se brûler la cervelle; Kléber le retint et prit ses dispositions pour résister à l’ennemi qui menaçait de le précipiter dans le Rhin. «Combien faut-il de temps pour jeter un nouveau pont?» demanda-t-il au capitaine des pontonniers Tirlet. — «Vingt heures», dit cet officier. — «Je vous en accorde trente et vous m’en répondez sur votre tête.» — L’ennemi s’arrêta devant la ferme contenance des troupes de Kléber, le pont fut achevé le 20 octobre, et bientôt toute l’armée fut en sûreté derrière le Rhin.
Cependant, trois divisions de l’armée de Rhin-et-Moselle, sous les ordres du général Schaal, étaient restées devant Mayence. Le général autrichien Clerfayt débouche subitement de cette place, le 29 octobre, force la ligne des retranchements, et, malgré l’énergique résistance de Gouvion-Saint-Cyr, qui tient bon avec sa division, met en déroute les deux autres divisions. Pichegru vint à leur secours avec son aile droite, commandée par Desaix, livra bataille aux Autrichiens sur la Pfrim, et fut complètement battu. La place de Mannheim, cernée par les Autrichiens, capitula, et l’armée de la Moselle se trouva rejetée jusqu’à Landau, juste au moment où le général Jourdan concluait, pour l’armée de Sambre-et-Meuse, avec les Autrichiens, un armistice qui s’étendit bientôt à l’armée de Rhin-et-Moselle. Ainsi, sur la frontière du Rhin, tous les résultats de la belle campagne de 1794 étaient perdus par la faute de Pichegru.
En Italie et sur les Alpes, la campagne de 1795 se termina plus glorieusement. Kellermann, jugé et acquitté après le 9 thermidor, avait été mis à la tête des deux armées des Alpes et d’Italie; la première, forte de 15,000 hommes à peine, était commandée, sous ses ordres, par le général Moulins: elle débuta glorieusement, le 12 mai, par la prise du col de Monte; les troupes y marchèrent pendant des heures au milieu des neiges, en luttant contre une tourmente épouvantable; le froid était tellement vif, que l’eau et le vin gelèrent dans les bidons. L’armée d’Italie, de son côté, livra plusieurs combats glorieux, entre autres celui de Melogno, dans lequel 1,500 Français culbutèrent et mirent en déroute 5,000 Autrichiens qui avaient essayé de couper la ligne française. Kellermann sut, pendant toute la campagne, se maintenir dans ses positions, en luttant sans trop de désavantage contre des forces très supérieures, tout en repliant son aile droite et renonçant à ses communications avec Gènes.
Après la conclusion de la paix avec l’Espagne, les troupes qui composaient l’armée des Pyrénées orientales furent envoyées pour renforcer l’armée d’Italie, dont Schérer prit alors le commandement, Kellermann restant à la tête de celle des Alpes. Pressé par les instances du Gouvernement d’agir le plus promptement possible, et n’ayant pas eu le temps d’étudier le terrain difficile sur lequel il était appelé à manœuvrer, Schérer demanda conseil à Masséna qui, après avoir dressé le plan des opérations, fut chargé d’en exécuter la partie la plus importante. Il commanda le centre de l’armée; Serrurier commandait la gauche, composée comme le centre des anciennes troupes de l’armée d’Italie; Augereau, avec les divisions venues des Pyrénées, occupa la droite.
Le 23 novembre au matin, les Autrichiens, qui ne s’attendaient pas à être attaqués, furent surpris par le bruit du canon. Augereau s’engageait vivement et cernait la gauche de l’ennemi qui parvenait à se faire jour.
A l’autre extrémité du champ de bataille, Serrurier contenait les Piémontais de Colli, et, par ses manœuvres habiles, les empêchait d’aller au secours du centre, que Masséna était chargé d’écraser. Celui-ci avait défendu aux soldats, par son ordre du jour, de faire usage de leurs cartouches dans l’attaque, et recommandait d’aborder franchement l’ennemi à la baïonnette. Il prescrivait en même temps de remettre toutes les baïonnettes en état et de les aiguiser.
Le moment venu, il franchit audacieusement les crêtes des Apennins, surprit la droite des Autrichiens et la culbuta. Le soir, il campait sur les hauteurs. Le 24 au matin, Serrurier isolait les Piémontais des Autrichiens qui, pressés par Masséna et Augereau, s’enfuirent en désordre, laissant entre les mains des Français 5,000 prisonniers, 40 pièces de canon et des approvisionnements immenses.
Admirablement préparée, la victoire de Loano fut un des triomphes les plus éclatants des armées de la République; il ne lui manqua que d’avoir des suites. Si Schérer eût été en état de pousser vigoureusement l’armée vaincue et de l’empêcher de se réorganiser, en descendant la vallée du Tanaro, la bataille de Loano aurait eu peut-être pour conséquence la conquête du nord de l’Italie, qui fut effectuée l’année suivante par Bonaparte; mais Schérer n’était pas un général à grandes vues, et, d’ailleurs, eût-il voulu se lancer en avant, tout lui aurait manqué pour le faire.
Quoi qu’il en soit, la victoire de Loano termina dignement la campagne de 1795, et son effet contrebalança celui de l’échec éprouvé par l’armée de Rhin-et-Moselle.