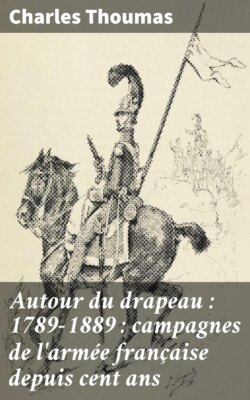Читать книгу Autour du drapeau : 1789-1889 : campagnes de l'armée française depuis cent ans - Charles Antoine Thoumas - Страница 9
VALMY ET JEMMAPES
ОглавлениеL’Assemblée législative avait voté la déclaration de guerre avec plus d’enthousiasme que de réflexion. Rien n’était prêt pour soutenir cette guerre: ni Les anciens régiments, qui se désorganisaient, ni les nouveaux bataillons de volontaires encore incomplètement organisés, ni le matériel et les armes qui faisaient défaut, tous les fusils ayant été livrés aux gardes nationales. L’indiscipline était arrivée à son comble, et les officiers, les généraux surtout, étaient l’objet constant de la méfiance de leurs troupes, excitées par les menées du parti démagogique. Marat disait ouvertement dans son journal, l’Ami du Peuple, que le plus grand service à attendre des soldats était le massacre de leurs généraux.
Le commandant en chef de l’armée du Nord, Rochambeau, qui jugeait sainement la situation et appréciait, comme elles méritaient de l’être, les troupes placées sous ses ordres, avait proposé un plan d’opérations fondé sur la défensive. Dumouriez qui, tout en restant ministre des Affaires étrangères, avait la prétention de diriger la guerre, fit prévaloir l’offensive immédiate et l’invasion de la Belgique. L’armée du centre, commandée par Lafayette, dut marcher de Metz sur Givet et Namur. Pour appuyer le mouvement, deux colonnes, fournies par l’armée du Nord, étaient dirigées: la première, de Valenciennes sur Mons; la seconde, de Lille sur Tournay.
Le début ne fut pas brillant. Biron, qui commandait la première colonne, forte de 10,000 hommes, quitta Valenciennes le 28 avril, et, trouvant les Autrichiens fortement établis à Mons, s’arrêta pour dresser son camp en avant de Quiévrain, afin de laisser le temps au maréchal de Rochambeau de faire avancer à son aide les troupes de seconde ligne. Tout à coup deux régiments de dragons montent à cheval et prennent la fuite en criant que le général a trahi, et qu’il a passé à l’ennemi; ils entraînent les autres troupes qui, malgré les efforts de Biron, rétrogradent sur Valenciennes dans le plus grand désordre. Le général n’échappe à la mort, dont il est menacé par les fuyards, que grâce à la fermeté des autorités de Valenciennes. La seconde colonne qui, sous les ordres de Théobald Dillon, comptait 4,000 hommes, est plus malheureuse encore. A la vue de quelques hussards autrichiens, près de Marquain, la cavalerie qui marchait en tête tourne bride en criant: «Trahison! Sauve qui peut!» Elle passe sur le corps de l’infanterie qui, faisant également demi-tour et abandonnant les bagages, se précipite vers Lille. Le général, frappé de deux coups de pistolet par des fuyards affolés, se traîne chez un paysan d’où, saisi par quelques cavaliers, il est ramené à Lille comme un criminel et achevé d’un coup de fusil. Avec lui est massacré le colonel du génie Berthois, qui s’était vainement efforcé d’arrêter la panique.
Ces désordres ne sauraient être imputés aux volontaires, qui se distinguèrent des troupes de ligne par leur bonne tenue. Le deuxième bataillon de la Seine ramena à Valenciennes un canon qu’il avait pris à l’ennemi dans un retour offensif, et mérita les éloges que lui décerna Biron dans son rapport sur cette triste affaire. Quant aux régiments de ligne, l’excès du mal y produisit une réaction salutaire; les désordres qui avaient suivi la double déroute de Quiévrain et de Marquain, en faisant horreur à tous et surtout aux coupables, amenèrent dans l’armée un retour vers la discipline.
Le plan de Dumouriez avait honteusement avorté. Lafayette, déjà parvenu à Givet, suspendit son mouvement à la nouvelle des événements de Belgique. Rochambeau, indigné de la manière dont il avait été traité par Dumouriez, donna sa démission. La frontière fut partagée en deux commandements: le premier de Dunkerque à Longwy, confié à Lückner; le second, de Longwy à Besançon, dont Lafayette était investi; mais ce dernier général se trouva trop éloigné de Paris, où il se préparait à intervenir, au besoin, en faveur du roi et de la Constitution; et, par suite d’une convention passée entre lui et Lückner, il fut établi, avec ses meilleures troupes, à Sedan, d’où son commandement s’étendit de Dunkerque à Montmédy. Lückner s’installa à Metz. Lafayette avait sous la main, à Sedan, 19,000 hommes. Le reste de l’armée du Nord, soit 24,000 hommes, fut réparti entre les camps de Maulde, de Famars, de Pont-sur-Sambre, sous les ordres supérieurs d’Arthur Dillon, frère du général assassiné à Lille. Dumouriez, qui avait quitté le ministère pour être envoyé à l’armée du Nord, fut placé à la tête des troupes du camp de Maulde, comprenant 10 à 12,000 hommes. Lückner. eut pour lieutenants en Alsace Biron et Custine.
L’Autriche et la Prusse, alliées contre la France, apportèrent heureusement dans leurs préparatifs de guerre une lenteur qui laissa les troupes de Lafayette et celles de Lückner se remettre de leurs mauvais débuts. Dumouriez, se considérant comme indépendant au camp de Maulde, prit les mesures les mieux entendues pour aguerrir ses soldats et sut gagner leur confiance. Tout d’abord il s’installa au milieu d’eux, dans les bivouacs; il établit une ligne de petits postes pour couvrir la frontière et engagea contre les postes autrichiens de Tournay, Bury, Antoing, etc., une petite guerre des plus actives, ayant soin de ménager à ses troupes quelques succès faciles; il leur donna ainsi une hardiesse et une discipline qui les distinguèrent de toutes les autres dans cette campagne de 1792.
Une rencontre assez extraordinaire lui permit d’exalter encore davantage l’esprit guerrier de sa petite armée. Deux jeunes filles de Mortagne, village voisin du camp de Maulde, Théophile et Félicité Fernig, dont le père, alors greffier, avait été maréchal des logis de hussards, accompagnaient d’habitude, sous des habits d’hommes, les expéditions organisées, parmi les paysans, pour repousser les maraudeurs autrichiens. Accoutumées, dès l’enfance, à monter à cheval et à tirer l’arc et le fusil, elles s’étaient fait remarquer par un brillant courage, tout en conservant la douceur et. la modestie qui convenaient à leur sexe. Lorsqu’un camp eut été établi à Maulde, on les vit bientôt, revêtues d’une sorte de costume militaire, faire partie de tous les détachements engagés contre l’ennemi. Dumouriez les accueillit avec faveur, encouragea leurs penchants guerriers et les attacha à son état-major avec le brevet d’adjoint aux adjudants généraux {on dirait aujourd’hui capitaine d’état-major). Il sut, dans plus d’une circonstance, utiliser, pour relever le moral du soldat, l’empire que la vue de ces deux amazones exerçait sur les imaginations. Comparées plus tard à Jeanne d’Arc par les commissaires de la Convention, n’ayant jamais dans leur vie aventureuse prêté le flanc à la médisance, elles rejoignirent Dumouriez, avec les troupes du camp de Maulde, la veille de la bataille de Valmy, et ne le quittèrent qu’après sa défection.
Lafayette, de son côté, ne perdait aucune occasion d’instruire son armée. C’est à lui, dans cette circonstance, que l’on attribue les premiers essais de la tactique nouvelle qui devait l’emporter sur les dispositions formalistes de la méthode prussienne, tactique consistant à déployer des bataillons entiers en tirailleurs pour marcher à l’attaque des positions ennemies. Dumouriez, Dugommier, Custine, dans les campagnes dont nous allons suivre les péripéties, n’en employèrent pas d’autres; elle convenait à merveille au caractère français et à la jeunesse des soldats qui n’avaient pu encore être formés aux manœuvres compliquées du règlement de 1791, inspiré par les théories savantes de Guibert.
. Les troupes de Lafayette eurent avec l’ennemi plusieurs engagements honorables qui leur donnèrent de l’aplomb; dans une de ces rencontres, l’artillerie à cheval se fit remarquer par son audace; dans une autre, le général Gouvion, commandant de l’avant-garde, qui jouissait d’une réputation justement acquise, fut tué par un boulet.
Cependant le moment approchait où la guerre allait devenir plus sérieuse; le commandement en chef de l’armée qui se préparait à envahir la France, et qui comprenait 70,000 Prussiens, Autrichiens et émigrés français, venait d’être déféré au duc de Brunswick, un des plus célèbres, lieutenants de Frédéric II, un des meilleurs généraux formés à l’école de ce grand capitaine. L’Assemblée législative avait déjà décrété, le 5 mai, la formation de 42 nouveaux bataillons de volontaires et l’augmentation de. l’effectif des bataillons de 1791, dont il n’existait toujours que 83 au lieu de 169. A l’approche de l’invasion, voulant frapper les esprits par un spectacle capable de préparer l’opinion aux mesures les plus énergiques, l’Assemblée imagina, le 11 juillet, la mise en scène de la déclaration de la Patrie en danger, qui eut lieu huit jours plus tard.
Qu’on se figure un cortège de douze officiers municipaux à cheval, revêtus de leurs ceintures tricolores et précédés de quatre huissiers qui, également à cheval, portent des bannières avec l’inscription: La Patrie en danger. En avant de ce cortège marchent des troupes de cavalerie, d’infanterie et d’artillerie, avec canons; il est suivi, en sens inverse, d’artillerie, d’infanterie et de cavalerie; à chaque carrefour, il s’arrête; un officier municipal se détache du groupe et crie à haute voix: «Citoyens, la Patrie est en danger!» Un autre montre du doigt l’inscription qui figure sur les bannières. Sur les principales places, des amphithéâtres ont été dressés et surmontés de tentes que parent des drapeaux et des guirlandes de chêne, et sous lesquelles des tables supportées par des tambours servent pour inscrire les noms des citoyens qui contractent l’engagement de servir la Patrie. Les gardes nationaux en armes forment le cercle au pied des gradins; des musiques militaires jouent les airs patriotiques, le canon tonne sans relâche.....
A cette mise en scène, qui obtint surtout un succès de curiosité, l’Assemblée joint des mesures plus sérieuses: elle décrète la levée de 42 nouveaux bataillons de volontaires et l’augmentation du nombre des fédérés, c’est-à-dire des délégués qui, venus à Paris, à raison de cinq par canton, pour les fêtes de la Fédération, sont réunis en bataillons à l’effectif total de 20,000 hommes; en outre, elle autorise tous les citoyens à lever-des corps francs et forme plusieurs légions, composées de cavalerie et d’infanterie, qui prennent le nom des principaux généraux (légion Kellermann, légion Lückner, etc.). A quelques exceptions près, aucun de ces corps de volontaires et de fédérés ne prit part aux faits de guerre de la campagne de 1792; ils se signalèrent, en général, par des excès de toute sorte.
Bientôt le manifeste du duc de Brunswick vint donner un nouvel aliment à la surexcitation publique. Rédigé par un émigré et signé par le généralissime de la coalition, qui en porte la responsabilité devant l’histoire, ce manifeste est bien la sommation la plus insolente et en même temps la plus impolitique qui ait jamais été adressée à une grande nation. Tout en déclarant que les alliés ne voulaient pas s’immiscer dans le gouvernement intérieur de la France, le duc sommait l’armée de se soumettre à son légitime souverain, et la garde nationale de veiller à la sûreté des personnes et des biens; il assimilait les habitants qui oseraient se défendre, à des rebelles qui seraient punis comme tels; la ville de Paris était invitée à mettre Louis XVI en liberté et à le traiter en roi. Les membres de l’Assemblée étaient rendus personnellement responsables sur leurs têtes de tous les événements, sans espoir de pardon.
La colère excitée par cet incroyable langage n’eut pas seulement pour effet le soulèvement de la nation contre les envahisseurs; elle entraîna la chute de Louis XVI, dont l’émeute du 10 août brisa sans retour le trône fragile. Les gardes suisses massacrés, la déchéance du roi prononcée par l’Assemblée, lui-même emprisonné au Temple: tels furent les résultats de cette journée, qui eut pour contre-coup à l’armée la fuite de Lafayette. Ce général avait espéré maintenir ses troupes dans la foi jurée au roi et à la Constitution, mais en présence de l’ennemi menaçant la frontière, elles ne virent que le devoir de défendre la patrie. Abandonné par ceux sur lesquels il comptait, Lafayette passa la frontière et tomba dans les mains des Autrichiens, qui lui firent subir une longue et cruelle captivité. Dumouriez fut appelé au commandement en chef de l’armée du Nord.
L’armée alliée, partie de Coblentz et de Trêves, occupait le duché de Luxembourg: elle obéissait par le fait à deux chefs, le duc de Brunswick, prudent et circonspect, le roi Frédéric-Guillaume de Prusse, ardent et persuadé, d’après le dire des émigrés, qu’il suffirait de se montrer pour avoir raison de ce ramassis de valets et de garçons perruquiers qui constituait l’armée française. A la nouvelle de la révolution du 10 août, Frédéric-Guillaume donna l’ordre de marcher immédiatement sur Paris; la frontière fut franchie le 19; toutes les premières rencontres furent favorables à la cavalerie prussienne, et la confiance des ennemis redoubla.
Dès le 20, la place de Longwy était investie. Les fortifications étaient en mauvais état; la garnison montait à 2,600 hommes, dont trois bataillons de volontaires. Sommé de se rendre, le gouverneur Lavergne répondit fièrement qu’il ferait son devoir, et le bombardement commença le 22 août. Interrompu à plusieurs reprises, il ne tarda pas à produire des effets si terribles, que les habitants et la municipalité supplièrent le gouverneur d’y mettre fin par une capitulation honorable. Le conseil de défense, composé des officiers supérieurs de la garnison, émit l’avis de rendre la place. La belle résolution de Lavergne s’évanouit devant ces manifestations, et le 23 août il signait la capitulation, aux termes de laquelle la garnison devait être désarmée et renvoyée en liberté. Les Prussiens occupèrent Longwy. Lavergne paya plus tard de sa tête sâ condescendance coupable aux plaintes des habitants. Le dévouement sublime de sa femme, qui voulut mourir avec lui, a entouré son nom d’une auréole touchante.
Après Longwy vint le tour de Verdun. Cette place n’était pas en meilleur état que la précédente; la garnison montait à 4,000 hommes, mais elle était sans cohésion, comprenant des dépôts d’infanterie et de cavalerie composés uniquement de recrues, des détachements de volontaires de diverses provenances, et seulement quatre bataillons de volontaires, dont celui d’Eure-et-Loir, commandé par Marceau; l’artillerie était tout à fait insuffisante; le génie était dirigé par un ingénieur d’un talent hors ligne, Bousmard, qui passa plus tard au service de la Prusse et qui, sans trahir, comme il en a été accusé, n’apporta certainement pas à la défense toute l’ardeur nécessaire. Il n’y avait pas de gouverneur; le commandement revint de droit au plus ancien des officiers supérieurs, le lieutenant-colonel Beaurepaire, chef du bataillon de Maine-et-Loire. «Assurez le Corps législatif, écrivait-il aux commissaires de l’Assemblée, que lorsque l’ennemi sera maître de Verdun, Beaurepaire sera mort.» Il tint parole.
Les premières sommations, adressées par le duc de Brunswick au commandant et aux notables de la ville, ayant été repoussées, le bombardement commença le 31 août, à onze heures du soir, et fut conduit avec une rigueur extrême. Des rassemblements se formèrent pour réclamer à grands cris la capitulation; une délégation de citoyens sans mandat, appuyée par une partie de la municipalité, somma impérieusement le commandant et le conseil de défense de prévenir la destruction des propriétés en rendant la place. Le conseil se réunit: ébranlé par les cris des manifestants, il conclut à l’impossibilité de continuer la résistance. Beaurepaire, soutenu par Marceau, résolut de tenir bon, mais il eut le tort de consentir à une suspension d’armes et de laisser la municipalité entrer en pourparlers avec l’ennemi; il congédia le conseil, remettant au lendemain la résolution à prendre; puis, rentrant dans la chambre qu’il occupait à l’hôtel de ville, il se tira deux coups de pistolet et tomba mort. Le lieutenant-colonel de Neyon, qui le remplaça comme étant le plus ancien après lui, signa la capitulation le 2 septembre. La garnison resta libre et emporta ses armes, les bataillons de volontaires emmenèrent même leurs canons. Ils quittèrent la ville en criant aux Prussiens: Nous nous reverrons!...
Le suicide de Beaurepaire a été célébré par l’histoire comme un acte héroïque de patriotisme. Il est permis de penser cependant que son héroïsme eût été mieux employé à résister aux injonctions des citoyens révoltés contre son autorité, et aux avis pusillanimes du conseil de défense.
La nouvelle de la capitulation de Verdun produisit à Paris un effet extraordinaire, mais de la surexcitation et non du découragement. La Commune de Paris, qui déjà s’arrogeait le droit de gouverner la France, voulant rompre sans retour avec les rois étrangers, ordonna, ou laissa faire le massacre des prisons. Paris vit donc à la fois, fait remarquer un historien, le hideux spectacle de la perpétration d’un crime exécrable, et l’exemple d’un entier dévouement à la plus juste des causes, la défense de la patrie.
Dumouriez était arrivé à Sedan le 28 août; il y avait trouvé 23,000 hommes de bonnes troupes, désorganisées par le départ d’un grand nombre d’officiers, et regrettant le général Lafayette. Sans se laisser émouvoir par leur contenance hostile, il les passe en revue, il entend un grenadier dire à ses camarades: «C’est ce bougre-là qui a déclaré la guerre. — Y a-t-il donc ici, s’écrie-t-il en s’arrêtant, quelqu’un assez lâche pour être fâché de faire la guerre?» Le même jour il réunit en conseil les généraux et plusieurs officiers de l’état-major; le conseil opine pour se retirer en arrière de la Marne. — Dumouriez laisse dire, puis montrant sur la carte déployée devant lui la forêt de l’Argonne: «Voici, dit-il, les Thermopyles de la France; si je puis y arriver avant les Prussiens, nous sommes sauvés.»
La forêt de l’Argonne, qui sépare la vallée de la Meuse de celle de l’Aisne et qui s’étend par conséquent entre le pays des Trois-Évêchés et la Champagne, n’est plus aujourd’hui qu’une barrière insignifiante, non seulement parce que les chemins y sont plus nombreux et plus faciles qu’autrefois, mais parce qu’on ne fait plus la guerre comme à cette époque, où l’on cherchait surtout à manœuvrer pour tourner l’ennemi au lieu de l’aborder de front. Cet obstacle n’a arrêté un seul instant, ni les invasions de 1814 et de 1815, ni celle de 1870.
En 1792, l’Argonne ne pouvait être franchie que par cinq passages ou défilés, dont le plus central et le plus large était celui de Grand-Pré formé par le cours de la rivière d’Aire, affluent de l’Aisne, et suivi par la route de Verdun à Vouziers. Au sud-ouest, le défilé des Isleltes livrait passage à la route de Verdun à Châlons par Sainte-Menehould; au nord-est, le défilé du Chêne-Populeux, appelé aussi trouée du Noirval, servait de communication entre Stenay et Vouziers. Entre les Islettes et Grand-Pré, se trouvait le passage secondaire de la Chalade; enfin, entre Grand-Pré et le Chêne-Populeux s’ouvrait le défilé de la Croix-au-Bois, où circulait un simple chemin de charrettes. Dumouriez choisit Grand-Pré pour s’y installer avec le gros de ses forces, fit occuper les Islettes et la Chalade par son avant-garde, sous les ordres d’Arthur Dillon, et chargea le général Duval de défendre le Chêne-Populeux. Quant à la Croix-au-Bois, il y mit un colonel de dragons, vieux soldat de la guerre d’Amérique, avec deux escadrons de son régiment et deux bataillons. Dumouriez déploya toute son habileté et toutes les ressources de son esprit ingénieux pour dérober aux Prussiens la marche de ses détachements. Le 3 septembre, il était installé à Grand-Pré. Dillon, avec plus de difficultés, parvenait à occuper, le 5, le défilé des Islettes, où il ralliait la garnison de Verdun; enfin, le 7 avril, Duval arrivait au Chêne. Beurnonville reçut du ministre de la Guerre l’ordre de venir rejoindre Dumouriez avec les troupes du camp de Maulde; Kellermann, qui avait remplacé à Metz le vieux Lückner, jugé insuffisant, et qui avait battu en retraite par Pont-à-Mousson et Ligny sur Bar-le-Duc, dut venir se placer à la gauche de l’armée de l’Argonne.
Les Prussiens, dont les subsistances étaient mal assurées, marchaient avec lenteur et circonspection. C’est seulement le 8 septembre qu’eurent lieu les premières escarmouches entre eux et les troupes de Dumouriez. Celles-ci, bien dressées par Lafayette, comme nous l’avons vu, firent bonne contenance: l’artillerie réduisit au silence celle des Prussiens, l’infanterie employa avec succès, dans ce pays couvert, la nouvelle tactique des bataillons déployés en tirailleurs. Les défilés de l’Argonne ne furent cependant pas les Thermopyles de la France: une faute, ou plutôt une négligence de Dumouriez, en livra la clé aux Prussiens. Le colonel chargé de défendre la Croix-au-Bois prétendit avoir si bien barré le passage par des tranchées et des abatis, qu’il pouvait être défendu par une poignée d’hommes, et demanda à rejoindre le gros de l’armée. Dumouriez le crut sur parole et fit remplacer ce colonel et sa troupe par un bataillon de volontaires; les ordres furent mal donnés, les volontaires n’arrivèrent pas. L’ennemi, bien informé, s’empara de la Croix-au-Bois laissée sans défenseurs. Dumouriez fit reprendre ce poste par le général Chazot, dans un combat où fut tué le jeune prince de Ligne, mais les troupes fatiguées se gardèrent mal; un retour offensif les chassa définitivement, et la Croix-au-Bois resta au pouvoir de l’ennemi. Le corps qui gardait le Chêne-Populeux, se voyant tourné, retrograda sur Vouziers, et Dumouriez lui-même n’eut d’autre parti à prendre que d’abandonner Grand-Pré. Cela se passait le 15 septembre.
— Dans cette circonstance critique, Dumouriez ne perdit pas la tète. Persuadé que l’ennemi ne s’aventurerait pas dans le cœur de la France en laissant une armée derrière lui, il résolut d’aller se placer en avant de Sainte-Menehould, adossé au corps de Dillon, qui continuerait à occuper les Islettes. De là, il appellerait à lui les troupes du camp de Maulde qui étaient en route pour le rejoindre, et l’armée de Metz, qui était arrivée à Bar-le-Duc. Il s’agissait pour lui de gagner Sainte-Menehould avant que la route fût coupée; il conserva son sang-froid apparent, et donna seulement, après la nuit venue, l’ordre de lever le camp. Les feux de l’avant-garde furent laissés allumés pour tromper l’ennemi; on se mit en route à trois heures du matin, et à huit heures, l’armée était en sûreté sur la rive gauche de l’Aisne; mais la colonne du général Chazot, qui venait de la Croix-au-Bois, ne fut pas aussi heureuse; elle donna dans les avant-gardes prussiennes; il s’en suivit une panique qui se communiqua aux troupes de Dumouriez et aurait amené un désastre, si le régiment des hussards de Chamborant n’eût contenu l’ennemi, et sauvé l’armée par sa fermeté. Les fuyards allèrent porter l’alarme jusqu’à Châlons et même jusqu’à Paris.
Si les Prussiens avaient attaqué Dumouriez avant l’arrivée des renforts qu’il avait demandés, inférieur en nombre, il eût été certainement battu; mais ils continuèrent d’agir avec la même circonspection et donnèrent aux troupes attendues le temps d’arriver. Ce fut d’abord, dans la journée du 19 septembre, Beurnonville avec les troupes du camp de Maulde; à la nouvelle des événements de l’Argonne il avait rétrogradé jusqu’à Châlons, mais sur de nouvelles instances, il accourait, amenant les soldats affectionnés de Dumouriez, tout joyeux de retrouver leur ancien général. Le soir du même jour, Kellermann débouchait à son tour dans la plaine. Il était temps!..
Kellermann prit tout d’abord une position peu militaire; il se proposait d’en occuper une meilleure le lendemain. L’avant-garde prussienne, apparaissant le 20 au matin, ne lui en laissa pas le temps; il ne lui resta qu’à suivre le conseil de Dumouriez et à occuper le plateau du moulin de Valmy. Ce mouvement ne s’opéra pas sans difficultés en raison des encombrements de troupes et de bagages; il fut couvert par l’avant-garde aux ordres de Déprez-Cassier et par la réserve que commandait Valence, qui. résistèrent énergiquement à l’ennemi, ne cédant le terrain que pied à pied, et qui se placèrent ensuite dans la plaine, à gauche de la hauteur de Valmy, un peu en potence. Dumouriez, voyant le danger qui menaçait Kellermann, envoya Stengel occuper, avec un corps de 8,000 hommes, la hauteur de l’Yron, à droite et en avant de Valmy, et le fit soutenir en arrière par Beurnonville avec les troupes du camp de Maulde; il envoya de même, dans la plaine à gauche, le général Chazot appuyer Valence et Déprez-Cassier, en sorte que l’armée de Kellermann, ainsi renforcée et encadrée, forma une ligne brisée en avant de celle de Dumouriez, et séparée d’elle par une vallée marécageuse.
L’avant-garde prussienne s’empara des hauteurs de la Lune, qui font face au plateau de Valmy et le dominent. L’armée de Brunswick ne tarda pas à s’y former sur deux lignes: 58 bouches à feu, disposées sur les hauteurs, enveloppèrent l’armée française. Une canonnade des plus vives s’engagea bientôt; depuis le matin d’ailleurs, les avant-gardes se canonnaient; les Français avaient 24 pièces sur la hauteur de Valmy et 16 sur l’Yron. Bientôt l’armée prussienne s’ébranle dans un ordre parfait pour enlever de vive force le plateau de Valmy. Le canon avait dissipé les nuages qui couvraient le ciel depuis le matin. Un beau soleil éclairait le champ de bataille où allait se décider le sort de la Révolution française. Le moment était solennel: déjà une certaine inquiétude se manifestait parmi les jeunes soldats de Kellermann. Celui-ci fait former son infanterie en trois colonnes profondes, recommande d’attendre l’ennemi sans tirer et de se jeter sur lui à la baïonnette dès qu’il apparaîtra sur le plateau. Puis, élevant sur la pointe de son épée son chapeau surmonté d’un panache tricolore, il crie: «Vive la nation!» Toute l’armée répète ce cri, les soldats agitent leurs chapeaux au-dessus de leurs baïonnettes, les musiques jouent l’air de Ça ira et le canon ne cesse de gronder...
Devant cette belle contenance, Brunswick, comprenant les difficultés de l’attaque, arrête ses lignes qui se sont rapprochées à douze cents pas des Français, et ordonne à son artillerie de redoubler le feu; l’artillerie française, habilement dirigée par les généraux d’Aboville et Sénarmont, riposte vigoureusement. Au nombre et à l’avantage d’une position dominante, elle oppose le calme et la précision du tir. Kellermann tombe sous son cheval tué par un boulet; il se relève aux acclamations de ses soldats; un peu plus tard un obus met le feu à un caisson, trois caissons sautent, les charretiers s’enfuient avec les autres, le désordre se met dans les rangs de l’infanterie, les batteries cessent leur feu. Le moment est critique, mais deux batteries légères accourent au galop, et le tir reprend de plus belle. Vers quatre heures, les Prussiens font un mouvement; on croit à une seconde attaque, on crie de nouveau: «Vive la nation», mais ce n’était qu’une manœuvre pour occuper la route de Châlons, et les troupes françaises, persuadées qu’elles ont fait reculer l’ennemi, poussent des cris d’enthousiasme. A la droite apparaissent les Autrichiens, conduits par Clerfayt; ils se forment pour attaquer à leur tour, et, comme les Prussiens, ils s’arrêtent. Un violent orage met fin à la lutte.
L’armée alliée coucha sur ses positions, dans la boue, exposée à une pluie glaciale. Brunswick, qui avait commencé à tourner l’aile gauche de Kellermann, se proposait de renouveler son attaque; mais au jour, il s’aperçut que les Français avaient décampé. A la suite d’une conférence tenue le soir du 20 septembre, et sur l’avis émis par le général d’Aboville, l’armée du centre avait abandonné les hauteurs de Valmy et la plaine, pour venir se placer dans une forte position qui prolongeait à gauche celle de Dumouriez. Stengel avait quitté l’Yron pour rejoindre l’armée du Nord, et les deux armées réunies présentaient une longue ligne de soldats enivrés par la victoire.
Et cependant il n’y avait pas eu de bataille. La canonnade de Valmy, tel est le nom qui est resté dans l’histoire, à l’affaire du 20 septembre 1792. Le nombre des combattants avait été, du côté des Français, de 52,000, dont 36,000 furent engagés avec 40 bouches à feu. Les alliés étaient au nombre de 34,000 avec 58 canons. Les deux partis ne perdirent pas ensemble plus de 800 hommes tués ou blessés. Mais combien de batailles sanglantes où 20 et 30,000 combattants sont restés sur le terrain, n’ont pas produit de résultats comparables à ceux de la canonnade de Valmy! Le soir du 20 septembre, l’illustre Goethe, qui accompagnait à l’armée des alliés son ami et protecteur le duc de Weimar, disait à quelques officiers prussiens: «Notez bien ce jour, car de lui date pour le monde une ère nouvelle.»
Valmy! c’était la Révolution triomphante et la France délivrée de l’intervention étrangère! Les alliés restèrent une dizaine de jours dans leur camp de la Luné, en proie aux misères et aux souffrances de toutes sortes, à la disette et à la maladie, coupés de leurs communications et manquant de tout. «Le camp des alliés,» écrivait-on de Sainte-Menehould, «offre l’aspect d’un vaste cimetière. La dysenterie occasionnée par les fatigues, les pluies, la mauvaise nourriture et les raisins verts de la Champagne, les avait décimés. On cite tel régiment qui avait perdu 400 hommes.»
L’armée française, approvisionnée par Vitry-le-François, vivait difficilement mais mieux, et surtout mieux abritée; la conscience du devoir accompli et l’ivresse du succès y soutenaient tous les cœurs. Enfin le roi de Prusse et le duc de Brunswick se déterminèrent le 30 septembre à ordonner la retraite. Dumouriez et Kellermann suivirent l’armée alliée sans l’attaquer.
Les privations et la dysenterie firent à cette armée autant de mal que la perte d’une bataille. Verdun et Longwy furent successivement rendus aux troupes républicaines; le siège de Thionville, entrepris par les Autrichiens et les émigrés, fut levé. Le 20 octobre, les dernières troupes ennemies avaient évacué le territoire français, où elles étaient entrées si insolemment deux mois et demi auparavant.
Sur d’autres points de la frontière, le sort des armes s’était montré également favorable à la république naissante. Profitant du départ des Autrichiens qui étaient venus se joindre à la grande armée des coalisés, Custine, commandant en Alsace sous les ordres supérieurs de Biron, se porta en avant, entra de vive force, le 30 septembre, dans la ville de Spire, et envoya le général Neuwinger occuper Worms le 4 octobre. Le lendemain de leur entrée à Spire, les volontaires laissés dans cette ville pour la garder, se livrèrent à des actes honteux de pillage. Custine les réprima sévèrement et produisit ainsi sur les habitants une impression salutaire qui facilita les succès de sa petite armée. Le gouverneur de Mayence, sommé par le colonel Houchard, rendit le 14 octobre cette place. importante, sans chercher à la défendre. Houchard marcha ensuite sur Francfort, dont il s’empara le 23.
Pendant ce temps, Montesquiou, commandant l’armée du Midi, trompant les troupes piémontaises par une fausse démonstration, entrait avec 20,000 hommes en Savoie, dont le peuple se soulevait contre l’autorité du roi de Sardaigne. Anselme, lieutenant de Montesquiou, passant le Var avec 8,000 hommes, s’emparait de Nice et du fort Montalban.
Dans le Nord, le duc de Saxe-Teschen, profitant du départ des troupes du camp de Maulde, se présentait devant Lille avec 25,000 hommes et 8,000 chevaux. La place n’était défendue que par 7 ou 8,000 hommes, dont 3,000 de troupes régulières. L’armée ennemie était trop peu nombreuse elle-même pour une attaque en règle. Le duc de Saxe voulut réduire Lille par le bombardement 60,000 boulets rouges, sans compter les obus et les bombes, furent lancés dans cette grande cité, du 29 septembre au 6 octobre. Le patriotisme et la constance des habitants, la fermeté du commandement militaire et de la municipalité s’élevèrent à la hauteur des circonstances. Personne ne parla de capitulation, et le 7 octobre le duc de Saxe-Teschen abandonna la partie aux approches de l’armée du Nord, n’emportant que la honte d’une inutile barbarie. Le 8 octobre, Lille était entièrement libre, et les habitants parcouraient, en poussant des cris de joie, les tranchées profondes dans lesquelles l’ennemi avait établi ses batteries.
Pendant que l’armée du Nord, sous les ordres du général Labourdonnaye, revenait de la poursuite des Prussiens, Dumouriez passait par Paris pour concerter avec le ministère les moyens de réaliser l’invasion de la Belgique. 100,000 hommes furent placés sous ses ordres pour cette grande opération; il les répartit en quatre corps d’armée, et lui-même se mit à la tête du centre, fort de 40,000 hommes. Le gros de l’armée autrichienne, toujours commandée par le duc de Saxe-Teschen, comprenait seulement 20,000 hommes établis en avant de Mons dans une position formidable, la droite au village de Jemmapes, la gauche à celui de Cuesmes, le front couvert par des retranchements et par des redoutes armées de près de cent canons.
Dumouriez, opposant aux ailes de l’ennemi ses corps détachés, marche sans tarder contre le corps principal, qu’il repousse le 5 novembre de ses positions avancées, et il dispose tout pour l’attaquer le 6 au matin. Ferrand commande la gauche en face de Jemmapes, le duc de Chartres le centre devant la ligne des retranchements, Dampierre la droite opposée à Cuesmes; Beurnonville avec l’avant-garde relie la droite au centre. Le vieux Ferrand enlève d’abord le poste de Quarégnon qui couvrait la position de Jemmapes. Son cheval tué tombe sous lui, et, quoique blessé lui-même à la jambe, il se met à pied à la tête des grenadiers pour attaquer à la baïonnette le village de Jemmapes. Thouvenot, premier aide de camp de Dumouriez, est venu le seconder et lui souffler l’ardeur qui anime son général. Un succès complet couronne leurs efforts.
Il n’en est pas de même à la droite, où l’avant-garde de Beurnonville est débordée par six bataillons ennemis; mais Dampierre s’élance à son secours, culbute les six bataillons, s’empare des deux premières redoutes et fait 1,600 prisonniers. Dumouriez donne alors au centre le signal de se porter en avant. «Voilà les hauteurs de Jemmapes,» dit-il à ses soldats, «et voilà l’ennemi: l’arme blanche et la terrible baïonnette, voilà la tactique nouvelle à employer pour y parvenir et pour vaincre.» Les troupes s’élancent avec ardeur, mais les attaques subites de la cavalerie, un feu violent d’artillerie et d’infanterie les font hésiter. Le désordre se mettait déjà dans leurs rangs, lorsque le jeune Baptiste Renard, valet de chambre du général, inspiré par un mouvement héroïque, dit Dumouriez dans ses Mémoires, rallie sept escadrons de cavalerie et rétablit le combat. L’infanterie parvient au pied des redoutes où la mitraille l’arrête et où la cavalerie autrichienne s’apprête à la charger. Le duc de Chartres, qui la commandait et qui montra dans cette journée autant de sang-froid que d’ardeur, forme ses troupes en colonne et pénètre à la baïonnette dans les retranchements, en même temps qu’il fait contenir la cavalerie ennemie par deux régiments de chasseurs et de hussards.
Restait, à droite, la position de Cuesmes à enlever; Dumouriez y court; il y trouve les troupes du camp de Maulde qui luttaient sans succès depuis le matin et qui l’accueillent par des cris enthousiastes de Vive Dumouriez. Il fait charger par les hussards de Berchiny les dragons impériaux, qui sont culbutés; puis, se mettant à la tête de trois régiments de cavalerie, hussards de Berchiny et de Chamborant, chasseurs de Normandie, il leur fait entonner la Marseillaise et pénètre par la gorge dans les redoutes, tandis que l’infanterie les aborde de front et culbute, à la baïonnette, les grenadiers hongrois.
Telle fut la bataille de Jemmapes, la première bataille rangée des guerres de la Révolution. L’ennemi y perdit 5,000 hommes, tant tués que blessés, presque autant de prisonniers, et huit canons. Cette bataille eut pour conséquence immédiate l’abandon de Mons et de Tournay par l’ennemi, et la prise, de vive force, de Bruxelles, où les Français entrèrent le 24 novembre. Liège tomba ensuite au pouvoir de Dumouriez après un combat de dix heures; Anvers, assiégée par Labourdonnaye, capitula le 29 novembre; enfin Namur se rendit au général Valence le 2 décembre. La conquête de la Belgique était complète.
La campagne de 1792 ne s’acheva pas cependant partout avec le même succès.
L’armée du duc de Brunswick reprit, le 2 décembre, la ville de Francfort, malgré la résistance vigoureuse que lui opposa le général Houchard. Celui-ci parvint toutefois à se replier en bon ordre, et, soutenu par le général Neuwinger qui lui amena un renfort de 4,000 hommes, il rejoignit l’armée de Custine. C’est dans cette retraite que le roi de Prusse, ayant remarqué un grenadier français qui, couvert de blessures et entouré d’ennemis, refusait de se rendre, le fit amener vers lui en écartant ceux qui l’attaquaient et lui dit: «Vous êtes un brave homme, c’est dommage que vous ne vous battiez pas pour une meilleure cause.» Le grenadier lui répondit: «Citoyen Guillaume, nous ne serions pas d’accord sur ce chapitre, parlons d’autre chose!»
D’autre part, l’armée de la Moselle, commandée par Beurnonville, échouait dans ses tentatives pour se porter en avant, et prenait ses quartiers d’hiver sur les rives de la Sarre. Enfin, pour terminer ce qui est relatif à l’année 1792, il convient de signaler les débuts de l’insurrection vendéenne, la prise de Châtillon-sur-Sèvre par 8,000 paysans armés de bâtons, de fourches, de faux et de fusils, qui pillèrent la ville et brûlèrent les papiers de l’administration (22 août), et le combat de Bressuire, où les insurgés furent battus par les gardes nationales de Parthenay, Niort, Saint-Maixent, Angers, Nantes, Saumur, Poitiers, etc., accourues au secours de Bressuire. Mais ce n’était là que le prélude de l’insurrection générale du pays.