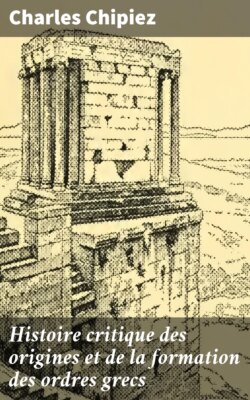Читать книгу Histoire critique des origines et de la formation des ordres grecs - Charles Chipiez - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX
ОглавлениеTable des matières
Du rôle des exigences plastiques. — Exemples. — Dans les colonnes égyptiennes les formes végétales sont accidentelles et non constitutives.
C’est dans cet ordre d’idées qu’il est possible de rechercher les motifs qui ont guidé l’architecte. Mais, qu’on ne s’y méprenne pas, les exigences plastiques qui ont provoqué, dans une certaine mesure, la création des membres du support et les conditions générales des formes, n’ont pas déterminé les formes mêmes. Et voici qui le prouve bien:
Un fragment de chapiteau antique, transporté sur les bords de la Tamise, dépaysé et privé, dans cette atmosphère brumeuse, de l’éclatante lumière qui en faisait valoir les effets, conserve tous les caractères essentiels de la beauté : la noblesse des lignes, la magnificence du style, toutes choses qui le caractérisent en propre, sont indépendantes de toute fonction antérieure, et n’ont besoin d’être expliquées par aucune destination particulière.
Il y a plus: ces exigences peuvent être satisfaites par des procédés divers. Ainsi, dans les ordres grecs, les chapiteaux obéissent à la double condition de former à la fois un contraste avec le fût de la colonne et une transition entre celle-ci et l’entablement. Les trois ordres fournissent donc chacun une solution à ce problème, et ces solutions sont différentes les unes des autres et même contradictoires.
Dans le cas présent, l’architecte égyptien, au lieu de créer les formes, préféra les emprunter aux monuments antérieurs.
Ce principe d’imitation explique les formes générales et les formes accessoires ou ornementales de la colonne. Les assemblages symétriques empruntés au règne végétal, les tiges, les feuilles qui s’épanouissent sur la surface du chapiteau, les prismes, les lobes qui la sinuent, tous les motifs, appartenant originairement aux colonnettes ligneuses et métalliques, se montrent dans les colonnes en pierre comme élément non principal, mais secondaire ou subordonné. Ces reliefs légers ajoutent seulement à la forme première, dont la modénature reproduit celles des colonnes figurées, une ornementation sculpturale, à laquelle l’architecte impose de ne jamais interrompre les lignes, de ne jamais dénaturer les formes générales. Dans les grandes époques, sous les XVIIIe et XIXe dynasties (1703-1287), cette luxuriante ornementation est des plus restreintes. Même lorsque les inscriptions hiéroglyphiques couvrent le fût et que les feuillages entrent encore dans la composition du chapiteau, le caractère général de la colonne est abstrait.
Dans les beaux exemplaires de Karnak, le souvenir des bases de l’ancienne architecture est à peine rappelé par les semblants d’écailles qui entourent la partie inférieure des fûts. Encore cette décoration, dénuée de toute valeur imitative, se développe-t-elle également en longues lignes sur les assises inférieures des murailles (F. XLIV).
Nous ne pouvons omettre de faire remarquer aussi que la coloration vive et tranchée des colonnes et des entablements de l’ancienne architecture légère se continue dans l’architecture granitique, et que la polychromie en devient une des caractéristiques persistantes.