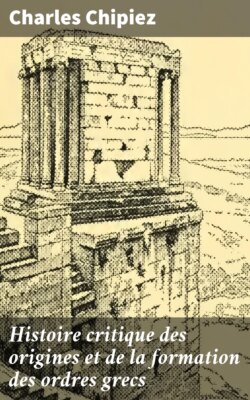Читать книгу Histoire critique des origines et de la formation des ordres grecs - Charles Chipiez - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Les deux principaux types columnaires de l’Égypte. — Le premier, couronné d’un chapiteau rentrant. — Le second, d’un chapiteau saillant. — L’entre-colonnement pycnostyle.
La grande salle hypostyle de Karnak, élevée sous la XIXe dynastie (1462-1287), montre ces changements dans le plus riche épanouissement de colonnes qu’il soit possible de concevoir. Les cent trente-quatre supports de la couverture de cette salle appartiennent à deux types essentiellement distincts.
Dans le premier, nous retrouvons l’antique colonne de Beni-Hassan simplifiée et reposant sur un socle d’un profil droit ou convexe. Aucune rudenture n’en creuse la surface circulaire. La chapiteau lisse semble n’être qu’un accident, un renflement de la partie supérieure du cône, et ne joue aucun rôle dans la construction, la largeur de l’abaque n’excédant pas le diamètre supérieur du fût. La silhouette de cette colonne, maintenue entre deux verticales, est d’une étonnante fermeté et rappelle le robuste caractère du pilier primitif (F. XXXVIII) .
Si, à part le développement des dimensions, le fût du second type ne présente aucune particularité qui le distingue du premier, il n’en est pas de même du chapiteau qui le couronne; celui-ci, au lieu de se replier sur soi, projette une courbe pleine de puissance et d’ampleur hors du fût. Un abaque cubique en recouvre partiellement la surface circulaire. Ainsi isolé de l’architrave, et beaucoup plus large que l’abaque, le chapiteau proprement dit ne remplit aucune fonction constructive (F. XXXIX) .
La colonne à chapiteau campaniforme résume peut-être l’expression la plus haute de l’architecture égyptienne. Comme celui de de la colonne précédente, le fût est quelquefois rudenté ; mais, à Karnak, ces deux types montrent, par la simplicité même des formes, qu’ils ont atteint un suprême développement.
Il importe de remarquer que, dans cette période, la proportion de l’entre-colonnement devient de plus en plus restreinte; elle est diastyle, pycnostyle même quelquefois .
Souvent la distance qui sépare les colonnes paraît déterminée par la longueur de l’architrave; un examen attentif montre cependant qu’il n’en est pas toujours ainsi. Dans un certain nombre d’édifices, une architrave monolithe est supportée par deux, trois et même quatre colonnes . Ajoutons encore qu’un des caractères généraux de l’ordonnance columnaire des dernières dynasties est fidèlement reproduit dans l’architecture du Nouvel-Empire: les formes secondaires des chapiteaux sont alternantes, ou bien se rapportent à différents types.