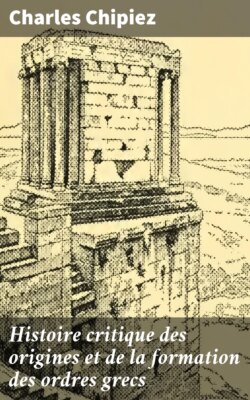Читать книгу Histoire critique des origines et de la formation des ordres grecs - Charles Chipiez - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AVANT-PROPOS
ОглавлениеTable des matières
Les formes architecturales représentent, ou peuvent toujours représenter des abstractions. L’artiste, suivant les expressions de Gœthe, «place ses moyens matériels sous la dépendance d’une inspiration raisonnée, à laquelle il les fait servir d’instruments».
Ces deux principes, abstraction, inspiration, qui dès l’abord interviennent dans l’œuvre monumentale, semblent opposer d’insurmontables difficultés à l’étude des formes originaires. Comment, en effet, découvrir la source des idées ou des sentiments dont elles émanent dans le champ sans limites ouvert aux conceptions primitives?
L’intérêt qui s’attache à cette question a eu le privilége de provoquer de nombreuses recherches.
Au sujet des monuments helléniques, deux théories depuis longtemps formulées divisent, aujourd’hui encore, un grand nombre d’esprits.
L’une trouve, dans les antiques sanctuaires en bois de l’Hellade, le modèle qui aurait imposé non-seulement la forme générale de l’édifice en pierre, du temple dorien, mais les formes particulières des éléments qui le constituent. Dans ce système, «le tronc d’arbre devient le type de la colonne; mais bientôt le type sera transformé de telle sorte, qu’il ne gardera plus de commun que les conditions de solidité ».
Dans l’autre système, tout principe d’imitation est nié, et l’on affirme que les membres d’architecture, et spécialement la colonne, «dérivent des nécessités de la construction en pierre, et doivent à cette seule origine leur forme et leur beauté ».
Ces théories ne se sont pas produites sans soulever de sérieuses objections.
On a justement fait remarquer qu’il y aurait invraisemblance et même impossibilité à substituer la pierre au bois, en donnant à celle-là les formes qui conviennent à celui-ci. Le mode d’emploi est réglé par la constitution et les propriétés des matériaux, parfois diamétralement opposées. Il a donc été facile de prouver que la métamorphose du temple ligneux en édifice lapidaire n’aurait pu s’opérer que par l’interversion des lois de la statique.
On a dit encore que, si les nécessités constructives remplissaient un grand rôle dans les édifices, elles s’imposaient à l’artiste comme moyen de réalisation, et non comme source de création; que l’œuvre d’art se manifeste dans un ordre expressif supérieur à celui des exigences matérielles, c’est-à-dire par une beauté qui la caractérise en propre.
Ces systèmes, tendant à expliquer les formes architecturales par des principes admis à priori, sont insufsants à déterminer l’origine de l’art monumental hellénique. On le prend bien au point de départ, il est vrai; mais on le considère comme indépendant de toutes relations extérieures; on le suppose autochthone, sorti de ce sol duquel le peuple grec prétendait être né lui-même.
Sans repousser complètement l’action des influences étrangères, les partisans de ces théories ne l’affirment pas; et, comme l’ethnographie et l’histoire semblent n’apporter à ce sujet que de vagues présomptions, ils n’y attachent qu’une médiocre importance.
Dès la fin du siècle dernier, les travaux de l’expédition scientifique d’Égypte, en nous initiant à l’art des Pharaons, donnèrent naissance à une opinion nouvelle: on crut trouver dans les monuments des bords du Nil le prototype des formes helléniques. Ce sentiment paraissait rencontrer une confirmation évidente dans des légendes qui, tardivement produites en Grèce, attribuaient aux Égyptiens la fondation d’un certain nombre de villes du Péloponèse et de l’Attique.
Dans notre siècle, la découverte inespérée des monuments de l’Assyrie, les explorations archéologiques de la Perse, de la Phénicie et de l’Asie Mineure, ont eu ce résultat, de déplacer de l’Égypte le berceau de l’art grec et de le transporter dans l’Asie. Les deux contrées ont partagé pendant quelque temps cet honneur; puis, finalement dépossédée au profit de l’Asie, l’Égypte s’est vu dénier jusqu’à la plus minime part d’influence sur l’art hellénique.
Aujourd’hui, la théorie de la filiation des formes, sur laquelle reposent ces derniers systèmes, paraît généralement acceptée. Une connaissance superficielle des monuments antiques suffit, il est vrai, à faire supposer que certaines formes élémentaires, apparues dans des localités déterminées, ont pénétré par une sorte d’irradiation, à des siècles d’intervalle, sous d’autres climats, ont été modifiées par d’autres peuples, transformées peut-être, tout en restant reconnaissables.
Mais ceci complique le problème de l’origine des formes architecturales, au lieu de le résoudre.
Sont-elles, en effet, la conséquence d’une sorte d’atavisme, ou bien doivent-elles être considérées comme des analogies fortuites?
L’expérience que les siècles se transmettent aurait-elle fait rayonner au loin, en dépit des différences de races et de civilisations, les formes similaires, issues d’une origine unique? Ou bien, produites par des causes identiques, seraient-elles nées dans des lieux différents, à des époques indéterminées et précédées des mêmes périodes d’incubation et d’essais?
Enfin, hors les principes invoqués par les théories que nous venons d’analyser, n’existe-t-il pas des sources inspiratrices, intimement liées à la condition de l’œuvre d’art, et dont influence sur l’artiste soit susceptible de constatations?
C’est ce que nous allons demander aux faits, c’est-à-dire aux monuments que le temps a conservés, et nous choisirons pour base de nos recherches l’élément constitutif des ordres grecs, la colonne.
Remonter aux formes primordiales, en suivre le développement, éviter de les séparer de ce qui les précède, et de les dégager de ce qui les entoure; et, à mesure que cette étude se déroulera sous nos yeux, déduire les conséquences: tel est le plan que nous nous proposons.
Nous ne pouvons songer, cependant, à écrire l’histoire des Ordres dans le sens étendu que comporte ce mot; notre seul but est de présenter, dans une esquisse rapide il est vrai, mais longuement préparée, l’ensemble des causes qui ont déterminé les formes grecques.
On chercherait donc en vain, dans cette étude, sur les architectes anciens et sur leurs œuvres, des indications que nous ne fournissons point, parce qu’elles transformeraient chacun de nos chapitres en un volume. A temps voulu du reste, et suivant l’opportunité, nous traiterons plus amplement certaines parties de notre sujet.
Un autre motif a contribué, pourquoi ne le dirions-nous pas, à restreindre le côté purement archéologique de nos recherches. Nous avons trouvé naturel de recourir aux lumières que l’architecte puise dans le sentiment de son art, plus qu’aux ressources de l’érudition: il nous a semblé que, dans une question si intimement liée au principe même des formes, ces lumières devaient être. un guide plus éprouvé et plus sûr.