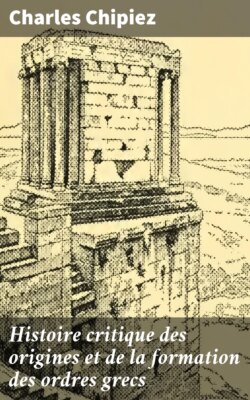Читать книгу Histoire critique des origines et de la formation des ordres grecs - Charles Chipiez - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеTable des matières
Les monuments portatifs élevés par les Hébreux après leur sortie d’Égypte expliquent les modes de construction des édifices représentés dans les bas-reliefs égyptiens. — Emploi des pans de bois fermés et des édicules ouverts. — Composition de la couverture de ces monuments. — Nature ligneuse ou métallique des supports.
On sait qu’une tribu sémitique, devenue plus tard le peuple hébreu, occupait une partie de l’Egypte, et qu’assujettie à des travaux pénibles, elle réussit, à une époque qu’on fixe généralement sous la XIXe dynastie, à se soustraire par la fuite aux exigences de ses maîtres. Or cette tribu, à qui l’art monumental était inconnu avant son arrivée en Égypte, à peine échappée aux périls de sa tentative, éleva au milieu du désert un sanctuaire portatif, qui révèle un art en pleine possession de moyens complexes. Il est bien évident qu’elle ne put demander qu’à la seule architecture égyptienne des formes et une technique. On n’improvise pas un système architectural pendant une migration en pleine Arabie Déserte, et, sans même imiter servilement, on est fatalement astreint à l’emploi des formes connues.
Nous possédons dans l’Exode et dans le livre des Nombres une minutieuse description de ce temple. Elle jette un jour éclatant sur toute une face peu connue de l’art égyptien.
Nous en détachons les particularités suivantes:
1° La construction du tabernacle se composait de poteaux ou de madriers quadrangulaires assemblés. On les avait disposés en montants et en traverses; celles-ci étaient partielles en forme de linteaux, ou s’étendaient sur la longueur des parois en forme de sablières .
Tous ces éléments étaient couverts de lames d’or.
Il suffit de regarder les pans de bois représentés figures I et II pour reconnaître non-seulement la frappante analogie de ce système de construction avec celui du temple hébraïque, mais encore pour apprécier le secours que celui-ci apporte à l’étude des formes égyptiennes. Le revêtement métallique explique clairement les ornements géométriques qui recouvrent les lambris représentés F. II. Sans l’emploi de ce métal, une aussi riche ornementation, appliquée sur une matière aussi pauvre que le bois, ne se comprendrait pas. Les creux et les reliefs légers permettaient en outre de fixer solidement l’or sur les colonnes ligneuses.
On doit supposer que ce mode de construction était usité encore en Égypte au moment du départ des Hébreux, et qu’on l’employait pour des destinations diverses, simultanément avec le système de la construction en pierre. Il s’agit d’un mode réel, qui devait remonter à l’origine des temps, puisque c’est le principe ornemental des plus anciennes constructions en pierre.
2° Le toit du sanctuaire hébraïque consistait en une suite de tentures, qui intérieurement formaient un plafond, et, s’étendant sur les parois, les dérobaient aux regards. Sur ce plafond étaient superposées plusieurs rangées de tentures de cuir, qui recouvraient les faces extérieures, et formaient une enveloppe sur trois côtés de l’édicule. On en avait fixé les extrémités inférieures à des pieux d’airain enfoncés dans le sol.
L’imitation d’un objet réel que nous avons reconnu dans l’appentis de la figure XIV se trouve ainsi confirmée de nouveau. Il est vrai que les tentures placées sur le faîte du tabernacle se développaient probablement sur un plan horizontal: ce devait être la disposition généralement usitée en Égypte. La connaissance que nous venons d’acquérir de la composition de ce système de couverture nous permet d’en fournir la preuve.
Presque tous les édifices ouverts, représentés sur les bas-reliefs, avec ou sans toit, montrent sous l’architrave une rangée de grains terminés en pointe, que l’on considère comme le modèle des oves grecques (F. XIV). Dans quelques bas-reliefs où l’édifice est représenté à une plus grande échelle, et où par conséquent les formes ont été moins abrégées par l’artiste, on voit ces ornements, ces prétendues oves, devenir des grappes et représenter exactement des raisins suspendus, la partie pointue en bas. Ces figures, simplifiées, donnent l’ove (F. XVII). Dans d’autres monuments, ces grappes se métamorphosent en fleurs et en rosaces, suspendues à des lanières ou à des courroies (F. XVIII).
La signification de ces formes est facile à saisir: elles ne peuvent représenter que des poids métalliques attachés aux extrémités des tentures de peaux ou d’étoffes afin de les rendre suffisamment stables. Cette disposition était principalement appliquée dans le but d’éviter toute attache entre les tentures et les architraves, et de les rendre non solidaires de la construction.
Il est clair que, sans cette précaution, le moindre coup de vent aurait suffi à soulever, à renverser le frêle édifice, et l’aurait emporté, tandis que, indépendante de la construction et maintenue néanmoins par des poids suffisants, la couverture ne présentait pas cet inconvénient, auquel les Hébreux avaient paré, ainsi que nous l’avons vu, par un procédé plus énergique.
Or les franges métalliques se rencontrent dans les édicules pourvus du toit triangulaire semblable au melkaf qui surmonte encore aujourd’hui les habitations égyptiennes, et plus souvent encore dans ceux qui en sont privés. On peut donc conclure avec toute vraisemblance que, dans ces derniers monuments, on a indiqué les tentures dont l’Exode révèle l’existence. C’est l’horizontalité qui les rend invisibles dans les représentations des bas-reliefs et des peintures.
3° Dans le tabernacle, le naos était séparé de l’adyton par quatre colonnes de bois, dont les fûts et les chapiteaux étaient recouverts d’or, et les bases d’argent. La largeur du tabernacle atteignant à peine quatre mètres et demi, on peut conjecturer que les quatre colonnes, espacées sur une aussi faible largeur, ne devaient avoir qu’un diamètre extrêmement faible; sans cela, l’entrée du Saint des Saints eût été complètement inaccessible. Enfin les colonnes d’airain qui formaient la clôture du parvis avaient les chapiteaux et les ornements recouverts d’argent.
Les soutiens étaient dans les deux cas couronnés par des chapiteaux métalliques.
Ces remarquables particularités expliquent la sveltesse des colonnes égyptiennes dont nous avons analysé les dispositions, et en font comprendre les formes et les ornements.