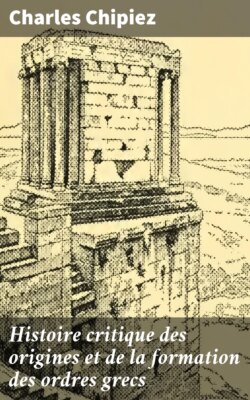Читать книгу Histoire critique des origines et de la formation des ordres grecs - Charles Chipiez - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII
ОглавлениеTable des matières
Les bas-reliefs montrent que le bois formait souvent la matière du fût des colonnes — Au lieu d’un appentis, les edicules étaient recouverts quelquefois d’une legere charpente horizontale. — Valeur significative de l’abaque dans l’architecture légère.
Les bas-reliefs montrent encore que le bois fournissait souvent la matière des supports. Un grand nombre de colonnes ont le fût sillonné par des bandes transversales aux vives couleurs, qui indiquent des peintures ou un revêtement (F. XL) ; mais, fréquemment aussi, les fûts paraissent couverts de dessins géométriques de petite dimension, nombreux et serrés. Quelquefois les ornements semblent contenus dans des alvéoles séparées par de minces cloisons (F. XXIV, XXV, XXVI).
Il est impossible d’y voir autre chose que des incrustations, où l’ébène, l’ivoire et peut-être le métal jouaient un rôle considérable.
On acquiert la certitude de ce fait en comparant l’ornementation des fûts à celle qui recouvre., dans les peintures, les montants de quelques harpes. Celles-ci présentent les mêmes dispositions, les mêmes couleurs, en un mot, les mêmes caractères; or, comme la matière qui formait le squelette de ces instruments était le bois, on doit conclure que cette matière entrait réellement dans la composition des colonnes (F. XXVII)..
Il est à remarquer que ces décorations s’étendaient et se développaient sur l’architrave dès une époque très-ancienne. Le musée égyptien du Louvre possède des fragments de meubles incrustés d’émaux de diverses couleurs sur un fond de bois doré.
Indépendamment de ces particularités, les édifices figurés donnent lieu à plusieurs observations.
L’artiste n’a pas toujours départi des formes semblables aux chapiteaux des colonnes; des différences et même des contrastes accusés les distinguent souvent .
Ensuite, les tentures qui recouvraient les édicules n’étaient pas toujours soutenues par des cordes ou par des courroies; on devait les étendre parfois sur de légères charpentes; cette supposition est confirmée par les observations suivantes:
L’abaque oblong ou carré, qui ne paraît pas représenter en général l’extrémité longitudinale d’une pièce de bois, offre toutefois dans certains cas cette signification. Il est évident que dans la figure XXVIII, par exemple, ce ne peut être autre chose que l’extrémité d’une architrave, à moins qu’on admette l’emploi des ressauts, dont aucun monument égyptien n’offre d’exemple.
La disposition indiquée dans la figure XXIX peut également autoriser cette conjecture; on peut reconnaître dans les abaques qui couronnent les colonnes de moindre dimension, l’existence de solives parallèles, remplaçant les cordons sur lesquels la couverture étoffée se développait. Sur les faces latérales de l’édifice elles formaient une seconde architrave: certains exemples paraissent accuser des poutrelles transversales . Ces charpentes avaient l’avantage de donner à l’édifice une plus grande rigidité .
Les monuments de pierre n’offrent pas de dispositions analogues; l’abaque n’y représente jamais l’extrémité d’une pièce de bois, et les épistyles, ou poutres de pierre, sont placées sur des lignes parallèles, et par conséquent ne se croisent pas (F. XXX).