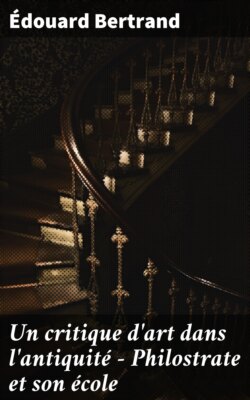Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Les Périégètes: Polémon et Pausanias. — Les Érudits: Varron et Pline.
ОглавлениеA côté de cette brillante école des poètes se place dans la critique ancienne celle des périégètes. On désignait ainsi dans l’antiquité ces infatigables voyageurs qui parcouraient les diverses contrées pour visiter les édifices publics et les temples, apprendre les traditions locales, recueillir les inscriptions, décrire les offrandes, les statues, les tableaux. Les périégètes ne sont pas des connaisseurs pressés de voir et d’admirer les belles choses; ce sont principalement des curieux et des antiquaires. Les plus célèbres ont été Polémon et Pausanias, l’un dont il ne reste que quelques fragments, l’autre dont nous avons encore l’ouvrage. La liste de ceux de Polémon nous montre un archéologue. Il avait décrit les tableaux des Propylées et composé quatre livres sur les offrandes suspendues dans l’acropole. Ce devait être un bien curieux travail que son étude sur les tableaux de Sicyone. D’un passage conservé où il retrace la mutilation d’un tableau de Mélanthios on peut induire qu’il se plaisait à raconter l’anecdote relative au peintre et à son œuvre; et ce qu’il dit en un autre endroit d’un genre licencieux reflétant la corruption des mœurs semble prouver qu’il traitait des différents genres de peinture. En tous cas, la description du tableau et l’explication du sujet étaient sans doute un des objets principaux de son ouvrage. Dans quelle mesure la critique y paraissait-elle, c’est ce qu’il est impossible de déterminer. Peut-être Polémon était-il, comme Pausanias, plutôt un antiquaire qu’un artiste. Il avait, selon toute vraisemblance, le même esprit d’investigation et la même ardeur de curiosité. Pour le mieux connaître, il nous resterait donc à étudier Pausanias dont le livre peut nous donner une idée des ouvrages, aujourd’hui perdus, des périégètes. C’est là que nous devons chercher comment ces voyageurs et ces curieux entendaient l’explication d’une œuvre d’art. Mais c’est une étude qui trouvera mieux sa place plus tard, et que nous ajournerons. Il nous suffit, pour le moment, d’avoir marqué au célèbre périégète son rang parmi les critiques anciens.
Pausanias représente donc toute une école. Il n’en est pas de même de deux autres écrivains que nous devons mentionner en terminant cette revue sommaire de la critique avant Philostrate; nous voulons parler de Varron et de Pline.
Il est difficile de deviner ce qu’a été Varron comme critique d’art. Ce qu’il y a de certain, c’est que Pline se plaît à le citer; on voit qu’il reconnaît en lui un juge éclairé et un érudit; il donne son suffrage comme celui d’un homme qui fait autorité. En critique, Varron a un sentiment personnel. Deux élèves de Phidias, Alcamène et Agoracrite, avaient concouru pour une Aphrodite; celle d’Alcamène a été préférée; Varron prononce que celle de son émule est supérieure. Il loue Arcésilaos «dont les maquettes se vendaient plus cher aux artistes eux-mêmes que les ouvrages des autres» ; il loue encore Pasitélès qui disait la plastique mère de la ciselure, de la statuaire et de la sculpture. Il a connu les artistes qui florissaient de son temps, Posis, auteur de natures mortes, Lala, femme artiste, excellente portraitiste. Il cite encore Sopolis et Dionysios les plus habiles peintres du même siècle, inférieurs cependant à Lala. Amateur distingué, il possède une collection qui renferme des œuvres remarquables: une statue d’airain de la main de Mentor; et, d’Arcésilaos, une lionne de marbre avec laquelle se jouent des amours aîlés, les uns la tenant en laisse, les autres la faisant boire dans une corne, d’autres lui chaussant des brodequins, le tout d’un bloc. Enfin, on a supposé que dans son célèbre livre de imaginibus qui contenait sept cents portraits de personnages illustres rangés par groupes de sept d’après l’identité des travaux, des talents et du génie, il y avait plusieurs hebdomades de peintres .
Mais toutes ces indications sont trop sommaires pour qu’on puisse connaître véritablement ce qu’était le critique dans Varron. C’est lui pourtant qu’il eût été curieux d’étudier, plutôt encore que Pline. Car si dans les questions de goût Varron paraît avoir eu une opinion propre, il semble que Pline se soit toujours borné à recueillir celle des autres. C’est un simple compilateur; il a sous les yeux les livres des Grecs et les copie. Il enregistre tout, les jugements aussi bien que les faits. Ce n’est pas qu’il soit dépourvu comme Pausanias de tout sentiment artistique. Il a pénétré dans les ateliers. Dans celui de Zénodote, ce célèbre artiste que Néron avait fait venir de la Gaule pour le charger de l’exécution de sa statue, il a admiré non seulement le modèle d’argile de cette statue, mais encore les essais en petit, premières esquisses de l’œuvre . Il parle quelque part, en connaisseur, des ébauches des maîtres, de ces premiers linéaments où s’est déjà imprimé leur génie . La vue d’un tableau placé par Auguste dans sa curie provoque de sa part une réflexion élevée sur la puissance de l’art qui avec un motif vulgaire sait créer une œuvre immortelle . Enfin, la mention des beaux ouvrages d’art qu’il énumère semble être une jouissance intime pour son esprit . Mais, d’autre part, c’est sans s’émouvoir qu’il parle de la mutilation de deux magnifiques tableaux d’Apelle qu’une main brutale, par l’ordre de Claude, avait profanés. Il se contente de citer la Vénus Anadyomène du même maître sans dire un seul mot de cette œuvre divine qu’a célébrée l’antiquité tout entière. En revanche, recueillant une absurde anecdote, il conte avec le plus grand sérieux que pour juger un tableau qui représentait une cavale, Apelle en appela des hommes aux chevaux. Et comme l’animal amené devant la peinture hennissait: «Voilà un cheval, aurait dit l’artiste à Alexandre, qui est plus connaisseur que toi.» Pline ajoute gravement que cette épreuve pour juger de la vérité d’un tableau fut plusieurs fois renouvelée dans la suite.
C’est avec la même simplicité crédule que Pline recueille toutes sortes d’anecdotes analogues, contes ironiques d’atelier, ou récits inventés par les cicérones de l’antiquité pour étonner une curiosité naïve. Tandis que, d’un côté, il puise dans leur répertoire ces futilités, de l’autre, il tire de quelque savant traité des considérations d’un haut intérêt sur la ligne de Parrhasius ou le modelé du bœuf de Pausias. Il se plaint quelque part que l’encombrement des devoirs et des affaires empêche, à Rome, tous les citoyens de contempler les objets d’art; pour les admirer, en effet, ajoute-t-il, il faut du loisir, du silence et de la tranquillité. Peut-être ces avantages manquent-ils également au critique pour pouvoir juger et penser par lui-même. Aussi est-ce la simple nomenclature des artistes et de leurs œuvres qui occupe la plus grande place dans les chapitres qu’il a consacrés à l’art. A peine dans cette sèche et froide énumération peut-on relever quelques brefs jugements.
Tel est l’exposé sommaire de l’histoire et des doctrines de la critique ancienne avant Philostrate. Le plan de notre travail nous interdisait d’insister sur tous ces points qui certainement demanderaient des recherches plus étendues; mais, d’autre part, il ne nous était pas permis, à ce qu’il nous semble, d’aborder l’étude du genre perfectionné par le sophiste grec sans chercher dans le passé ses glorieux titres, et sans considérer en particulier, comment l’antiquité, aux belles époques de l’art et du goût, avait interprété ses chefs-d’œuvre.