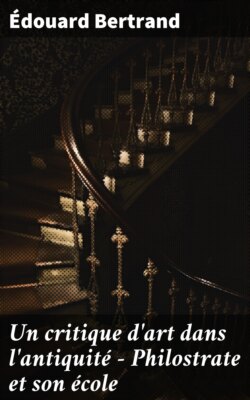Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Les Artistes: Apelle et Lysippe. — Les Philosophes.
ОглавлениеIl ne pouvait être permis qu’à Apelle de décerner à ce public intelligent un hommage si flatteur et de le mettre au-dessus de lui-même. Car, à vrai dire, Apelle semble, en cela comme dans le reste, avoir été au-dessus de tous. Qu’il serait intéressant de connaître comment tous ces savants peintres de l’antiquité jugeaient une œuvre d’art, quels principes les guidaient dans leur appréciation! Leurs écrits contenaient-ils de la critique? Il est probable, du moins si on en juge par les titres, qu’ils étaient tout entiers consacrés à la doctrine. De tout temps, les artistes ont plus aimé à produire qu’à raisonner; le génie qui crée et le goût qui juge ne vont pas ordinairement ensemble; et pourtant, qu’on serait heureux de voir les artistes appréciés par les artistes! «Combien de finesses, insaisissables pour notre œil, les peintres ne voient-ils pas dans les ombres et le modelé ?» disait Cicéron; et Pline le jeune déclarait que seul l’artiste peut juger le modeleur, le statuaire, le peintre . Relativement à la critique des maîtres, on en est donc réduit à recueillir et à interroger quelques mots qui leur ont échappé et que la tradition a conservés. Mais comme ces mots sont instructifs pour ceux qui savent les comprendre! Ils résument toute une doctrine.
Sans rechercher ce que les autres peintres ont pu être comme juges de l’art, tenons-nous en au seul Apelle. On peut dire que s’il fut le plus grand artiste de son siècle, il en a aussi été le critique le plus éminent. Tel il est permis de l’entrevoir dans Pline . Il a possédé en effet les dons les plus élevés du critique. Avec la science consommée, il a la sagacité, la pénétration et surtout la haute impartialité de la raison et du goût. Le moment est propice pour la critique: l’art est arrivé à la pleine possession de toutes ses ressources; ses lois ont été déterminées, celles du dessin par Parrhasius et celles du clair-obscur par Zeuxis; Apelle lui-même a fixé les principes de la couleur. Les talents les plus riches, les plus variés, s’offrent à l’étude et à l’analyse. Il faut voir avec quelle admirable clairvoyance de génie Apelle les comprend, avec quelle sincérité il lès admire et quelle autorité il les juge. Il rend justice à tous ces talents, et aussi au sien . Il rapporte toutes ses décisions et tous ses jugements à un principe supérieur, celui de la grâce, cette grâce qui est le don exquis des Grecs, et dont son génie semble avoir été la suprême expression. Qu’est-ce que la richesse et l’éclat auprès de cette grâce divine? «Ne pouvant la peindre belle, tu l’as faite riche », disait-il à un jeune artiste empressé à lui montrer une Hélène toute couverte d’or qu’il venait d’achever: mot profond qui est toute une théorie de la beauté et toute une doctrine du goût. Cette grâce légère est ennemie de l’effort; elle repousse tout excès. La mesure, une exquise mesure, voilà le grand axiome de ce maître éminent et de cet admirable critique. «C’est une grande faute chez l’artiste, disait-il, de ne pas savoir comprendre ce mot: Assez! » Par là Apelle mérite de représenter la critique chez les artistes; il a su déterminer le principe suprême et en donner la formule. Il apprécie, du reste, dans un tableau toutes les parties de l’art avec une rare fermeté de jugement: l’ordonnance qu’il trouve supérieure dans Mélanthios, le peintre savant, les mesures ou les proportions qu’il admire dans Asclépiodore, l’exécution qu’il critique dans Protogène auquel il reproche un fini excessif. «Il ne sait pas, disait-il de ce dernier, lever la main de dessus le tableau .» On conte que lorsque celui-ci lui montra son Ialysus, Apelle fut saisi et resta quelque temps silencieux; puis, après avoir examiné attentivement ce tableau qui avait coûté à son auteur un si laborieux effort de dix années: «Grand est le travail, dit-il, et grand l’artiste! Mais la grâce manque, cette grâce qui rend une œuvre divine .» Et c’est ainsi que ce maître convaincu revenait toujours à son principe.
Rien, à nos yeux, ne prouve mieux la libéralité de son goût que la haute estime et la sympathie qu’il accordait au talent de Protogène. En effet quel esprit différent du sien! Si son génie est facile et brillant, celui de Protogène est laborieux. Toute la vie de ce dernier semble un long effort, et son acharnement au travail est sans exemple. Très pauvre au début, il apprend la peinture sans maître et reste jusqu’à sa cinquantième année livré à une tâche obscure. Il produit peu, péniblement; et son talent est longtemps méconnu. Pendant qu’il travaille à l’Ialysus, il se met au régime, vivant de lupins cuits à l’eau pour conserver entières la liberté et la vigueur de sa pensée. Rencontre-t-il une difficulté, il cherche à la vaincre avec une force de volonté incroyable; son esprit est tendu; indigné contre le coin maudit du tableau, il gémit sur l’impuissance de son art et lance son éponge avec colère. Pour donner plus de solidité à son travail, usant d’un procédé nouveau, il met jusqu’à quatre couches successives de couleur . Tant d’efforts devaient aboutir à une peinture savante, sans doute, mais peut-être un peu lourde et chargée, contraire en cela au goût exquis d’Apelle et aux grâces légères, de son pinceau. Mais celui-ci n’en admire pas moins l’immense labeur et le scrupule inquiet du maître poussé jusqu’aux dernières limites de la science; il sait comprendre ces beautés différentes; il les proclame même supérieures aux siennes, et ne se réserve qu’un seul avantage, tant sa candeur égale son génie !
Un dernier mot d’Apelle semble nous révéler un autre point de vue de sa critique. Il n’admettait pas que l’on exigeât de l’artiste qu’il rendit compte de sa fantaisie. Quelqu’un lui demandait pourquoi il avait représenté la Fortune assise: «C’est, dit-il ironiquement, qu’elle n’est pas debout», refusant ainsi de soumettre à une raison étroite les caprices de son imagination d’artiste.
Là tradition ne nous a conservé qu’un bien petit souvenir de la critique des autres maîtres. Quelques mots d’eux cités çà et là, voilà ce qui nous en reste . Apelle qui les jugeait si savamment était à son tour jugé par eux. C’est ainsi que Lysippe critiquait dans le portrait d’Alexandre la foudre que le héros tenait à la main, cette foudre si célèbre par son relief. Pour lui, représentant le roi macédonien, il lui donnait une simple lance, détail plus vrai, disait-il, et véritable attribut du prince . Soucieux avant tout de la vérité, il faisait aussi pencher la tête d’Alexandre pour reproduire son attitude ordinaire; Apelle, au contraire, tout préoccupé d’idéaliser la figure, modifiait, au lieu de les copier d’après nature, les tons du visage et de la poitrine , afin de mettre la coloration en harmonie avec cet attribut dont la solennité choquait le goût de son rival. Il est évident que le jugement comme la pratique de ce dernier appartiennent à une autre école que celle d’Apelle. Qu’il serait intéressant de comparer la critique des deux maîtres et de retrouver d’ans l’une et dans l’autre une doctrine représentant deux arts si différents: un art idéal et un art réaliste.
Si les artistes créent le beau, les philosophes en analysent la nature et en déterminent les lois. Ce sont eux qui dégagent les règles et formulent les doctrines. Ce que les artistes leur ont enseigné, ils le généralisent et le rattachent à un ensemble de vérités supérieures, réunissant en un système toutes les observations éparses. Tout le monde connaît ces deux admirables entretiens de Socrate avec Parrhasius et avec Cliton , où, en posant les principes de l’art, il fixe en même temps ceux de la critique et du goût. Si rien n’est plus élevé que le dialogue reproduit par Xénophon, rien aussi n’est plus piquant et plus vrai que le rôle de Parrhasius qui apprend de la bouche de Socrate ce que lui-même, par ses œuvres, a enseigné au philosophe. En effet, c’est en étudiant les ouvrages des artistes que celui-ci s’est rendu compte des lois de la beauté, et c’est grâce à eux qu’il peut les leur expliquer. Parrhasius est surpris; ces lois, il les connaissait bien; un instinct supérieur les lui avait, révélées; mais il croit presque les apprendre, parce qu’elles se montrent à lui avec une clarté, une précision et une autorité tout à fait nouvelles. Ce qui n’était chez lui qu’une intuition confuse devient une vue nette; le sentiment se change en science.
Socrate lui enseigne donc que l’expression est la première loi de son art; que la véritable beauté est la beauté morale; que c’est l’âme qu’il faut peindre et la vie qu’il faut reproduire. Ces vérités qui, dégagées des œuvres de l’art par la réflexion et l’analyse, retournaient des philosophes aux artistes servirent de bonne heure de fondement à la critique. Ce que nous appelons l’expression morale était dans son langage la peinture des mœurs. C’est comme peintres des mœurs (éthographes) qu’Aristote apprécie les artistes; c’est d’après ce principe qu’il met un haut prix au talent de Polygnote et place ce maître au-dessus même de Zeuxis. Pline qui nous transmet les réflexions des critiques anciens est d’accord sur ce point avec Aristote, Il loue maintes fois chez tel ou tel maître l’habileté à peindre les mœurs, et on sent que c’est le premier mérite à ses yeux. Si Alexandre assigne au seul Lysippe le privilège de faire ses statues, c’est parce que lui seul savait imprimer sur l’airain l’âme du prince et son caractère avec la forme de son visage. Les autres, au contraire, se bornaient à rendre l’inflexion de son cou sans pouvoir saisir la force et la hardiesse de ses traits.
Dans son entretien avec Parrhasius, Socrate est un ingénieux interprète de ces vérités. Nous ne voulons pas y insister en ce moment. Il nous suffit dans cette revue sommaire de la critique ancienne d’avoir assigné leur place à ces pages élevées où elle fait entendre ses grandes maximes. Encore moins est-il possible d’exposer ici les théories de Platon et d’Aristote en ces matières. La métaphysique de l’art est étrangère à notre sujet, et ce qui nous intéresse parmi ces questions sera traité lorsque comparant la doctrine de Philostrate à celle de ces grands penseurs, nous montrerons que le sophiste n’a fait que reproduire, en disciple fidèle, leur tradition.
Laissant donc de côté les hautes spéculations de la critique, passons tout de suite à ses grandes écoles. Nous en distinguerons deux bien différentes, celle des poètes, et celle des périégètes.