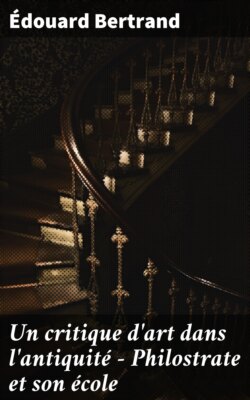Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La littérature. — Curiosité des esprits tournée vers les questions d’art; Dion Chrysostôme. — Mode de la description; ambition nouvelle de la prose; les sophistes.
ОглавлениеSi de la société nous tournons nos regards vers la littérature, nous verrons la curiosité des esprits appelée sur l’art, son histoire et ses théories: condition nouvelle encore favorable au développement de la critique. Ces chapitres si inattendus où, à l’occasion des métaux et des terres, Pline vient à parler des couleurs, puis de l’art et des artistes, ne prouvent pas seulement l’érudition personnelle de l’auteur, ils répondent certainement aux goûts du siècle. Si Pline n’avait pas cru pouvoir plaire à ses contemporains par cette digression, se serait-il écarté aussi étrangement de son sujet? N’est-ce pas à la même disposition que s’adresse Plutarque, lorsque dans ses oeuvres morales il sème tant d’observations curieuses relatives à l’art et aux questions qui s’y rattachent, touchant ici à la haute esthétique, avec discrétion, mais avec un sens très droit et très juste, jetant ailleurs un coup d’œil en passant sur les diverses écoles de peinture, hasardant même parfois certaines notions techniques, comme ce qu’il dit quelque part des tons rompus et de la demi-teinte découverts par le vieux peintre Apollodore? Combien de vues et de renseignements divers! Toutes ces idées éparses dans ses écrits, ne sont-elles pas un nouveau témoignage de la curiosité qui portait les esprits vers ce genre de questions? Une préoccupation analogue se trahit jusque dans l’école: de là, chez Quintilien, ces rapprochements ingénieux entre l’art et l’éloquence. Toutes ces remarques empruntées à la peinture et à la sculpture, les eût-il glissées dans son ouvrage, ce rhéteur d’une si judicieuse érudition, s’il n’avait pensé qu’elles trouveraient des esprits tout prêts à les accueillir avec faveur? Faut-il rappeler encore Elien et ses anecdotes, Pausanias et ses descriptions? Partout, dans la littérature, la pensée est rappelée vers l’art. Mais ce qu’il y a surtout de remarquable c’est de voir les grandes questions d’esthétique encore agitées en ce siècle et intéressant les esprits. Ici, il ne s’agit plus d’allusions ni d’aperçus rapides, mais d’un important morceau, d’un monument de haute critique. Nous voulons parler du discours de Dion Chrysostôme où, par un ingénieux artifice, ce rhéteur suppose que, devant la Grèce assemblée à Olympie, l’auteur du Jupiter, Phidias, rend compte de son œuvre et explique les procédés de son art . Deux parties surtout sont du plus haut intérêt: celle où le grand artiste compare les moyens qu’offre la sculpture avec ceux dont dispose la poésie, et celle où il fait connaître comment il a conçu son Jupiter. Rien de plus élevé que la première où les rapports des deux arts sont exposés avec une sagacité et une pénétration éminentes, où le grand sculpteur montre une si profonde intelligence du sien, de ses ressources et aussi de ses limites, où enfin des considérations pleines de finesse et de profondeur annoncent déjà les savantes analyses de Lessing. Et quant à la seconde, comme le Jupiter d’Olympie est magnifiquement interprété ! Comme l’auteur, par la bouche de Phidias, explique avec une remarquable supériorité de vues la pensée et les intentions de l’artiste essayant de répondre à la fois, dans la représentation du dieu, et à l’idée de la majesté divine, telle que la concevait l’imagination populaire, et aux conditions de son art! Ainsi, les hautes théories dans lesquelles s’était plu l’antiquité étaient encore goûtées de ce siècle. Si de ce morceau éloquent on rapproche ce que Philostrate a écrit sur l’art en général, on verra que les grandes doctrines du goût s’étaient maintenues, et que la critique y pouvait puiser ses principes et ses inspirations.
La mode de la description et l’ambition nouvelle de la prose répondent à ce mouvement d’idées artistiques. Décrire l’œuvre d’art est le premier pas du critique; or, ce genre de description paraît avoir été fort goûté au deuxième siècle de l’ère chrétienne. Déjà Catulle, déjà Virgile avaient, en vers élégants, retracé des tableaux. Ce goût se propage; tous les poètes rivalisent. Stace décrit l’Héraclès de Lysippe dans un style prétentieux, mais où se distingue ce trait heureux qui peint si bien l’effet de la justesse des proportions:
. ....parvusque videri
Sentirique ingens .
Il décrit aussi la statue équestre de Domitien. Même description chez Martial. Apulée, dans ses Florides, retrace également une statue. C’est un genre en faveur qui a un nom particulier . Pline le Jeune hérite d’une statuette représentant un vieillard. Il se hâte d’en reproduire les traits dans sa prose avec un juste sentiment de l’art, et ce bronze lui offre le motif d’un charmant croquis. Les finesses sont bien vues et bien indiquées quoique l’auteur déclare qu’il n’est pas connaisseur . Plus tard Elien, dans le même goût, décrit un tableau de Théon où se voyait un guerrier volant au combat. Chose curieuse: les poètes après avoir si longtemps inspiré les artistes s’inspirent d’eux à leur tour, et se souviennent de leurs œuvres. N’est-ce pas à la statuaire qu’Ovide doit plus d’un trait de sa peinture des Niobides expirant sous les flèches d’Artémis et d’Apollon? Et ce geste si dramatique de la mère défendant sa dernière fille, n’est-ce pas au même art qu’il l’a emprunté ? Un motif célèbre dans l’histoire de l’art, c’est Achille à Scyros. Dans les vers de Stace qui redisent cette aventure on reconnaît que la pensée du poète se reporte sans cesse vers les œuvres de l’art, et ce passage est un commentaire des tableaux et bas-reliefs dans lesquels l’antiquité avait retracé ce motif. L’indication de la scène, telle qu’elle est représentée par l’art, y est très exacte. Tout est là : les vêtements de femme que repousse le jeune héros, cette attitude hardie et ce pas gigantesque que lui prêtait la tradition. Dans Lucain, Heraclès terrassant Antée offre plus d’un trait demandé à l’art.
La description devient tellement à la mode qu’elle donne lieu aux plus ridicules excès. Lucien raille un écrivain qui avait rempli tout un volume de la description du bouclier de l’empereur. Cette manie gagne jusqu’aux historiens. Le même Lucien en cite un qui, dans un moment critique, parlant d’une caverne où s’est réfugié le général ennemi, se met à décrire les touffes de lierre, de myrte et de laurier qui entremêlent leurs rameaux pour l’ombrager.
A ce développement du genre descriptif s’allie une ambition nouvelle de la prose. Cette belle langue grecque, si féconde en ressources, qui s’était prêtée avec une incomparable souplesse à toutes les formes de la pensée et du sentiment, aux plus subtiles analyses du raisonnement comme aux mouvements les plus passionnés. de l’éloquence, cette langue, disons-nous, a une aspiration nouvelle: elle veut rivaliser avec la peinture; elle veut traduire les formes et les couleurs par les mots. «Il est reconnu, dit Elien, que la prose est aussi capable de peindre tout ce qu’elle veut que les artistes.» Lucien lui-même, par son exemple, atteste ce goût nouveau. Lui dont la prose est si fine et si sobre dans son exquise élégance épuise toutes les richesses du langage pour décrire un paon; l’élégance des mouvements, le luxe des tons, il prétend tout reproduire par la puissance de l’expression.
Cette prétention nouvelle de la langue s’accentue de plus en plus. Plus tard, le sophiste Himère déclare que la prose est supérieure «à la cire » c’est-à-dire à la palette. Cette prose nouvelle qui recherche la couleur et l’effet, poursuit le pittoresque et ne s’adresse plus à l’esprit, mais aux yeux pour lesquels elle retrace les lignes et les contours, décrit les formes et les attitudes, c’est la prose artistique qui avec la prose poétique était alors en honneur.
Ceux qui cultivèrent avec le plus d’ardeur le genre descriptif et cette prose nouvelle, ce furent les sophistes; c’est aussi chez eux que naquit la critique d’art. Tout en déplorant les abus de l’esprit sophistique, on ne peut nier qu’ils ne fussent des hommes distingués qui avaient gardé dans leur cœur la passion des belles choses . Ils aiment la gloire passée et en entretiennent le culte dans la jeunesse. Leur style est raffiné, mais leur enthousiasme sincère. Le goût de l’art, si vif dans Philostrate, ne lui est pas particulier. Hérode Atticus fut un amateur distingué. Possesseur d’une immense fortune, il en fait au profit de l’art le plus magnifique usage, dotant les villes de statues. A Corinthe, dans le temple de Jupiter Isthmien, il consacre un superbe groupe d’Amphitrite et de Poseidon avec l’enfant Palémon portés sur un quadrige, composition gigantesque de sculpture chrysoéléphantine. Il donne aussi à la même ville une Aphrodite armée. A Olympie, il remplace par deux statues nouvelles les antiques images de Déméter et de sa fille. Ses parcs sont ornés des statues de ses fils représentés en costume de chasse. La tradition de ces goûts artistiques se perpétue chez les sophistes, et un siècle après, Himère accueillant à Athènes des Ioniens qui viennent la visiter leur montre avec orgueil cette cité si pleine de grands souvenirs; mais ce sont surtout les monuments de l’art qu’il leur fait voir, c’est la Bataille de Marathon œuvre du vieux Polygnote, c’est la Minerve, c’est l’Apollon de Phidias. Ainsi ces sophistes ne sont pas de purs lettrés, ce sont aussi des artistes. Ce que Philostrate, dans ses différents écrits, dit sur la peinture, prouve que ces questions d’esthétique étaient agitées parmi eux et les intéressaient. Peut-être le maître en entretenait-il quelquefois ses élèves. Il était impossible que de ce milieu ne sortit pas la critique. Des amateurs distingués qui, animés de la passion de l’art, en possèdent la théorie et en admirent les œuvres, devaient être conduits à la description et à l’analyse de ces mêmes œuvres, surtout lorsque ces amateurs étaient en même temps des hommes de style, des écrivains possédant tous les secrets de la langue et trouvant dans ce genre un nouvel et brillant usage de leur talent.
Il faut, en effet, considérer en dernier lieu dans quelle situation se trouvaient ces esprits distingués, réduits à s’exercer éternellement sur des sujets rebattus. Tout avait été dit, et l’on venait trop tard. Combien de fois n’avait-on pas disserté sur l’éloquence et exposé ses règles! Ecrire sur la tragédie, comme fit le père de Philostrate, était-ce un sujet bien neuf? C’était, toutefois, une question encore intéressante au prix de toutes ces déclamations de l’école sur des thèmes usés, souvent ridicules, qui faisaient outrage au bon sens et à la vérité. On conçoit qu’un immense besoin du nouveau possédât les esprits. Il faut entendre Himère faire un appel désespéré à la jeunesse. Au lieu de s’attacher aux anciennes formes de l’art, il faudrait, s’écrie-t-il, tenter quelque œuvre nouvelle d’une invention ingénieuse; et il ne craint pas de citer d’ambitieux exemples. Ce qui a rendu puissant Phidias et les autres artistes dont la main savante excite notre admiration, c’est une incessante invention. Selon lui, la jeunesse de Dionysos, voilà le symbole de cet éternel rajeunissement de l’art . C’étaient là sans doute chez le rhéteur de généreuses aspirations. Mais ce nouveau à la poursuite duquel il convie la jeunesse, où le prendre? Impuissant à le trouver dans les sujets, Himère le cherchait dans le style, et raffinant sans cesse sa langue, il songeait à lui donner quelque chose de rare par l’agrément des tours et l’imprévu des ornements. Pour apprécier ces efforts, le lecteur ordinaire ne lui suffisait pas; il réclamait des connaisseurs.
Tourmenté de la même ambition, Philostrate s’était aussi créé un style singulier composé d’archaïsmes et de néologismes. Mais il eut un jour une pensée neuve, et ce jour-là il créa un genre qui lui survécut et suscita des imitateurs: il créa la critique d’art. Il nous explique lui-même dans sa préface pourquoi il la choisit. Dans le domaine de l’art il ne restait plus qu’elle à prendre pour le lettré ; tout le reste était épuisé. Ainsi, il ne fallait plus songer à écrire l’histoire des peintres: tout a été dit sur les grands maîtres; ni celle des amateurs: on a loué les rois et les cités qui se sont distingués par la passion de l’art. Non seulement ces sujets ont été bien des fois traités; mais il y a un récent ouvrage d’Aristodème de Carie, un habile homme, peintre lui-même parlant des peintres. La théorie de l’art a aussi été exposée dans de nombreux ouvrages. Beaucoup ont écrit sur la symétrie; il y a depuis longtemps sur ce sujet de savants livres. On a aussi traité la question des rapports de la poésie et de la peinture d’une manière brillante. Il n’y a plus que la critique; c’est un sujet neuf: il va donc l’aborder.