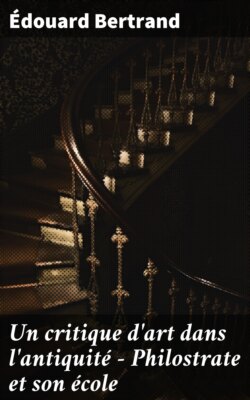Читать книгу Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son école - Édouard Bertrand - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
Ce serait une étrange erreur de s’imaginer que l’antiquité puisse nous offrir même une faible image de ce que notre siècle appelle la critique d’art. Il n’y a rien de pareil chez les anciens; cette critique, telle que nous l’entendons, est une science toute moderne. C’est au XVIIIe siècle qu’elle paraît pour la première fois, et avec éclat, créée par le spirituel auteur des Salons. Aujourd’hui, elle est représentée par des écrivains d’une sagacité rare, d’une science et d’une autorité éminentes, grâce auxquels elle a conquis dans notre littérature un rang distingué. Ses progrès rapides sont dus au mouvement particulier d’idées qui domine dans notre temps, à cette disposition des esprits tournés vers l’érudition, vers la curiosité et l’analyse dans toutes les branches des connaissances, en philosophie, en histoire, en littérature. L’étude de l’art ne pouvait échapper à cette loi. Aux spéculations métaphysiques qui ont passionné certaines époques la critique a succédé, une critique ingénieuse, érudite, pleine d’ardeur dans ses recherches, de profondeur et de variété dans ses vues. Aidée de l’esthétique et de l’histoire, ses deux puissants auxiliaires, quelquefois de l’archéologie, initiée de plus en plus à ces secrets que révèle seul l’atelier, à ces mystères du procédé et de la couleur longtemps réservés aux artistes et qu’elle leur dérobe, elle poursuit ses travaux avec une remarquable activité. Par elle une œuvre d’art est savamment décrite, expliquée, jugée. L’esprit de cette œuvre, ses caractères particuliers, la conception et la disposition générale du sujet, les combinaisons profondes de l’art, le dessin, la couleur, le clair-obscur, la perspective et tous leurs artifices, l’exécution, la touche même avec le secret de ses effets variés, rien n’échappe à ses investigations et à ses analyses. Elle raisonne, discute, relève les qualités et les défauts, rend compte des uns et des autres. S’il en est besoin, elle replace l’œuvre dans le milieu où elle s’est produite, l’explique par les circonstances de la vie de l’artiste, par les tendances particulières de son esprit, ou les doctrines de l’école à laquelle il appartient; puis, passant à des influences plus générales, à des causes plus profondes, par le génie des temps et des peuples divers, par la nature des climats, des institutions, des mœurs, des idées de chaque société et de chaque âge. Pour cela, elle recueille mille documents de toute sorte, mille renseignements qu’elle demande à la biographie, aux mémoires, à la poésie, aux traditions. Ainsi étudiée et interprétée, une œuvre d’art n’a plus de secrets pour nous. Sa nature intime, son intérêt, sa valeur, tout nous est expliqué : la pensée de l’artiste qui l’a conçue et exécutée se révèle à nous dans une pleine lumière. Telle est la critique d’art comme la comprend notre siècle, science véritable qui, pour s’éclairer et se guider, invoque le secours de plusieurs autres, et qui apporte à ses recherches l’exactitude, la précision et la curiosité infinie de l’esprit moderne.
Ce simple aperçu suffit pour nous avertir que l’antiquité n’a jamais rien connu de pareil, ni même d’approchant, la science que nous venons de définir en quelques mots étant tout à fait étrangère à son génie. Ce n’est même que très tard, vers la fin du IIe siècle de l’ère chrétienne, qu’on voit naître dans la littérature un genre nouveau qui peut s’appeler la critique d’art; et encore de profondes différences le distinguent-elles de ce que nous entendons nous-mêmes par ce mot. C’est ce genre que nous nous proposons d’étudier dans Philostrate l’Ancien; quoiqu’il existât avant lui, qu’il fut même cultivé dans l’école des rhéteurs, ce sophiste en a offert de si brillants modèles qu’il peut en être considéré comme l’inventeur. Il semble en avoir fixé les lois; il fit même école, et eut de nombreux imitateurs. Ce genre dont il avait rehaussé l’éclat fut plus que jamais en honneur. On en trouve des traces partout, chez les sophistes, les poètes, les romanciers, jusque chez les Pères de l’Eglise et dans la chaire chrétienne. Sous les empereurs byzantins, il rencontre encore un interprète distingué, le sophiste Choricius dont les ouvrages nous présenteront de curieux essais de la critique dans l’art chrétien et l’art païen. Près de lui se groupent Christodore et Paul Silentiaire. Après viennent Photius, puis George Pachymère, Manuel Philé, et Marcus Eugénicus. Avec ces derniers noms se termine l’histoire littéraire du genre qui est l’objet de nos recherches.
Cette étude qui serait incomplète si nous ne considérions pas ce que la critique d’art est devenue après Philostrate, perdrait également une partie de son intérêt, sans un coup d’œil jeté sur ce qu’elle a été avant lui. En effet le genre littéraire proprement dit ne date, il est vrai, que de ce sophiste; mais la critique elle-même est aussi ancienne que l’art.
Au milieu de la diversité des discussions que dans le cours de notre travail feront naître l’art et le goût, de la multiplicité des analyses qu’ils exigeront pour éclaircir tant de délicats problèmes, notre point de vue sera toujours le même, et une question dominera toutes les autres. Comment un ancien comprenait-il une œuvre d’art? Que remarquait-il, avant tout, dans un bas-relief, une statue, un tableau, et quelles étaient les beautés qui avaient le plus de prix à ses yeux? Sans écarter l’archéologie, si fort goûtée aujourd’hui, et à laquelle nous demanderons quelquefois des lumières, ce n’est pas toutefois sur le terrain de ses recherches et de ses études que nous prétendons nous placer. L’antiquité a apprécié elle-même ses chefs-d’œuvre; c’est de cette interprétation que nous voulons rechercher l’esprit, la doctrine, la méthode. Esquisser rapidement son origine et sa première histoire, tel sera l’objet de notre introduction. Nous la considérerons successivement dans le public et chez les artistes; puis chez les philosophes, les poètes et les périégètes. Enfin, la recherche des causes qui préparèrent l’avènement de la critique d’art nous conduira à l’étude de Philostrate et de ses disciples parmi lesquels Choricius arrêtera surtout notre attention.
La première édition de Philostrate a été publiée à Venise par les Aides, in-8°, 1503. L’examen du livre prouve que les manuscrits dont s’est servi l’éditeur étaient très corrompus. En 1709, Oléarius donne à Leipsick une nouvelle édition critique qui présentait un singulier contraste de qualités et de défauts. Jacobs s’aidant du concours de Welcker publie en 1825 les Tableaux accompagnés d’un commentaire très important, à la fois philologique et archéologique. En 1844, Kayser profitant du travail précédent fait de nouveau paraître Philostrate avec indication de toutes les leçons, Cette récension savante du texte l’amène à une très grande pureté et facilite la tâche du dernier éditeur, Firmin Didot qui ayant confié à Antoine Westermann le soin d’une révision encore plus soigneuse et plus attentive publie en 1850 une excellente édition qu’on peut regarder comme définitive.
En 1578 Blaise de Vigenère donnait une traduction de notre auteur sous ce titre: Les images ou tableaux de platte peinture de Philostrate Lemnien, sophiste grec, décrits en trois livres, avec arguments et annotations sur chacun d’iceux, par le traducteur. Paris, Nie. Chesneau, 1578, in-4°, 2 vol. En 1609 parut une troisième édition du même ouvrage, in-fol. Paris, Cramoisy, dans laquelle les tableaux étaient représentés «en taille douce avec des épigrammes sur chacun d’iceux, par Thomas d’Embry.» La sixième et dernière édition de cette traduction est de 1637, in-fol.
De Choricius il n’existe qu’une édition publiée par M. Boissonnade en 1845. Cette édition n’est pas complète. Des morceaux inédits du même auteur ont été donnés par M. Graux en 1877, dans la revue de philologie. Un manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial renferme de nombreuses pièces qui n’ont pas encore vu le jour. (Regiæ Bibliothecæ Matritensis Codices Graeci m. ss. Jo. Iriarte, Matriti 1779, in-fol. n° CI, p. 406).