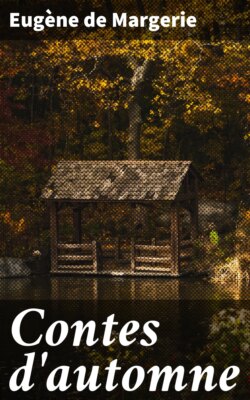Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
DE VINGT-CINQ A CINQUANTE.
ОглавлениеTable des matières
On a dit: «Bienheureux les peuples dont l’histoire est ennuyeuse!»
Je n’en saurais dire autant de mon humble individualité.
J’avais vingt-six ans, lors de ce mariage manqué que raconte le chapitre précédent.–Depuis, jusqu’à ce que j’atteignisse ma cinquantième année, rien de moins dramatique, de plus ennuyeux que mon histoire.
Rien de moins heureux que moi, cependant.
Ce qui me rendait malheureuse, ce n’était pas, bien entendu, la monotonie de mon existence.
Le bonheur ne consiste pas dans les soubresauts.
Le bonheur consiste dans la paix.
Comment eussé-je été en paix avec Dieu, à qui j’avais, pour ainsi dire, déclaré la guerre? en paix avec moi-même, moi souvent la proie des remords, toujours du doute?
Par suite d’un enchaînement de circonstances que je vous ai contées,–et dont le premier anneau était l’orgueil,–j’avais abandonné Dieu; je métais enrôlée parmi ses ennemis.
Depuis, malgré les solennelles adjurations de mon père mourant, malgré l’incident de Léopold, malgré les avertissements nombreux que me donnèrent et les choses et les gens, j’avais persévéré dans ma révolte. Mais jamais la conviction–la conviction de l’incrédulité–n’était entrée dans mon âme.
C’est même trop peu dire.
Quand je voulais être tout à fait de bonne foi avec moi-même–même lorsque j’eusse préféré me faire illusion–je me disais que j’étais dans une mauvaise voie, que je ne m’y trouvais pas à l’aise, que, si la chose était à refaire, très probablement je ne la referais pas.
Mais que voulez-vous? me répondais-je à titre de conclusion, jamais je n’aurais le courage de revenir sur mes pas.
–Jamais! Est-ce bien sûr?
–Toujours pas avant l’article de la mort.
Avais-je au moins la paix avec mon prochain, avec ceux et celles au milieu desquels s’écoulait ma vie?
Hélas! Ici encore ce n’était qu’une paix relative, qu’un simulacre de paix.
Ma position, vis-à-vis des miens, avait quelque chose d’étrange et de singulièrement délicat.
J’étais la bienfaitrice de toute la famille.
J’avais marié et doté l’un de mes frères– l’autre était prêtre–et mes deux sœurs.
Et comme, malgré ces dots et la vie très laborieuse des trois chefs de ces ménages, dans chacun ne coulait guère qu’un Pactole très relatif, j’étais toujours prête à aider celui-ci ou celui-là J’avais une maison de campagne, très vaste et semblable à un caravansérail, où j’hébergeais, tout l’été, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plus un nombre de neveux et de nièces qui allait augmentant chaque année.
Je n’avais pas la prétention, Dieu merci, d’exiger, pour prix de ces libéralités, une adhésion quelconque du moindre des miens à mes doctrines de libre-pensée.
Il n’en est pas moins vrai que toute ma famille –mes collatéraux alors, comme naguère mes ascendants–était une famille chrétienne, sur laquelle je faisais tache par mon impiété.;
En vain m’efforçais-je de rendre cette tache aussi peu apparente que possible.
C’était un fait notoire que le caractère rationaliste –pour ne rien dire de plus–de mes livres et de mes articles de revues.
Chez moi, soit dans mon appartement du quai Voltaire, soit dans ma maison de St-Théodule, j’avais bien soin que pas un volume ou un numéro ne traînât sur les meubles.
Jamais je ne faisais de propagande… Jamais pourtant, même sous le prétexte qu’il faut de la religion aux enfants, je n’eus devant eux une attitude ou un langage religieux.
Une ou deux fois, l’une de mes sœurs, sujette aux distractions, ou l’un de mes beaux-frères qui est un peu exalté, avaient abordé, par je ne sais quelle voie détournée, la question religieuse. Je me possédais trop pour éclater. Mais j’avais dit quelques paroles nettes et sèches. Il en était résulté un silence glacial, plus embarrassant encore que l’éclat redouté.
Tout cela constituait une position tendue, qui m’était au moins aussi pénible qu’à mes frères et sœurs.
Ceux-ci–et tous leurs efforts pour le dissimuler ne faisaient que rendre la chose plus évidente–me considéraient comme un malade qu’il faut ménager.
Mais, s’ils ne me faisaient pas de sermons, ils se dédommageaient, j’en étais sûre, en priant pour moi de toutes leurs forces.
Cela n’empêchait pas que je fusse le professeur attitré de mes neveux et nièces.
Mes talents pédagogiques me désignaient pour cet emploi. D’ailleurs, j’aimais tendrement tous ces rejetons du vieil arbre de notre famille; et je me faisais scrupule de leur dire un mot qui risquât d’ébranler le moins du monde leurs convictions religieuses.
Une seule chose ne pouvait manquer de les étonner dans mon enseignement: c’était l’absence absolue de Dieu.–La petite Juliette, en ayant un jour manifesté sa stupéfaction. «Tu sais, mon enfant, lui dit sa mère, tante Marceline ne s’occupe pas de ces choses-là. C’est un grand malheur pour elle. Prie bien le bon Dieu, ma Juliette, afin que ce malheur ne dure pas toujours.
Mais je m’aperçois que je vous ai à peine parlé de ma maison de St Théodule. J’ai eu tort; car c’est de là que me devait venir la lumière.
Je sentais que, par mon éloignement des pensées religieuses, non seulement j’étais coupable envers Dieu, mais que je pouvais–sans le vouloir précisément–semer autour de moi des semences de mort.
N’ayant pas le courage de suivre le conseil évangéliqueetd’arracher l’œil qui me scandalisait, c’est-à-dire ce rationalisme criminel et insensé, je cherchais à compenser ce mal par la charité!
Non seulement je portais aux pauvres le pain, la viande, les vêtements, non seulement je donnais largement à M. le curé, aux frères, aux sœurs, pour leur permettre de faire, eux aussi, la charité; mais j’exerçais une espèce d’œuvre de miséricorde rarement à la portée des âmes les plus charitables.
J’avais eu, entre20et25ans surtout, une rage d’apprendre, qui m’avait été funeste en un sens, mais dont je recueillais quelques bons fruits, au point de vue matériel.
Entre autres sciences que j’avais été curieuse d’étudier, il faut compter, en première ligne, la médecine.
J’avais suivi des cours et môme pris quelques degrés.
Comme je joignais à cette extrême facilité pour apprendre, dont je vous ai parlé, un coup d’œil sagace et prompt, une main délicate et hardie, j’étais, pour le village–tout à fait dénué, médicalement parlant–une très précieuse ressource… Non seulement je traitais avec succès les fièvres, les bronchites, les angines, les névralgies; mais je ne reculais pas devant une opération.
J’en réussis quelques-unes des plus difficiles; et je m’acquis dans tout le pays circonvoisin, une réputation bien au-dessus de mon mérite.
Je prenais plaisir à ce genre de charité, assez insolite chez une femme.
Au chevet des malades, je me rencontrai souvent avec M. le Curé.
C’était un prêtre, tout simple et tout rond, qui me plut d’abord. Si simple qu’il fût, il était aussi, je crois, très avisé. Il connaissait, comme tout le monde à St-Théodule, mon triste état spirituel. Un autre aurait voulu profiter de nos relations pour me pousser dans mes derniers retranchements, et enlever de haute lutte une conversion qui eût fait tant de bien. L’abbé Ilerbland, fut plus sage. Il se dit que l’exercice de la charité était un bien évidemment, qu’il fallait laisser à la Providence le soin de frapper le grand coup.
La Providence aime les humbles instruments.
On me considérait comme un redoutable champion. Aucun de mes frères, tous deux fort instruits, le plus jeune prêtre, pas même l’un de mes beaux-frères, philosophe de son état–philosophe chrétien,–n’avait osé entreprendre ma conversion.
L’entreprendre, l’effectuer, était réservé à un pauvre vieux garde-champêtre.
Le père Le Grimpereau n’était pas un grand clerc. Il savait tout juste lire, écrire, faire les quatre règles, rédiger, nettement et sans trop de fautes d’orthographe, un procès-verbal.
Mais ce qu’il savait parfaitement, c’était son catéchisme. Il l’avait appris pour son compte, quand il était à l’école. Puis, il l’avait repassé pour l’enseigner à ses petits frères, aux enfants de ses sœurs, à ses propres enfants.
On peut dire qu’il en possédait admirablement, non seulement la lettre, mais surtout l’esprit. Et cet esprit du catéchisme, cet esprit chrétien, n’était pas chez lui à l’état purement spéculatif; c’était la règle de ses actes.
Au point de vue moral, même philosophique, le père Le Grimpereau était ainsi infiniment supérieur à beaucoup de grands savants et de grands littérateurs.
J’avais eu souvent occasion de le voir; j’avais été frappée de son bon sens, de son style original et pittoresque. Je savais que c’était un rude chrétien; et je ne pouvais m’empêcher de l’en estimer vantage.
Mes talents médicaux me mirent, plus intimement encore, en rapport avec lui.
Il eut une mauvaise fièvre... D’abord il ne s’en inquiéta pas. «Il faut bien avoir quelque chose, dit-il, et sentir, par un bout ou par un autre, que la vieillesse arrive et la mort avec elle.»
Pourtant le mal fit des progrès rapides, et comme, après tout, lui parti, sa famille eût été sur la paille, Le Grimpereau consentit à se laisser soigner.
Sa fille vint me trouver. Le bon homme ne faisait que de s’aliter. Mais il était comme on dit. «Je ne me relèverai pas, répétait-il sans cesse. Je ne sortirai dici que les pieds par devant.»
Je le vis. Il était très malade. mais plus malade encore d’esprit que de corps.
«Mon brave, lui dis-je, vous êtes pris sérieusement; il ne servirait de rien de vous le cacher.– Mais vous avez encore bien des chances de revenir sur l’eau. La première chose que je vous conseille, c’est de faire taire cette imagination. Voulez-vous guérir?
–Oui, à cause des miens.
–Eh bien! ne vous dites pas que vous êtes condamné. Vous qui passez pour un si fameux chrétien, c’est le moment de vous servir de votre christianisme; le moment de vous dire que rien n’arrive ici-bas sans la permission de Dieu, de prier ce Dieu de vous guérir.»
Le Grimpereau fut très étonné de ce langage. que j’avais tenu, je dois le dire, sans y croire, mais parce qu’il faut prendre les hommes comme ils sont, et que la philosophie chrétienne était encore,
–d’après ce que je savais du bon homme,–la meilleure anse pour l’empoigner.
Il ne me répondit pas. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui semblait dire: «Tiens, Mlle Marceline qui parle comme un curé! Et moi qui m’imaginais qu’elle ne croyait ni à Dieu, ni à diable!»
Bref, il se laissa soigner. J’y mis toute ma science. et tout mon cœur.
Au bout de huit jours, j’eus occasion.de consulter un grand médecin, que je ne sais quelles, circonstances, nullement professionnelles, avaient amené à Ste-Sauve. Il dit que le pauvre vieux avait frisé la mort,–c’était son expression,– mais que, grâce à mon traitement judicieux et énergique, le danger était conjuré.
Trois jours après, Le Grimpereau n’avait plus la moindre fièvre, mais un appétit formidable.
Huit jours plus tard, il reprenait l’exercice de ses fonctions.
Sa première sortie pourtant ne fut pas pour promener son grand sabre à travers la campagne.
Il voulut aller à la messe de six heures, remercier Celui qui l’avait ramené de si loin. Puis il voulut venir voir l’officière de santé qui avait été l’instrument du souverain guérisseur.
C’est avec une véritable émotion qu’il m’aborda.
«Mademoiselle, me dit-il, ni moi, ni mes enfants, ni mes frères et mes sœurs nous ne saurons jamais vous être assez reconnaissants.
–Mon brave Le Grimpereau, répondis-je, soyez assuré que je suis, pour le moins, aussi heureuse que vous de votre rétablissement.»
Puis nous causâmes, comme une paire d’amis.
Si attachants que fussent les propos du garde-champêtre, au bout d’une petite demi-heure, je commençai à trouver qu’ils se prolongeaient un peu beaucoup.
Je m’en étonnai d’autant plus que la discrétion du-père Le Grimpereau était proverbiale.
Sans vouloir le moins du monde lui donner une leçon, simplement parce que je ne savais plus que dire, je laissai la conversation languir… Le Grimpereau sembla prendre son courage à deux mains.
«Mademoiselle Marceline, dit-il, pardon si je ne m’en vais pas. Mais voyez-vous, c’est que j’ai quelque chose de très important à vous dire, et que je ne sais comment commencer.
–Eh bien! commencez n’importe comment.
–Vous me promettez de ne pas m’en vouloir.
–Mon Dieu, père Grimpereau, vous êtes fatiguant.–Parlez, pour l’amour du ciel.
–Eh bien! voilà Je voudrais vous offrir quelque chose, en souvenir de ma guérison. J’ai peur que vous n’en vouliez pas.»
Je crus qu’il s’agissait de quelque perdrix ou de quelque lapin, et je répondis:
«Tout ce qui viendra de vous sera le bienvenu, père Grimpereau.
–Oh! que ne puis-je, chère Mademoiselle, vous prendre au mot… Je voudrais vous donner le bon Dieu.
–Me donner le bon Dieu!» dis-je, tombant de mon haut.
–Oui, ma chère demoiselle. On m’a dit sur votre compte toute-sorte de choses que je ne suis pas capable de tirer au clair.
Ce que je sais, c’est que vous n’allez pas souvent à la messe, qu’on ne vous a jamais vue, depuis tantôt vingt-cinq ans, au confessionnal ni à la sainte Table… On ajoute que vous avez fait des livresque vous-même cachez à vos neveux et nièces, parce que ces livres parlent mal de Notice-Seigneur Jésus-Christ, de ses saints et de son Eglise.
Eh bien! entre le bon Dieu et vous, si savante que vous soyez, celui qui a tort ce ne peut être le bon Dieu.
Donc, croyez-moi, ma chère demoiselle, allez trouver M. le curé, un homme si saint et si sage; exposez-lui vos difficultés; et, dès que vous verrez que ces difficultés ne sont rien’–est-ce qu’il peut y avoir des difficultés sérieuses contre Dieu?– gardez-vous de fermer les yeux à la lumière, soyez de bonne foi avec vous-même; redevenez simplement une bonne et honnête chrétienne, comme vous l’avez été jusqu’à vingt ans.»
Rien ne saurait peindre mon étonnement, en entendant un langage si sensé, si profond, tenu par ce simple paysan… Ce qui me frappait surtout, c’était cette expression de mon père mourant et que reproduisait Le Grimpereau: «Soyez de bonne foi avec vous-même.»
J’étais comme un fruit mûr, et Le Grimpereau était le jardinier chargé de cueillir ce que d’autres avaient semé.
Je réfléchis quelques minutes seulement.
«C’est peut-être la dernière occasion, me dis-je. Si je la méprise, qui sait si je ne serai pas confirmée dans mon incrédulité?.... Non, je suis trop malheureuse, depuis que j’ai remplacé la foi par le doute. car je n’ai jamais pu aller plus loin.»
Je pris les deux mains du père Le Grimpereau– un peu plus, je l’aurais embrassé.
«Cher ami, lui dis-je, vous étiez mon malade, il y a peu de jours. Aujourd’hui, vous êtes mon médecin.
Je vais aller trouver M. le curé, non pour être instruite–en somme, j’ai moins oublié mon catéchisme qu’on ne croit–mais pour lui demander pardon du scandale que je répands autour de moi. surtout pour me confesser.