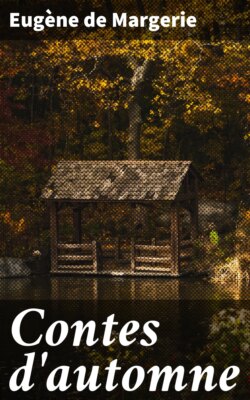Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
UN MARIAGE MANQUÉ.
ОглавлениеTable des matières
N’était le côté spirituel–sur lequel j’ai beaucoup insisté dans ces deux derniers chapitres–je ne m’étais pas surfaite; quand j’avais résolu d’aborder la carrière des lettres et des sciences.
Ce n’était pas seulement une honnête considération que j’avais très vite obtenue. C’était le succès; c’était une sorte de célébrité; c’était presque la gloire.
Je le dis, quoiqu’il s’agisse de moi, et précisément parce que je suis revenue de toutes ces vanités, revenue au point d’en être honteuse et presque repentante.
Je commençai par donner des leçons dans de petits pensionnats, chez de petits bourgeois, de collaborer à de petits Magazines.
Mais bientôt mon enseignement, soit oral, soit écrit, conquit la renommée: les institutions à la mode, les familles les plus riches et les plus aristocratiques, les deux ou trois grandes revues qui font les réputations, se disputèrent mes leçons et mes articles.
Je publiai des leçons qui me furent payées très cher, et auxquelles des écrivains de talent ne craignirent pas de consacrer des comptes-rendus enflammés.
«Quel dommage, disait l’un de ces critiques, que l’Académie et la Sorbonne soient réservées au sexe laid! La place de Mlle de la Mardelle ne serait-elle pas dans l’une des chaires de la faculté des Sciences, dans l’un des fauteuils du Palais-Mazarin.»
Quand, à de rares intervalles, le remords, le doute au moins, me venait visiter, quand je me rappelais les paroles de mon père mourant, je médisais: «Aimerais-je donc mieux végéter dans ce méchant pensionnat des Thernes ou de Courbevoie?... Je remplis ma mission. Grâce à moi, la ruine de ma famille est presque de l’histoire ancienne. Nous voici riches de nouveau.»
Si j’avais bien réfléchi, et que, suivant le conseil paternel, j’eusse été de bonne foi avec moi-même, j’aurais eu honte d’une pareille réplique. Ne revenait-elle pas à dire que j’avais fait un bon marché, en vendant mon âme pour une dizaine de mille livres de rente?
J’essayai encore de me donner le change, à force de faire du bien. Non seulement je me constituai le banquier de mes frères et de mes sœurs, je voulus encore les marier et les doter.
Puis je songeai à me marier moi-même.
Quoique savante, j’étais loin d’être désagréable. Autour de moi, on disait que j’étais charmante. J’avais de l’esprit, et pas l’ombre de pédantisme.
Depuis que je travaillais, j’avais mis de côté une somme rondelette. Avec mes leçons, mes articles, mes livres, quelques opérations de Bourse très réussies, je me faisais, bon an, mal an, de douze à quinze mille francs de revenu.
Pour une jeune fille qui venait à peine de coiffer Ste Catherine, et qui, il y a tout au plus huit ans, était encore une débutante, c’était un joli chiffre. Et tous ceux qui me connaissaient disaient bien haut que ce n’était rien, en comparaison de l’avenir brillant et solide qui m’attendait.
Me marier était donc la chose du monde la plus facile, et je n’avais que l’embarras du choix.
Du moins, c’est ce que je pensais, ce que tout le monde affectait de me répéter.
«Sans doute, disait, en hochant de la tète, notre vieille tante Angélique, sans doute. Mais la pauvre Marceline a contre elle ses opinions religieuses. ou plutôt antireligieuses. Vous verrez que cela lui jouera quelque tour.»
Je ne me préoccupais mie de cet oiseau de mauvais augure, et je cherchais autour de moi quelle main pourrait bien me convenir.
Mon choix tomba sur un jeune littérateur dont la position et les espérances dans le monde des lettres étaient analogues aux miennes dans le monde scientifique.–
Nous avions des amis communs qui, devinant ma préférence, feignirent d’avoir eu les premiers la pensée de cette union si bien assortie. Ils firent les démarches préliminaires, c’est-à-dire, afin que tout fût correct, amenèrent Léopold–je ne le désignerai pas autrement–à se présenter.
Nous étions orphelins tous deux, Nous n’étions plus des enfants: il avait trente-cinq ans et moi vingt-six.
Lorsque les questions financières eurent été traitées par nos notaires, il n’y eut plus d’intermédiaire entre nous. Il ne s’agit plus que de nous étudier un peu l’un l’autre, afin de bien nous assurer que nos caractères, nos goûts, nos habitudes étaient, sinon identiques, du moins de nature à s’accorder, à s’adapter, pour ainsi dire, les uns aux autres.
Les débuts de cette étude furent on ne peut plus satisfaisants.
Léopold était transporte–du moins il me le disait, et il était la loyauté même–des découvertes, de jour en jour plus ravissantes, qu’il faisait dans l’esprit et dans le cœur de sa fiancée. J’en pensais tout autant sur son compte, bien qu’une certaine réserve m’empêchàt de le manifester autant.
Mais je m’assure qu’il le lisait parfaitement dans l’intonation de ma voix, l’expression de mes yeux, l’émotion avec laquelle je le quittais ou le retrouvais.
Quelques circonstances de famille–l’éloignement d’un frère de Léopold, officier en Algérie et qui avait de la peine à obtenir un congé; des papiers indispensables et qui tardaient à venir de Montluçon; puis, quand tout fut prêt, une légère indisposition du futur–tout cela fit traîner l’affaire quelques mois de plus que nous n’aurions voulu.
Ces retards, semblait-il, avaient .surtout pour résultat de nous rendre plus chers l’un à l’autre.
Enfin, la date est fixée…
Si j’avais été encore chrétienne, et si le déisme n’était, dans la pratique, cousin-germain de l’athéisme, j’aurais remercié le maître des cœurs et des événements de me donner un si parfait bonheur.
Je me contentais de me féliciter et de chanter, à qui voulait m’entendre, les louanges de mon fiancé.
Hélas! Je comptais sans une question, que j’avais, depuis longtemps, rayée de mes préoccupations, et dont rien n’eût pu me faire soupçonner la résurrection, à la veille de mon mariage: la question religieuse.
Jamais je ne l’avais abordée avec mon fiancé; jamais je n’y avais fait, avec lui, même la plus lointaine allusion.
A quoi bon?–Tout ce que je savais de Léopold par ses livres, sa renommée, nos amis communs, surtout par ces conversations intimes auxquelles nous nous livrions depuis six mois et dans lesquelles nous avions mis tous deux nos cœurs à découvert, tout cela me montrait en lui, non pas un impie fanatique et un mangeur de prêtres, mais un esprit analogue au mien, c’est-à-dire pour lequel la question religieuse n’existe pas. Léopold était, comme les trois quarts et demi des honnêtes lettrés: étranger, indifférent à tout ce qui préoccupe ou passionne, pour ou contre, les fanatiques de foi ou d’incrédulité.
De même que tant d’hommes, instruits d’ailleurs, ne savent pas un traître mot d’algèbre, et, en dépit de cette ignorance, vivent très heureux et très honorés, il me semblait que Léopold–comme moi, du reste–se passait parfaitement de Dieu
Il ne niait pas la révélation: c’eût été une manière de s’en occuper. Il passait à côté, ne daignant ni la regarder, ni la discuter… La science religieuse était pour lui un art d’agrément ou une amusette. Quelques-uns s’y adonnent, comme d’autres à la musique ou aux dominos.
Permis à eux. Quant à lui, il préférait de beaucoup les belles-lettres ou l’archéologie.
Voilà ce que je pensais. Et vraiment tout autre, à ma place, eût pensé comme moi.
Eh bien! Je me trompais.
Un matin–c’était cinq jours avant le jour fixé pour notre mariage–Léopold, arrivait avec son bouquet accoutumé: cette fois une botte de roses-thé, fraîches et embaumées.
«A propos, me dit-il–à propos, sans doute, d’une pensée qui venait de lui traverser l’esprit; car nous n’avions encore rien dit–à propos, ma chère Marceline, il y a un sujet que nous n’avons pas abordé jusqu’ici, et dont il importe de dire deux mots.
–Un sujet? Quel sujet? Nous! es avons tous traités à fond, il me semble… à moins qu’il ne s’agisse du papier de notre salle à manger.
–Marceline, je ne plaisante pas. Comment se fait-il que nous n’ayons jamais rien dit de la question religieuse?
–Ah!, dis-je avec stupéfaction, il s’agit de la question religieuse! Je croyais que, pour vous, comme pour moi, il n’y avait pas de question religieuse. Ne laissons-nous pas tous ces mythes aux illuminés, toutes ces pieusetés aux vieilles dévotes?
–Permettez, ma chère amie.–Moi, oui, parce que je suis un homme. Et encore, je ne suis pas si sûr que cela d’avoir raison. J’ai rencontré, dans mes études scientifiques–car, si littérateur que je sois, j’ai aussi tâté à la science–j’ai, dis-je, rencontré bien des points terriblement obscurs, et que la pensée de Dieu seule illumine. Surtout, dans mes études morales, je me suis convaincu que les trois quarts et demi des hommes, s’ils sont sans religion, tournent au brigandage. Or, il paraît difficile que ce qui est, pour le genre humain, l’unique garantie d’honnêteté, de paix et de sécurité, ne soit au fond qu’un tas d’illusions et de jongleries.– J’ai donc tort, peut-être, de ne pas creuser davantage la question religieuse.
Mais ce n’est pas là ce que je voulais vous dire.
Un homme impie, du moins indifférent, c’est chose si habituelle que le contraire est presque un prodige.
Pour une femme, il n’en va pas de même. L’homme se dirige par le raisonnement, la femme par le sentiment. Une femme impie, c’est une monstruosité. J’oserai dire que, dans un ménage, plus l’homme s’éloigne de Dieu, plus il est désirable que la femme s’en rapproche.
Mon père était voltairien. Grâce à ma mère, qui était une sainte, il a fait une mort dont le souvenir m’empêchera, je crois, de me reposer jamais dans une complète incrédulité.
Mais–et c’est ici que je fais appel à votre admirable franchise–cette ressource qu’a eue mon père, je voudrais bien l’avoir aussi. Comment l’aurais-je, si j’épousais une femme impie?
Un mot de vous suffira pour me tranquilliser.
Je sais parfaitement que vous n’êtes pas pieuse. Je sais aussi que vous avez, non sans un certain éclat, quitté le bercail catholique.
Il ne m’appartient pas de vous blâmer.
Dites-moi seulement que cette rupture n’est point absolument définitive, que, si l’occasion se présentait de retourner à vos anciens principes et à vos anciennes habitudes, vous n’êtes pas irrévocablement déterminée à persévérer, quand même, dans le rationalisme.»
J’étais à la fois surprise et indignée.
«Comment1Voici plus de six mois que nous vivons dans l’intimité l’un de l’autre, nous étudiant, écoutant, pour ainsi dire, nos âmes respirer. Léopold a parfaitement su, sans que j’eusse besoin de le lui déclarer–la chose était notoire–a su que j’étais une libre-penseuse. Comme il passe lui-même–à juste titre–pour libre-penseur, il a dû croire que nous étions à deux de jeu, que cette similitude était une garantie de plus de concorde et de bonheur domestique.
Le fait est que ni lui ni moi n’avons jamais eu l’idée de nous faire subir, l’un à l’autre, sur cette question, le moindre interrogatoire.
Où en veut-il venir aujourd’hui?–Est-ce une défaite?»
Je lui laissai voir mon profond étonnement, mon chagrin plus profond encore.
Il fut lui-même affligé de la peine qu’il mecausait.
Comment en eût-il été autrement? Nous nous aimions vraiment. Et c’était le cœur tranquille et joyeux que nous nous apprêtions à fondre nos deux vies en une seule.
Mais–il y a un mais: et je suis d’autant plus empressée à vous le confier qu’il est tout à l’avantage de Léopold.
Quand il fut pour la première fois question de mariage entre nous, nous étions tous les deux, sinon impies, du moins profondément indifférents.
Mais, en devenant indifférent, Léopold avait tout simplement suivi le chemin ouvert devant lui. Il avait sucé le rationalisme avec le lait de l’Alma parens. Jamais on ne lui avait enseigné sérieusement la religion. Jamais surtout il n’avait respiré cette atmosphère de la vie chrétienne qui est le meilleur de tous les enseignements. Il était tout naturel qu’il fût, qu’il demeurât étranger aux choses religieuses.
Et moi i! Oh1moi. J’avais connu le don de Dieu. J’avais vu des saints vivre à mes côtés. J’avais goûté la douceur et la beauté de la religion. Et entraînée par un misérable orgueil, j’avais abjuré tout cela, pour me suffire à moi-même...
J’étais une apostate!
Léopold n’était qu’un ignorant…
Il aimait la vérité, sans la connaître.
Tout à coup, il se fit, en lui, comme une lumière. Il ne se souciait guère, pour le quart d’heure, de l’étudier, cette lumière, de la rendre plus intense, d’en faire le flambeau de sa vie. Mais il sentait qu’un jour, plus ou moins éloigné, il pourrait bien vouloir entreprendre cette étude. Alors, combien l’entreprise serait plus facile, avec une femme, je ne dis pas chrétienne, du moins bien disposée pour le christianisme e, sans parti-pris contre lui.
Toutes ces réflexions, et bien d’autres, me traversèrent l’esprit.
D’abord, je revis mon père mourant. Il me sembla que j’entendais sa recommandation suprême: «Quand la vérité viendra frapper à ta porte, ne la repousse pas. Sois de bonne foi avec toi-même.»
Ah! si j’avais eu la simplicité de conter mon histoire à Léopold, si je lui avais dit: «Cet appel de Dieu que mon père avait prévu, c’est votre interrogatoire. Eh bien! voici ma réponse.
Je ne puis me donner pour chrétienne. On ne remonte pas ainsi, en un instant, une pente sur laquelle on glisse depuis des années. Mais je crois que cette réascension me serait salutaire, et à vous. Si vous voulez, nous la ferons ensemble,» si j’avais tenu ce langage à Léopold, il en eût été touché. Nous nous serions mariés sous ces heureux auspices. En peu de mois peut-être, nous eussions abouti au port de la foi.
Mais l’orgueil était là.
J’étais blessée. Je le montrai, en signifiant très nettement à Léopold son congé...
Léopold essaya de revenir sur ses pas, de dire que j’avais tort d’attacher une telle importance à ce qui n’était après tout qu’une sorte de propos en l’air, presque une plaisanterie.
J’étais outrée.
Je le montrai, plus que je n’aurais voulu peut-être.
Il fallut bien que Léopold se retirât.... Tout était rompu entre nous.