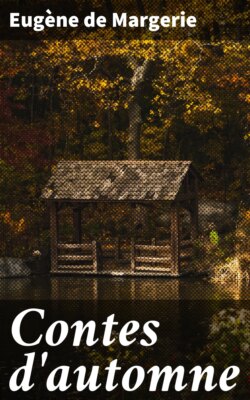Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
COMMENT ON PERD LA FOI.
ОглавлениеTable des matières
On ne joue pas ainsi avec la foi.
L’espace étroit où on la consigne devient bien vite comme un cachot. Privée d’air et de chaleur, de contact avec les objets extérieurs, de son influence légitime sur l’ensemble et les détails de notre vie, la foi meurt étouffée.
Du moins nous le croyons; et peut-être n’en sommes-nous pas autrement affligés....
Peut-être que, si nous promenions courageusement le flambeau jusque dans les profondeurs de notre âme, nous découvririons que la foi n’y est pas si morte que nous nous plaisons à le croire et à le dire… ou du moins que c’est nous qui, par nos prévarications–par la pire de toutes, l’orgueil–travaillons à la tuer… Alors, avant que le coup de grâce ne soit donné, qui sait si nous ne ferions pas une dernière étude.
Mais je m’arrête trop longtemps sur les considérations générales. Cela vient sans doute de ce que j’ai un aveu pénible à faire.
Oui, une heure arrive où, à force d’avoir été infidèles à la grâce, nous sentons que celle-ci nous abandonne.
Un matin, je me mis, comme on dit, en face de moi-même. «C’est peut-être un malheur d’avoir perdu la foi, me dis-je. En tout cas, c’est un fait. Continuer à pratiquer ce que je ne crois plus, serait une honteuse et coupable hypocrisie.
Il n’y a rien de tel que les positions nettes.
Je dois une franche profession de foi–ou d’incrédulité, non à mon maître: sans que je le lui dise, il sait du reste où j’en suis; mais à mon père.»
Il fallait que depuis bien longtemps et bien profondément se fût accompli en moi le travail de la déchristianisation, pour que je ne comprisse pas le coup affreux qu’allait porter à mon père cette prétendue déclaration de principes.
J’avais donc oublié que, pour l’homme de foi, la question religieuse prime toutes les autres. Si c’est le plus grand de tous les bonheurs d’avoir Dieu avec soi, il n’est pas de malheur comparable à celui d’être loin de Dieu. Et je venais signifier à mon père, comme la chose du monde la plus simple, que j’avais définitivement rompu avec Dieu, le Dieu vivant, le Dieu des chrétiens!
Mon père ne comprit pas d’abord.–Il avait eu, deux mois auparavant, une petite attaque de paralysie; il en était résulté, sinon un affaiblissement, du moins un certain ralentissement de ses facultés intellectuelles.
Quand je lui eus fait ma confession, il crut qu’il m’avait mal comprise… Je fus obligé de répéter mon dire.
Oh! alors… Non, je renonce à vous décrire cette scène.
Mon père ne pleura pas. Hélas! Trop souvent les larmes manquent aux peines les plus profondes. Il ne me fit pas de reproches. Non; mais une inexprimable souffrance se peignit sur ses traits. Il devint d’une pâleur livide. Un tremblement que rien ne pouvait calmer, des alternatives de chaleur et de frisson firent craindre qu’une nouvelle crise ne l’envahît, peut-être ne l’emportât.
Il se remit cependant.
«Ma pauvre Marceline, me dit-il, que le bon Dieu te pardonne, comme je te pardonne de grand cœur, le mal affreux que tu me fais.
J’ai bien souffert, jadis, quand nous avons perdu tes petits frères. J’ai eu, il y a six ans, de cruelles angoisses et comme une agonie prolongée, près du lit de mort de ta bien-aimée mère.
Tout cela n’était rien, absolument rien, comparé à ce poignard que tu viens de me plonger dans le cœur.
Comment! Tu as rompu avec le bon Dieu!– Que t’a-t-il fait, que du bien? C’est ainsi que tu le remercies des dons qu’il a répandus sur toi, d’une main si libérale!»
Je fus prise au dépourvu par cette désolation paternelle.
Assurément, si j’avais pu la prévoir, j’aurais reculé. Je lui aurais accordé–je me serais accordé à moi-même–au moins un sursis.
Mais est-ce que je n’aurais pas dû la prévoir? Est-ce que je ne savais pas que, pour mon père, Dieu était tout?… Et je croyais qu’il aurait appris tranquillement que sa fille devenait une espèce d’impie!
En effet, il ne faut pas équivoquer sur les termes, dire que je ne reniais pas Dieu, que je me mettais seulement en dehors de cette forme de culte que l’on appelle le catholicisme. Pour une jeune fille de dix-huit ans, élevée dans la religion catholique, y renoncer, c’est renoncer à toute religion. Et de fait, je n’alléguais pas que je voulusse passer au protestantisme ou au judaïsme.
Sans doute, je ne faisais pas profession d’athéisme, et qui m’eût serrée de près m’eût amenée à me déclarer déiste, sectatrice de la religion naturelle.
Mais tout cela c’est de la théorie, une théorie que l’on se garde bien de faire passer dans la pratique.
Ce Dieu des déistes, est-ce que je le priais?– Ces dogmes de la religion naturelle, la vie future, par exemple, est-ce que je les creusais?
N’était-ce pas pour y échapper–pour les reléguer, du moins, dans un vague lointain–que j’avais quitté le catholicisme?
En voyant mon père, malade d’abord, puis triste d’une tristesse évidemment invincible, contre laquelle son pauvre organisme ébranlé lui permettait à peine de lutter,–je regrettai amèrement d’avoir ainsi brûlé mes vaisseaux.
J’essayais bien de me calmer, en me disant que j’avais agi à bonne intention, poussée par la force de la vérité.
Des dernières profondeurs de ma conscience, une voix s’élevait qui me disait: «Ce n’est pas vrai. Avant de faire ainsi le désespoir de ton père –ton malheur éternel à toi peut-être–ne pouvais-tu pas, ne devais-tu pas, étudier de bonne foi, en t’aidant de livres bien faits et du conseil d’hommes sages, ne devais-tu pas étudier la question religieuse… mais l’étudier sans idée préconçue?»
Et, au moment où j’aurais voulu chasser cette pensée importune, elle s’accusait plus nettement que jamais, sous forme d’une objection quasi irréfutable.
«L’histoire prouve, me disait la voix intérieure, que, pour les individus, comme pour les nations, sans religion il n’y a point de moralité. L’histoire démontre l’incumparable supériorité de la religion chrétienne sur toutes les autres, spécialement à ce point de vue de la moralité. L’enseignement du Christianisme–surtout dans sa forme la plus parfaite: du Christianisme intégral, du catholicisme–est plus élevé, sa morale est plus pure, sa méthode de moralisation plus efficace… –La prière et les sacrements–les termes du catéchisme me revenaient–sont des armes d’une puissance incomparable pour combattre le mal et promouvoir le bien… Et tout cela, qui s’adapte si merveilleusement à la nature humaine, à ses faiblesses pour les combattre, à ses nobles instincts pour les développer, tout cela ne serait que fanatisme, tout au plus un vague sentimentalisme à l’usage de quelques illuminés!»