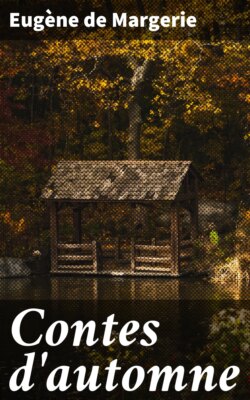Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
L’ENFANCE DE MARCELINE
ОглавлениеTable des matières
Du plus loin que je remonte le cours de mes souvenirs, je ne rencontre dans ma famille que d’admirables exemples de vertu, ou de piété, comme vous voudrez. Celle-ci, chez mes parents, était à la fois la base et le couronnement de celle-là.
J’ai soixante ans passés. Evidemment j’approche de ma fin. Il y a plus d’un demi-siècle, je sortais à peine du berceau, et déjà je sentais quelles inexprimables actions de grâces je devais à la bonne Providence pour le port chrétien dans lequel elle abritait mon enfance.
Que ne suis-je une grande artiste, un écrivain de génie, pour faire passer devant vos yeux ma galerie de famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, nos proches et nos amis, tous ceux * qui étaient les habitués ou les clients de la Mardelle.
Mon père, très riche gentilhomme campagnard, était un beau type de cette classe trop clairsemée et qui, si elle se fortifiait–en nombre et en doctrine –serait bien près de sauver la France.
Il n’allait presque jamais à Paris. Qu’y eût-il été faire? Dépenser son temps, toujours trop court à la Mardelle; dépenser de l’argent, toujours mieux employé à donner du pain aux vrais pauvres, du travail aux ouvriers de bonne volonté.
Nous passions seulement deux ou trois mois d’hiver à Clermont.
Tout le reste de l’année, mon père cultivait à la fois la terre et ce terrain d’une culture plus laborieuse encore et plus délicate, je veux parler de de l’âme de ses enfants.
C’était bien le grand propriétaire chrétien: toujours prêt à prendre l’initiative des travaux et des expériences utiles, tenant sa bourse, son temps, son activité à la disposition de ses voisins, moins riches que lui; ne plaignant jamais sa peine, quand il s’agissait de rendre un service, surtout alors que ce service revêtait un caractère religieux. Ainsi, président du comité agricole, il l’était aussi d’une association pour l’observation du repos dominical. Il avait établi des Frères et des Sœurs dans sa commune, et c’était grâce à son intervention–je crois même grâce à ses libéralités– que la Mardelle, qui n’avait qu’un vieux curé, obtint un vicaire, dont le zèle et la jeune ardeur amenèrent les plus heureux résultats.
Ma mère était l’auxiliaire intelligente et dévouée de mon père, dans presque toutes ses œuvres, entre autres dans l’œuvre de notre éducation. Elle était plus spécialement chargée du département de la charité.–Nous étions encore tout petits, mes frères et sœurs et moi, et déjà notre mère nous menait dans les chaumières, pour voir de près la misère, et apprendre à y compatir. Nous nous habituions, non seulement à soulager le pauvre, mais à le respecter et à l’aimer, comme le représentant de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Au point de vue intellectuel, et spécialement pédagogique, nos parents suffisaient amplement à notre éducation.–Sauf un professeur de musique et un répétiteur de mathématiques pour un de mes frères, lorsqu’il voulut préparer sa licence ès-sciences, nous n’eûmes point d’autres maîtres que notre père et notre mère.
Je ne crois pas qu’ils nous aient jamais prêché, autrement que par leurs exemples, la science maîtresse de la vie. Mais que ces exemples étaient éloquents! Et puis nos parents n’étaient pas seuls à nous les donner: ils avaient comme complices, pour ainsi dire, tous ceux qui, de par les liens deparenté, d’amitié ou de voisinage, fréquentaient le château.
C’était le règne incontesté de Dieu. Dieu était le pont de départ et l’aboutissement de tout. Ses intérêts–les intérêts de sa gloire, l’honneur de son service–étaient la première de nos préoccupations... la première, non qu’elle fût en balance avec une autre, mais en ce sens qu’elle dépassait tout le reste, comme le ciel est au-dessus de la terre, l’éternité au-dessus du temps, Dieu au-dessus des hommes.
N’allez pas vous imaginer qu’avec cette profondeur et cette hauteur de principes, notre existence fût morose, austère, pour ne pas dire triste et ennuyeuse.
Au contraire, rien n’était plus joyeux que la vie que l’on menait à la Mardeile. Et cela doit être. D’où naît la tristesse, sinon du désordre? Or, chez nos parents, l’ordre régnait en souverain.
Il faut être bien étranger au christianisme–je ne dis pas ne l’avoir jamais pratiqué, mais n’avoir jamais vu de près de vrais chrétiens–pour ignorer que leur vie est une application constante de cette belle parole de S. Paul: Gaudete in Domino semper; iterum dico: Gaudete.
Nous aimions Dieu et nos parents. Nous aimions et assistions les pauvres. Nous aimions et pratiquions le travail.
Après le travail, nous ne manquions pas de délassements: la musique, la poésie, la promenade.
Ne parlons que de celle-ci–pour laquelle vous avez un faible, je le sais. Je revois encore, après cinquante ans, les vives et pures jouissances que nous causaient un joli point de vue, une plante rare rencontrée dans nos courses, une soirée passée sur la lisière du parc, à écouter le silence ou les mille bruits de la campagne, ou les ravissantes mélodies du rossignol.
J’ai dit nous… Et si je ne voulais glisser sur ces commencements pour arriver plus tôt au cœur de mon sujet, que de charmants médaillons je pourrais vous offrir de mon frère le polytechnicien et de mon frère l’abbé; de ma sœur aînée, Fabienne, qui refusa les plus beaux partis, afin de se consacrer à remplacer notre mère auprès des little ones; même de celles-ci que nous appelions nos deux Benjamines.
Avec de grandes différences de caractère, tous se ressemblaient par le principal: l’amour de nos parents, la charité envers le prochain, quel qu’il fût, une intelligence très ouverte et très fine, par-dessus tout la piété, celle dont S. Paul a dit qu’elle est utile à tout: Pietas ad omnia utilis est.
J’atteignais ma quatorzième année. Deux ans auparavant, j’avais fait ma première communion.
Comme il n’y avait pas de catéchisme de persévérance à la Mardelle, mon père et ma mère, en s’aidant de quelques livres, m’en professèrent un excellent. Chaque semaine, je faisais une composition sur un sujet religieux. Et je puis dire qu’à toute sorte de points de vue, cet exercice me fut on ne peut plus profitable.
Cette époque de ma quatorzième année est une date dans ma vie.
Une maladie soudaine et qui dérouta la science des médecins nous enleva notre mère.
Si le mot désespoir n’était absolument antichrétien, c’est celui qu’il faudrait appliquer à la douleur qui sembla déchirer et broyer le cœur de notre pauvre père.
Il aimait notre mère de toutes les forces d’une âme très aimante, et qui n’avait jamais aimé,– dans le sens complet du mot,–que la mère de ses enfants.
Sa résignation n’en fut que plus admirable. car elle était à la hauteur de la plus achevée douleur qui se puisse imaginer.
Cette douleur était si profonde qu’elle le rendit comme insensible à un événement très considérable qui se passa, quelques mois après, dans notre famille.
Nous fûmes ruinés, par la trahison d’un ami.
Mon père pardonna, sans hésiter, à cet ami infidèle.
Quant à la ruine elle-même, comme on s’étonnait, un jour, du peu de cas qu’il semblait en faire, il sourit tristement: «Lorsque l’on a tout perdu– tout, pardon, mon Dieu; le tout, c’est vous, et vous me restez; mais votre mère, avec vous, mes enfants, était mon tout de la terre–lorsque l’on a tout perdu, cette question de la fortune est bien secondaire et bien misérable.»
Cependant, comme rien n’était plus raisonnable et moins personnel que notre père, se livrer tout entier à l’amère volupté des larmes lui eût semblé de l’égoïsme. Frappé dans ses affections d’époux, il ne devait ni ne voulait oublier qu’il était père.
Cette ruine n’était pas une ruine absolue. D’une grande fortune, nous descendions à une très médiocre aisance.
Mais, Dieu merci, et grâces aussi en soient rendues à nos parents, ni nous n’étions follement attachés aux aises et à l’éclat de la vie, ni nous n’avions croupi dans une torpeur intellectuelle qui nous rendît impossible ce qui nous devenait nécessaire: l’exercice d’une profession un peu lucrative.
Mon père, qui avait conservé de belles relations, et dont le malheur immérité avait excité une sympathie générale, obtint assez facilement les fonctions modestes, mais convenablement rétribuées, de receveur municipal à Clermont.–Joint à quelques épaves de notre ancienne fortune, ce traitement nous permit de joindre les deux bouts.
Mon frère ainé fut, tout naturellement, boursier au séminaire, et Alfred, le cadet, allait sortir de l’École Polytechnique, avec une position qui lui permettrait de se suffire.
Restaient Fabienne, les deux Benjamines et moi, qui, avec mes14ans1/2, occupais un rang intermédiaire.