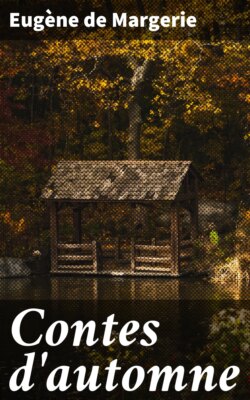Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
LA MORT.
ОглавлениеTable des matières
Il était trop tard.–J’avais, selon l’expression prêtée à M. Cousin, tiré mon chapeau à la religion catholique.
Qu’avais-je mis à sa place? Rien; car le doute n’est rien… A ma foi catholique je n’avais pas substitué une autre foi. J’avais seulement ébranlé mes croyances.
Au lieu de me balancer paisiblement dans le port, appuyée sur l’ancre de la divine espérance, je m’étais rejetée en pleine mer, où j’étais en proie à toutes les terreurs de la tempête.
Revenir en arrière, reconnaître que je m’étais trompée, demander des lumières à ceux qui m’entouraient–à mon père, si ferré sur la doctrine chrétienne, à mon maître dont la vocation, pour, ainsi dire, avait été de démontrer la parfaite compatibilité de la science et de la foi–lire de bons livres, converser avec de bons prêtres–pieux et doctes–voilà ce que j’aurais dû faire.
Il y avait des jours où je me disais que c’était là, non seulement mon devoir, mais mon intérêt, le seul moyen de reconquérir cette paix de l’âme dont l’absence me causait d’indicibles tortures.
Je me le disais. Ou plutôt ce qui me restait de conscience me le murmurait tout bas.
Mais, tout de suite et bien haut, l’orgueil me rappelait que pareille humiliation était impossible.
Je traînais donc péniblement la chaîne d’une honnête impiété.–Je dis honnête, pour parler le langage du monde, et parce que, pour qui s’en fût tenu à l’écorce des choses, rien ne semblait changé à ce qu’avait été ma vie, du temps de mon christianisme.
Je me montrais toujours respectueuse et dévouée pour mon père, douce et d’une humeur égale avec mes frères et sœurs.
Je visitais volontiers les pauvres, et ne me faisais pas prier pour leur rendre toute sorte de services, souvent pénibles, même répugnants.
Mais qu’est-ce que tout cela, lorsque manque le souffle inspirateur? Où sont les heureuses conséquences morales des charités dont Dieu est absent?
Autrefois, quand j’étais chrétienne, je ne portais pas un bon de pain ou de viande à ce vieillard, à cette veuve, à ces orphelins, que je n’élevasse d’abord mes pensées vers le ciel, que je ne priasse pour l’âme de ces pauvres, plus misérable souvent et plus dénuée que leur corps. Je ne le leur disais pas: quelque chose le leur disait pour moi.
Souvent j’eus la joie de les voir revenir à Dieu, poussés surtout par cette pensée que c’était le seul moyen pour eux de me manifester leur reconnaissance.
Hélas! Maintenant, d’abord j’avais beaucoup diminué ces visites charitables.–On a beau dire: la vraie source de l’amour des hommes, c’est l’amour de Dieu; et l’on cite, comme une sorte d’heureuse inconséquence, les libres-penseurs qui se livrent aux œuvres de miséricorde.
Et quand, par une réminiscence de mes anciennes habitudes, et pour ne pas laisser à mes anciens amis cet argument ad hominem: «Voyez, en cessant d’être chrétienne, elle a cessé d’être charitable,» quand je reprenais le chemin des mansardes ou des sous-sols, j’étais embarrassée pour savoir quoi dire à ceux que j’allais visiter.
J’étais, en effet, une étrange variété de libre-penseuse.
Je n’avais pas tiré ma révérence aux dogmes chrétiens pour me livrer à une vie désordonnée. Je suivais tout simplement–et très criminellement–l’entraînement de l’orgueil… Je voulais me suffire à moi-même, et pas plus au ciel qu’ici-bas, je ne voulais accepter de maître.
Mais tout ceci était plutôt du royaume des pensées que de celui des faits.
Aussi le public ne comprenait pas grand’chose à mes évolutions. «Elle est folle, disait-on, ou malade.»
Je laissais dire. Je ne m’affichais pas. Je fuyais, bien plus que je ne les recherchais, les discussions philosophico-religieuses.
J’étais surtout trahie par mon silence.
Quand dans nos réunions de famille, une question était levée qui touchât, de près ou de loin, aux points en litige entre croyants et incroyants, chacun disait son mot, plus ou moins exact et plus ou moins frappant; mais derrière lequel on sentait la foi, le bonheur d’appartenir au bercail de Jésus, la résolution de tout souffrir plutôt que de s’en laisser arracher, la profonde et tendre reconnaissance pour les bienfaits de Dieu.
Si j’avais parlé, je le sentais, ma note eût été discordante.
Je me taisais. Mais mon mutisme était une sorte de protestation.
«Décidément Marceline n’est plus des nôtres,» se disait mon père.
Et, quoiqu’il le sût du reste, ce nouveau témoignage le navrait.
Il finit par en mourir… Il mourut de chagrin.
On ne réfléchit pas assez, ce me semble, à cette expression mourir de chagrin. Les Anglais disent mourir d’un cœur brisé.
Que de jeunes veufs ont. langui quelques mois, puis se sont éteints à leur tour, sans maladie déterminée, emportés par un bouleversement ou un affaiblissement de l’organisme! Ce bouleversement ou cet affaiblissement, quelle en est l’origine, sinon l’inconsolable douleur d’avoir vu partir une femme bien-aimée?
Que de mères frappées coup sur coup par la mort de leurs enfants, n’ont pas voulu, ou n’ont pas su, se rattacher à la vie, et consoler ceux qui leur restaient, mais se sont couchées dans le tombeau, à côté de leurs anges disparus?
Les uns et les autres sont à plaindre. Mais ils sont à blâmer aussi.
Cette désespérance est une sorte de suicide.
Elle accuse d’ailleurs une bien imparfaite résignation et un esprit trop peu chrétien.–Ce que Dieu nous avait donné, est-ce qu’il n’est pas maître de le reprendre? Et, quand ceux que nous aimions sont morts dans la paix du Seigneur, est-ce que nous ne devrions pas les pleurer sans doute, mais, tout en les pleurant, bénir Dieu de les avoir rappelés à lui?
Bien plus profonde et plus aiguë était la douleur de mon père.
Il était chrétien, chrétien en tout et par-dessus tout, et il me voyait renier la foi de mon baptême!
Il essaya deux ou trois fois de me ramener.
Je le laissai s’expliquer. Ni je ne l’interrompis brusquement, ni je ne perdis, en lui répondant, le respect filial.
Mais mes réponses accusaient une intention tellement inébranlable de persister dans ma nouvelle voie, elles évitaient avec tant d’adresse de rentrer en lutte; elles étaient accompagnées de protestations de déférence, de tendresse et de dévouement qui semblaient si sincères–qui l’étaient en effet –que mon pauvre père vit qu’il n’y avait rien à faire, rien absolument.
«Un miracle seul nous la peut ramener,» dit-il
Il en conçut un tel chagrin que sa santé–ce qui lui restait de santé–alla en déclinant rapidement.
Une autre attaque de paralysie lui fit descendre cinq ou six de ces degrés qu’on ne remonte guère, quand on a soixante-dix ans.
Bientôt, nous vîmes tous que sa fin approchait.
Chose étonnante, après l’affaissement que j’ai signalé dans ses facultés intellectuelles! l’avant-veille de sa mort, il y eut comme une résurrection de tout son être, résurrection qui dura un peu plus de vingt-quatre heures, et que Dieu permit, je n’en doute pas, pour que ce bon père pût nous dire à chacun une de ces paroles que l’on n’oublie pas; car elles sont comme sacrées par la mort.
Il venait de recevoir les derniers secours de la Religion, avec cette piété, ce recueillement, cette paix, ce mélange de calme et d’enthousiasme qui eussent suffi, ce me semble, pour convertir les spectateurs les plus indifférents..
Il parla quelques minutes à chacun de mes frères et sœurs.
Il m’avait réservée pour la dernière.
Je crus apercevoir dans son regard une expression sévère, du moins bien sérieuse.
«0mon père, lui dis-je, vous ne doutez pas de ma tendresse.
–Non, ma fille; et ce n’est pas en ce moment que je voudrais t’affliger par des reproches. Pourtant ce n’est pas l’heure des paroles banales.
Je ne reviens pas sur le passé. Je te recommande une seule chose pour l’avenir: la bonne foi avec toi-même.
Demain, peut-être, ou dans bien des années, il viendra un jour où quelque chose te dira qu’en quittant la religion, outre que tu m’as donné le coup de la mort, tu as tué ton âme. Je te conjure de ne pas mépriser cette voix intérieure.»
Je n’eus pas le temps de répondre.
Mon père me bénit, et rendit le dernier soupir.