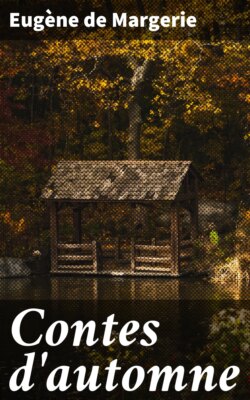Читать книгу Contes d'automne - Eugène de Margerie - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
L’ORGUEIL COMMENCE A POINDRE.
ОглавлениеTable des matières
Presque toutes nos actions ont une double source: une bonne et une mauvaise.
Je m’étais dit:
«Notre cher père, habitué à la vie large de grand propriétaire et à la douce liberté des champs, se résigne, pour nous, au fastidieux travail d’un bureau. Fabienne est tout entière aux soins du ménage, à la direction des petits.–Moi qui suis plutôt grande que petite, ne pourrais-je pas prendre une partie de ce fardeau domestique, m’y préparer du moins, en poussant plus loin mes études, en me mettant ainsi à même, après quelques années, d’apporter à la caisse commune ma petite contribution, comme institutrice, comme traductrice, comme femme de lettres.
Il fallait m’arrêter là, prier Dieu de bénir mes efforts et soumettre humblement mon projet à la sagesse paternelle.
Hélas! je priai peu, ou point du tout, et je me dis, avec une certaine complaisance: «D’ailleurs, je suis très intelligente. J’en sais déjà, sur presque toutes les matières de l’enseignement, beaucoup plus que la plupart des jeunes filles de mon âge.... Pour peu qu’on me mette dans la voie et qu’on m’y laisse la bride sur le cou, j’irai loin. Non seulement, grâce à moi, la fortune rentrera chez nous; mais j’acquerrai de la réputation, un nom. de la gloire peut-être.»
Quand l’imagination est en route, elle ne s’arrête guère. Je vous fais grâce des folies où la mienne se laissa entraîner....
Pourtant, j’avais un certain bon sens naturel, aidé des leçons d’humilité chrétienne dont avait été bercée mon enfance. Et lorsque j’abordai mon père, pour lui demander son agrément, je ne laissai voir–même à moi-même,–que le côté généreux de mon projet.
«J’étais jeune, pleine de santé, pleine d’ardeur, plus portée vers l’étude que vers l’économie domestique. Il me semblait que, si l’on m’achetait quelques livres, si l’on permettait à notre vieil ami, M. Augustin, professeur à la faculté de ***, de me donner quelques leçons, j’en serais d’abord très heureuse; puis, au bout de deux ou trois ans, je pourrais entrer comme gouvernante dans une famille, comme sous-maîtresse dans une pension, peut-être même me livrer à des travaux littéraires ou scientifiques.
J’allégerais ainsi, en en prenant ma part, le fardeau paternel et fraternel.»
Cela était dit avec un mélange d’exaltation et de simplicité.
Évidemment, j’étais de bonne foi. Je pensais ce que je disais. Tout entière aux sentiments de famille, j’avais oublié les visées ambitieuses qui, le matin encore, me faisaient construire de si ridicules châteaux en Espagne.
Mon père pouvait-il faire autrement que d’accepter?
Il me baisa au front. «Que Dieu te bénisse, ma fille, me dit-il, et te protège toujours.»
Et ce que je demandais me fut accordé.
Je me mis au travail avec feu, et j’y persévérai avec acharnement. J’obtins tout de suite de très beaux résultats. Je comprenais à demi-mot; je m’assimilais, presque sans effort, tous les enseignements de M. Augustin. Je voyais l’horizon reculer devant mes yeux ravis. J’avais comme l’ivresse de la science.
Mon père, en me félicitant, me dit un jour: «J’espère bien que tu remercies Dieu de cette réussite, et que tu le pries instamment pour que la science ne t’éloigne pas de lui.»
Je fus un peu interloquée. Pourtant je répondis: «Bien sûr.»
Je n’étais pas bien sûre d’être sincère, en parlant ainsi.
J’entendais, au fond de mon cœur, comme une pensée qui m’obsédait. une pensée mauvaise, à laquelle pourtant je ne voulais pas renoncer: mon père me paraissait, par cette recommandation, pécher contre la sainte liberté de la science; il me faisait l’effet d’être fanatique.
Je me repliai sur moi-même. Je reconnus que, pour la première fois, j’avais mis la main à une entreprise importante. cette tentative de venir en aide aux miens. Quel besoin n’avait-elle pas d’être bénie de Dieu? Qu’avais-je fait pour attirer cette précieuse bénédiction?
Tandis qu’autrefois–autrefois! Il y avait quelques mois à peine–je n’aurais pas fait la moindre démarche, sans m’écrier, d’un cœur ému: «Mon Dieu, je vous l’offre,» j’avais presque changé ma vie, sans consulter Dieu et le père de mon âme.
Pour m’excuser, je me dis: «Je ne l’ai pas fait à mauvaise intention; c’est un simple oubli.»
–Oui, mais maintenant que l’avertissement de mon père était venu me troubler et me sortir de ma bonne foi, n’avais-je pas quelque chose à faire?. Mon père m’a signalé un sérieux danger. Je sens qu’il a raison. Je devrais me confesser, pour faire descendre la grâce d’en haut sur mon œuvre de piété filiale. Quel malheur, si cette œuvre, bonne en soi, l’orgueil, un orgueil impie, venait à la corrompre dans sa source!»
Tel était le langage intérieur que je ne pouvais m’empêcher d’entendre, quoique je m’efforçasse de ne le point écouter.
Et, pour m’étourdir, je répliquais avec une assurance forcée:
«Me confesser! A quoi bon? Est-ce que c’est un péché de cultiver les sciences, surtout quand on y veut trouver du pain pour sa famille?
D’ailleurs, ces questions scientifiques ne regardent pas la religion. Je ne veux pas la quitter, la religion. Mais j’entends qu’elle ne sorte pas de son domaine: le gouvernement de ma vie morale. Pour le reste, c’est affaire à ma raison.»
Ces exclamations étaient autant de sophismes. Jamais homme sensé n’a dit que ce fût impiété de cultiver les mathématiques ou la géologie. Mais si la science éloigne des pensées et des habitudes religieuses, si elle prend, vis-à-vis de la Religion, cet accent impérieux et presque méprisant que je ne quittais guère dans le très fond de mon âme, il est évident que la science nous place sur une mauvaise pente et qu’elle peut, sans être un péché elle-même, conduire à des fautes très graves, quand ce ne serait que l’innombrable variété des péchés d’orgueil.
«Vous les reconnaîtrez à leurs fruits,» a dit Notre-Seigneur. Lorsque l’amour de la science nous éloigne de l’amour de Dieu, lorsque de pieux que nous étions, il nous rend froids à l’égard de Dieu, et d’une indifférence qui touche à l’hostilité, il est bien évident que la science nous est funeste.
C’est le cas de citer, une fois de plus, ce verset de l’Imitation: «Un humble paysan qui sert Dieu, «vaut sans doute beaucoup mieux qu’un philoso-«phe superbe qui, se négligeant lui-même, consi-«dère le cours des astres.»
Vous serez tenté peut-être de rejeter sur mon professeur la responsabilité de cet attiédissement de ma foi.
Vous auriez tort. Tout en ayant la passion de la science, tout en s’y livrant, en dépit de ses cheveux blancs, avec une ardeur juvénile, M. Augustin était toujours et avant tout, un solide chrétien.
Comme il joignait à cette foi inébranlable les plus charmantes qualités du cœur et de l’esprit, une égalité d’humeur inaltérable, un dévouement à ses amis qui ne connaissait pas de limites, il semblait que ses exemples dussent avoir sur moi une irrésistible influence.
Il n’en était rien.
Tant que cet excellent maître demeurait sur le terrain exclusivement scientifique, je le suivais avec un intérêt infatigable. Mais, dès qu’il faisait une incursion dans le domaine religieux, qu’il se soulageait, pour ainsi dire, en rendant hommage au Créateur du ciel et de la terre, qu’il disait: «La science, c’est beau, mais ce n’est pas tout. Il y a encore, , il y a surtout, la morale et la religion. Une science qui éloignerait de Dieu serait une fausse science, une science incom-plète, que dis-je? une science funeste. Plutôt la foi du charbonnier,»–quand le bon M. Augustin se complaisait en quelqu’une de ces hautes pensées, j’estimais, moi, qu’il était dans les nuages.
Je cessais de manifester mon approbation. J’avais toutes les peines du monde à ne pas protester contre ces pieuses divagations.
Et, s’il s’en apercevait, et qu’il me citât Bacon, Newton, Pascal, Cuvier, Cauchy, ces grands savants et en même temps ces grands philosophes chrétiens,
«Mon cher maître, répondais-je, je vous aime et vous vénère tout plein; mais je vous conjure de ne pas mêler deux choses absolument distinctes, la religion et la science.
Depuis que je cultive celle-ci, j’ai pris un goût dominant, presque exclusif, pour les vérités rigoureuses, démontrables, dont je puis me rendre compte à moi-même....
Quant à la religion, c’est une question de sentiment que chacun résout pour soi-même, surtout d’après ses dispositions et la nature de son esprit. Chez vous, le cœur domine: vous êtes chrétien, autrement dit mystique. Moi, je suis un esprit rigoureux: je suis philosophe.
Cela ne m’empêche pas de réserver à la religion une petite place, par esprit de famille et pour la direction de ma vie morale....»
–Je tenais à cette expression. un peu hypocrite.
Le pauvre M. Augustin était profondément affligé de ces déclarations, surtout du sang-froid avec lequel elles étaient faites. Une jeune fille de dix-huit ans à peine, ainsi sur le chemin de l’incrédulité, quoi de plus déplorable?
Pourtant, par routine, par respect humain, pour ne pas trop affliger les miens, je demeurai, pendant quelques années encore, fidèle à la lettre du christianisme.