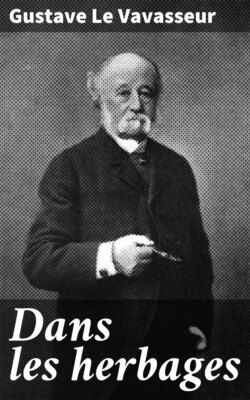Читать книгу Dans les herbages - Gustave Le Vavasseur - Страница 5
III
ОглавлениеQui sera madame Durand, deuxième du nom?
La voisine se mit d’abord en campagne.
Veuve à vingt ans, brune de peau, noire de cheveux, le feu aux pommettes, le sourire aux lèvres, rondelette, proprette, sémillante et frétillante, Éléonore Duchemin faisait valoir deux ou trois acres de terre, grevés d’hypothèques, payait la rente et joignait les deux bouts, non sans ahaner et sans tirer la langue.
Elle allait à tous les marchés, conduisant elle-même sa petite carriole: elle s’acheminait sans sourciller par la traverse, sautant de cahots en cahots et ricochant d’ornière en ornière. Elle n’était pas plutôt sur la grande route que son bidet, taquin et ronge-frein, s’encapuchonnait et s’emportait. Il était rare qu’elle arrivât au marché sans des accrocs et des carambolages dont elle prenait son parti aussi gaiement que ceux qu’elle heurtait. Le plus impatientant des occupants de la route était Lysis, qui s’en allait au trot magistral et régulier de sa percheronne et ne se dérangeait pas facilement. Tantôt le bidet d’Éléonore caracolait derrière son tilbury, tantôt il le dépassait comme une flèche, rasant et franchissant les tas de cailloux. S’il y avait malice, la pimpante ménagère y perdait ses gestes et sa peine; Lysis ne tournait seulement pas la tête.
Un jour, les essieux des deux équipages en vinrent aux prises. Le petit cheval endiablé mordit la grande percheronne, qui ne daigna même pas ruer. Lysis descendit, débrouilla les traits en un tour de main et sépara les combattants.
Éléonore avait d’abord poussé un cri. L’écho seul lui avait répondu.
Elle s’était quasi évanouie; elle avait été obligée de reprendre ses sens toute seule.
Elle finit par décocher son plus appétissant sourire à Lysis, en lui disant:
— Merci, voisin.
Celui-ci lui répondit:
— Il n’y a pas de quoi, voisine.
Et l’affaire n’eut pas de suite.
La cousine fut plus hardie sans être plus heureuse.
Grande, sèche, rousse, gauchère des deux mains et des deux pieds, douce comme une brebis, naïve comme une agnelette, rassise comme du pain de huit jours, Brigitte Desvallées avait coiffé sainte Catherine pendant vingt-sept années. Elle avait toujours attendu son cousin remué de germain, le grand Lysis, son camarade d’école et de première communion, le protecteur de son enfance, plus riche qu’elle sans doute, mais sans disproportion.
Quand il s’était marié, Brigitte s’était résignée.
Quand il devint veuf, Brigitte songea et prit un grand parti.
Un dimanche soir que Lysis était au manoir de la Forge, Brigitte acheta un cornet de bonbons pour la petite et descendit après vêpres chez le cousin. La collation fut offerte et acceptée; la promenade au jardin proposée et entreprise.
Lysis et la grande Brigitte avaient déjà fait trois tours d’allées sans rien dire, lorsque la cousine, prenant son parti et se jetant résolument à l’eau, dit sans préambule à son cousin:
— Mon cousin, il faudrait vous remarier.
— C’est bien aisé à dire, cousine, répondit Lysis, biaisant en fin Normand qu’il était, faudrait pour cela trouver chaussure à son pied.
La grande Brigitte n’aurait pas jeté son bonnet pardessus les moulins, mais elle lança intrépidement son soulier devant elle en disant:
— Essayez donc si celle-ci vous irait.
— Ah! cousine, répondit Lysis, nous ne chaussons pas du même pied.
La seconde affaire ne réussit pas plus que la première.
Et malgré les prédictions des commères, Lysis resta veuf.
Le ménage allait bien un peu à la diable et le pot-au-feu coulait par-ci, par-là ; mais la maison était si solide et la culture si simple qu’il n’y paraissait pas. La bourse du maître pouvait supporter les égratignures. Les dix hectares de la cour, abandonnés aux vaches à lait, département du beurre et du fromage, ordinairement dévolu à la maîtresse de maison, restaient sans grave inconvénient entre les mains de la vieille Manette.
Imbue des traditions et des préjugés de la maison, elle approvisionnait largement le ménage, et du produit vendu de sa laiterie pourvoyait à toutes les dépenses intérieures.
On ne semait pas un grain de blé dans les domaines de Lysis Durand; on fauchait quelques prairies pour les besoins de l’hiver, et c’était tout.
Les herbages, du meilleur fonds, étaient toujours parqués de cotentins. Au printemps, les bœufs maigres s’égaudissaient à tondre du bout des dents cette primeur généreuse et délicate qu’on appelle la pointe de l’herbe; ils en avaient dans l’été jusqu’au ventre et s’engraissaient à souhait. Aux brumes d’automne il en venait d’autres qui soufflaient sur le givre comme des bourgeois sur leur soupe et tremblaient pendant l’hiver en cueillant le foin de leur provende sur la neige. Ainsi sans semaille et sans culture se renouvelaient et renaissaient les herbes précieuses qui font de la chair et du sang. La tradition disait que, depuis le commencement du monde, il n’était pas entré une vache dans les herbages héréditaires des Durand, qui, de père en fils, gardaient comme un dogme la pureté de leur herbe sans souillure. Quand une vache laitière tarissait dans leur cour, elle y mourait de vieillesse. Aussi vendaient-ils leurs bœufs, aux plus hauts cours du marché, à des bouchers attitrés, anciens comme leurs pâturages. On sait que le métier de boucher est essentiellement traditionnel et héréditaire. Les noms du moyen âge se lisent encore sur leurs enseignes: Michelet a pu constater l’existence, à la fin du siècle dernier, de boucheries tenues à Paris par les descendants directs des Saint-Yon et des Thibert, ces farouches compagnons de Simonet Caboche.
Lysis suivit de son mieux la tradition de ses pères. Conservateur par principe, routinier par paresse, il acceptait de confiance l’expérience du bien, sans jamais être tenté par l’essai du mieux, contre lequel il était en garde jusqu’au préjugé. Il s’en allait au loin s’approvisionner de bœufs maigres, fréquentait Poissy et Sceaux, et ne dédaignait pas de se montrer aux marchés hebdomadaires de ses environs. Il avait les habitudes et les appétits de sa race, mangeant fort, mâchant dru et longtemps, buvant sec, gardant en toute occasion une soif pour la poire. Jeune, il s’était acoquiné par nécessité de métier à la cuisine monotone et incrassante de la table d’hôte et aux libations échauffantes du café. Le ménage, tenu à tâtons par une femme chétive, n’avait pas eu le temps de le déshabituer de l’auberge; il en reprit à trente ans la routine à peine oubliée, et à quarante il la suivait encore sans malaise et sans dégoût. Jamais on ne l’avait vu même confiner l’ivresse, tant il avait su maintenir son corps de fer dans les bornes d’une sobriété relative et appropriée au sujet.