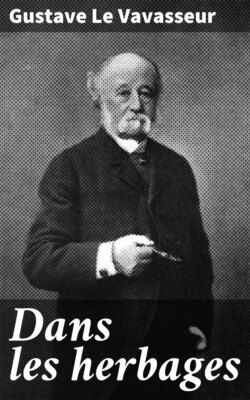Читать книгу Dans les herbages - Gustave Le Vavasseur - Страница 6
IV
ОглавлениеDix années passèrent sur la tête de Lysis, sans laisser de traces visibles. Le corps était sain, robuste, moins souple, mais plus dur à la fatigue que dans la jeunesse. Le cœur était demeuré tout entier aussi meurtri et aussi endolori que le premier jour du veuvage. Le temps, ne trouvant pas une plaie vive, ne s’était pas donné la peine de la cicatriser. Lysis gardait le deuil par habitude, portait des cheveux de sa femme dans un médaillon suspendu à la chaîne de sa montre, et le baisait tous les soirs comme une relique avant de se coucher. Depuis son veuvage il n’avait convié personne, même au carnaval, à ces repas pantagruéliques que l’hospitalité fastueuse des Durand considérait comme un devoir traditionnel.
Mais si le père était resté stationnaire d’esprit et de corps comme la statue vivante et le dernier exemplaire de la race des Durand, la fille avait grandi. Zénaïde, à dix ans, était la plus singulière enfant gâtée de dix lieues à la ronde, dans un pays où les filles sans mère sont presque aussi choyées que des garçons.
Si quelque plume friande de bonne encre refaisait, à l’usage des jeunes filles, la description de l’enfance de Pantagruel, à peine donnerait-elle une idée des mutineries et des espiègleries de la petite Zénaïde. Quelques nuances échapperaient à Rabelais lui-même, et son libre pinceau gaulois ne serait pas trop haut en couleur pour barbouiller certaines anecdotes.
Tous les domestiques de la maison étaient aux ordres de Zénaïde et faisaient ses plus déraisonnables volontés; elle avait en outre à son service particulier une petite orpheline, nourrie et logée pour sa peine. La pauvre enfant gagnait durement son vivre et son couvert. Souffre-douleur d’une jeune maîtresse ornée de caprices à tous crins poussés en liberté, elle était encore le jouet des autres serviteurs. Coups d’épingle par ci, coups de pied par là, tant au propre qu’au figuré, étaient ses gratifications ordinaires et quotidiennes.
Tant que Zénaïde n’eut pas l’âge de raison, cette liberté sauvage développa le corps et fut sans grand inconvénient pour l’âme. Une chute punissait une imprudence, un rhume expiait une promenade dans la rosée, et les coups de griffe marquaient à peine sur la peau endurcie de l’esclave.
Quand l’âge vint, les défauts grandirent avec lui, les gentillesses dégénérèrent en vilenies et les espiègleries en méchancetés. Le père faisait parfois les gros yeux et la grosse voix, mais sans conviction. Il s’acoquinait aux vices naissants de sa fille et perdait sa dignité en même temps que son autorité de père. Le pauvre homme le sentait bien; mais comme il cachait dans son cœur et dans sa tête de géant des trésors d’indulgence et de faiblesse, il n’osait prendre le seul parti raisonnable: mettre Zénaïde en pension, et comme on dit encore dans le pays de Saint-Gérebold-du-Plantis, — au couvent.
Un événement providentiel de second ordre vint au secours du père et de la fille. En 1856, Lysis fournit un des bœufs gras, et, suivant la tradition de sa famille, retint à son boucher le filet, succulente friandise destinée à être mangée en famille, à moitié crue, suivant la mode de Normandie. En Abyssinie, on se dispense de montrer la viande au feu. Nous autres Normands, carnivores civilisés, nous avons la pudeur et l’hypocrisie de la faire chauffer.
Jadis, à pareille fête, les Durand invitaient le ban et l’arrière-ban des parents, la tribu tout entière des alliés et des amis. La grande cuisine du manoir flambait comme une fournaise, et dans la salle à manger, parée comme pour une noce, sur une table en fer à cheval, où resplendissait, en gardant le cadre de ses plis, la réserve des armoires, s’amoncelaient des victuailles à rassasier un Anglais par les yeux, mais dont la vue ne faisait qu’exciter l’appétit des convives.
La grande salle était restée fermée depuis dix ans, à la grande déconvenue des arrière-cousins. Le repas du baptême de Zénaïde avait été le dernier festin donné par les Durand. A ses rares apparitions au logis, Lysis mangeait avec ses gens, au haut bout de table, sa fille sur ses genoux, effleurant à peine du bout des lèvres le ragoût domestique et souriant à l’effrontée Zénaïde qui fourrait ses doigts dans toutes les assiettes et se barbouillait à même le plat.
L’histoire du bœuf gras donna le signal du réveil. Les traditions de la famille apparurent tout à coup à Lysis. Il fit ouvrir et nettoyer la salle à manger. Le pinceau acheva la besogne de l’éponge, et le 25 février 1856, jour du mardi gras, le maître du manoir de la Forge offrit à trente convives, tout, pantelant et tout saignant, le filet d’un des bœufs promenés en triomphe à Paris l’avant-veille.
Mais il s’agissait bien d’un filet de bœuf pour régaler trente Normands, fût-ce le râble du dieu Apis en personne! Les marmites bouillaient, les casseroles gazouillaient, les broches tournaient, des arbres entiers brûlaient en sifflant dans la haute cheminée, fumées et fumets tournoyaient à la ronde, le visage des commères s’empourprait au feu, leurs tabliers blancs se tachaient à toutes les graisses et se roussissaient au manche des courtes poêles.
A dix heures du matin, parée comme une châsse et déjà barbouillée, Zénaïde se heurtait aux angles des tables en roulant ses yeux étonnés et écarquillait les narines à la fumée des plats. Pour la première fois de sa vie, la petite servante se reposait dans un travail innocent et facile. Elle épluchait et ratissait des carottes.
A midi sonnant, les convives commençaient à arriver. Le carillon de l’Angélus semblait tinter en leur honneur à mesure qu’ils entraient dans la vaste cour et qu’ils enfilaient la plantureuse allée de pommiers qui mène à la porte du manoir. Parents proches et amis lointains, du haut de leurs tilburys découverts, excitaient d’un dernier coup de fouet le trot de leurs chevaux ardents qui piaffaient, caracolaient et mordaient leurs brancards en arrivant, quelle que fut la longueur de la course fournie. Il avait gelé le matin; les pommettes des voyageurs étaient rouges, et leurs yeux brillants de larmes scintillaient au soleil. Lysis, du haut de son perron, saluait les conviés, allait au-devant d’eux, les accolait trois fois à la normande en s’informant de leur santé, et distribuait voitures et chevaux dans les hangars, dans les étables, dans les écuries. Quand la dernière place sous la charreterie fut prise, il ne s’embarrassa pas de cet encombrement. Il héla son domestique ahuri.
— Baptiste, cria-t-il d’une voix de Stentor, — remise la carriole au cousin Goulard sous le poirier de Raguenet; mets son cheval à la mangeoire de Marotte et lâche la jument dans la cour.
Zénaïde, toute sauvage et tout effarée, se tenait sur le perron avec son père et se cramponnait à un pan de sa vaste redingote; elle faisait la moue aux uns, la grimace aux autres, parfois se laissait embrasser par surprise, parfois rechignait comme une chatte en colère. Maussaderie et avances perdues; les convives indifférents entraient bruyamment en frappant les dalles du vestibule du talon de leurs grosses bottes pour se réchauffer. On déposait les peaux de bique, les fouets et les blouses. Tout le monde buvait résolument le cou de l’arrivée sur la table de la cuisine, les timides, un verre de cidre, les résolus, une goutte, c’est-à-dire un demi-verre d’eau-de-vie, pour préparer les voies digestives.
La frétillante Éléonore n’était pas de frairie; mais la cousine Brigitte était venue manger la soupe sans rancune, s’étant chaussée, à son gré, d’un grand niais qu’elle rendait le plus heureux du monde. Elle faisait, sans tousser, rubis sur l’ongle avec le fil en quatre.
A midi un quart, le dernier convive arriva. C’était le vénérable curé de Saint-Gérebold, qui avait baptisé toute la jeunesse de sa paroisse et avait le franc parler avec ses ouailles; bien qu’il fût le plus proche voisin, il arrivait le dernier, soit qu’il craignît de montrer trop d’empressement à son rendez-vous de table, soit qu’il voulût se soustraire à la libation préliminaire.
Zénaïde en avait une terrible peur, mais elle n’osait ni l’éviter ni lui faire la moue. Elle le regarda avec des yeux de coq et se laissa tapoter sur la joue, et même un peu pincer l’oreille, sans répondre à la caresse, mais sans se révolter contre l’importune familiarité.
— Monsieur le curé, dit Lysis en enlevant solennellement le couvercle d’une immense soupière à fleurs rouges, mettez-vous vis-à-vis de moi. Quant à vous, mes chers parents et amis, comme je vous aime et vous estime tous autant les uns que les autres, je ne vous assigne pas plus à chacun votre place à ma table que dans mon cœur. Mettez-vous où vous voudrez.
Chacun s’assit à la ronde, et le festin commença.
Muse du divin Homère et du divin Cervantès, qui dictas à tes favoris le menu du repas des dieux et celui des noces de Gamache, inspire-moi pour le décrire; et vous, Grandsgousiers augerons, consolez-vous si vos franches repues de carnaval n’ont trouvé qu’un indigne historien. Le véritable menu n’est pas celui qu’on lit, mais bien celui qu’on mange.
Les saucisses succédaient au bœuf bouilli, et puisque Homère a nommé les boudins, je ne serai pas plus prude qu’Homère. Les fricassées de poulet, les abatis de volaille, les ragoûts de toute sorte avaient été remplacés par les pâtés chauds. La grosse faim était apaisée chez les plus intrépides: il y avait une sorte de recueillement général. Il était environ trois heures.
C’était le moment de faire un trou.
Jusque-là, le cidre avait été la seule boisson servie sur la table. On apporta la vieille eau-de-vie de trente ans, et chacun mesura lui-même la profondeur de la caverne qu’il s’agissait de creuser dans son estomac. Les plus modérés se versèrent deux doigts d’eau-de-vie, — une demoiselle. Les vieillards solides remplirent le verre jusqu’au bord.
Le fameux filet fut servi saignant; une légère fumée s’élevait du plat, il devait être cuit. Cuit ou cru, il fut mangé à belles dents et suivi par une interminable procession de rôtis variés. Les dindons et les poulardes semblaient le produit de la razzia d’une basse-cour entière. Chacun, par politesse, acceptait un morceau, le mangeant lentement, et, par politesse aussi, suivant l’ancien usage, en laissait un peu sur son assiette.
M. le curé était allé dire son bréviaire après le premier service, mais il avait promis de revenir au dessert.
A cinq heures, on versait le café dans les tasses. Les langues allaient leur train, langues de Normands bien affilées, visant au fin mot et ne s’arrêtant pas au gros; les plus gais fredonnaient en chevrotant quand M. le curé rentra.
Lysis profita du moment de silence qui se fit à son arrivée, et, après avoir légèrement toussé, il adressa à ses convives le petit discours suivant, qu’il avait évidemment préparé :
«Mes chers parents et amis,
«Je n’ai que faire de vous exposer ma situation et de vous faire mon histoire. Vous les connaissez toutes les deux. J’ai une fille qui est toujours restée chez moi jusqu’à ce jour, s’élevant à la grâce de Dieu, qui l’a préservée de tout accident. Pour tâcher de lui donner une santé meilleure que celle de sa pauvre mère, je lui ai laissé humer le grand air et faire toutes ses volontés. Mais la santé du corps n’est pas tout. Zénaïde est bien allée par-ci par-là au catéchisme et à l’école, mais M. le curé et M. l’instituteur peuvent vous dire qu’elle ne sait rien du tout. Comme elle va sur onze ans depuis le 15 décembre dernier, cela commence à être honteux, et il faut que cela finisse. Si quelqu’un de vous a un bon conseil à me donner par rapport à Zénaïde, il me tirera d’un fier embarras. Ainsi, voyez, mes chers parents, ce que vous avez à me dire.»
Il y eut un moment de silence. Zénaïde n’occupait la pensée de personne, et tout le monde était pris à l’improviste.
— Lysis, mets Zénaïde aux Ursulines de Livarot, dit tout à coup le curé sans plus de détour en se levant de table.
— Merci, mon bon monsieur le curé, elle y sera à la rentrée de Pâques.
Lysis avait dit ces mots avec effusion. Il se leva tout joyeux, distribuant des poignées de main aux convives qui se dispersaient. Lysis était content et respirait à pleins poumons. Il avait débité son discours jusqu’au bout, et le conseil qu’il souhaitait lui était venu du côté où il en craignait un autre. Il eût déjà mis Zénaïde en pension depuis un an, sans la crainte de contrister son curé en l’enlevant à son catéchisme de la paroisse pour confier à des mains étrangères le soin de sa première communion. Il avait compté sur un conseil de famille pour s’excuser aux yeux du bonhomme, et c’était lui-même qui venait de choisir le pensionnat.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. A six heures, la cour du manoir de la Forge était vide. Tous les convives étaient partis de bonne humeur, mais aucun n’était gris.
Après les vacances de Pâques, Zénaïde entra pensionnaire aux Ursulines de Livarot.