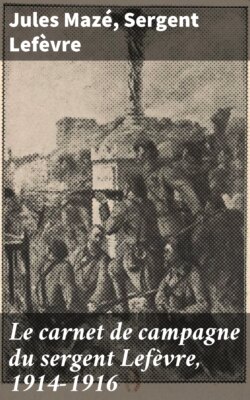Читать книгу Le carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916 - Jules Maze - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIC-SUR-SEILLE
ОглавлениеPendant toute la journée du 16 août, derrière le tonnerre de nos canons, les troupes se préparèrent, au-dessus de la forêt de Bezange, du côté de Moncel et de la ferme Haute-Burthecourt, pour la pénétration sérieuse en territoire annexé.
Ce jour-là, j’aperçus les flammes et la fumée de plusieurs incendies allumés chez l’ennemi par nos obus.
Enfin, cette fois ça y était, nous allions marcher sérieusement, entrer carrément dans la danse, porter des coups et en recevoir; nous allions, en somme, commencer la guerre.
Cette pensée produisait chez tous une impression assez forte, une émotion qu’on s’efforçait de cacher; mais, je puis vous l’assurer, nous étions pleins d’enthousiasme, bien décidés à faire notre devoir jusqu’au sacrifice, et nous nous réjouissions d’en avoir fini avec notre existence de grandes manœuvres.
«Plus tôt on ira, plus tôt ce sera fini!» disait notre sergent.
Et c’était notre avis à tous.
Partout, autour de nous, des troupes se massaient, des troupes superbes et pleines d’entrain.
La France pouvait être fière de son armée, fière de ses enfants, qui allaient à la bataille, — à la mort, — avec autant d’ardeur, autant de bonne humeur que si on les avait conduits à une fête.
Le 17 août, nous partîmes de bon matin, nous dirigeant sur Vie, précédés par des dragons lance au poing.
Cette fois nous étions en tête, et nous allions avoir l’honneur de pénétrer les premiers en territoire annexé.
Le ciel semblait vouloir nous favoriser: la matinée était superbe, et la brise faisait claquer joyeusement notre drapeau. Je contemplais avec une curiosité bien légitime ce territoire annexé, cette terre promise dont je foulais enfin le sol. La campagne était ravissante, et le pays me parut très riche.
Lorsque nous escaladions un mamelon, j’apercevais, du côté français, la masse sombre de la forêt de Bezange, que longe la frontière et qui fermait l’horizon sur la droite; de l’autre côté, c’étaient de vastes prairies, des champs fertiles, des salines, des fermes importantes, puis la route blanche, la voix ferrée, la Seille débordée où la brise mettait des rides que dorait le soleil, et, plus loin, des coteaux tapissés de vignes, de vastes plateaux et des bois touffus.
De temps à autre on entendait le bruit du canon, et un camarade, originaire de Nancy, qui connaissait parfaitement la région, me dit que les pièces devaient tirer du côté de Château-Salins. Il me donna aussi des renseignements fort intéressants sur les salines, les mines de sel gemme et la façon dont on les exploite; mais cela n’a rien à faire dans un récit de guerre.
Sur ma demande, il me montra de loin la ferme de Lagrange, où avait eu lieu le combat dont j’ai parlé précédemment. Je la contemplai avec émotion, en pensant à l’héroïsme de nos chasseurs.
Bientôt nous pûmes voir, au delà de la voie ferrée, les maisons blanches de Vie, première ville de la Lorraine annexée où nous allions pénétrer.
Vers 8 heures, nos dragons d’avant-garde passaient au galop par la porte de Nancy et, comme lors de la reconnaissance du commandant Boussat, s’emparaient de la poste.
Jamais, tant que je vivrai, je n’oublierai notre entrée à Vic-sur-Seille, le 7 août 1914. Ce fut une scène grandiose, qui arracha des larmes à beaucoup d’entre nous, qui fit battre les cœurs furieusement; une de ces scènes qu’on ne peut décrire, dont aucun récit ne saurait faire comprendre la splendeur émouvante.
Au centre de la ville se dresse la statue de Jeanne d’Arc.
Lorsque nous débouchâmes sur la place, tous nos clairons sonnant, drapeau déployé, j’aperçus devant la statue un groupe composé de généraux et d’officiers de toutes armes de leurs états-majors, qui nous attendaient et devant lesquels tous les régiments devaient défiler.
Une foule énorme avait envahi les rues et la place, et je vous assure que, ce jour-là, — soit parce qu’ils nous voyaient en force, soit parce que la grandeur du spectacle leur faisait oublier toute prudence, — les habitants de Vie ne restèrent pas muets.
On nous acclamait, on criait: «Vive la France! Vive l’armée française! » On nous jetait des fleurs. Les immigrés (on désigne ainsi les Allemands là-bas) devaient en crever de rage.
Ah! les braves gens! les braves Lorrains!
De nombreux corps de troupe défilèrent ce jour-là devant la statue de Jeanne d’Arc, toute la division de Toul, une division superbe et remarquablement entraînée, d’autres encore qui avaient belle allure. Cela dura des heures, et la foule ne se lassait pas d’applaudir, de crier: «Vive la France!» au passage des drapeaux, de jeter des fleurs aux soldats.
Notre lieutenant-colonel eut l’heureuse idée d’aller saluer, au cimetière de Vic, les tombes des soldats français tombés récemment en ce coin de terre lorraine et qui y dorment leur dernier sommeil: le dragon Henry (Nicolas), lâchement assassiné, et les trois chasseurs tués le 10 août à la ferme de Lagrange: Bonhomme, Franiatte et Lanne.
Sur les tombes nous déposâmes les fleurs dont nous avait comblés la population, puis notre chef de corps prononça une allocution touchante qui arracha des larmes à tous les assistants. Il termina en disant qu’il est doux de mourir pour son pays et qu’il n’y a pas plus belle mort que la mort du soldat.
Moins de trois semaines plus tard, ce superbe officier devait tomber à son tour en chargeant héroïquement à notre tête.
Devant son cadavre, je me rappelai les belles paroles qu’il avait prononcées au cimetière de Vie, et je me dis qu’une telle mort convenait à un tel soldat.
Après le défilé, la population nous entoura et nous fit fête. On nous distribuait à pleines mains du tabac, des cigares, des cigarettes; on nous embrassait, on nous entraînait de force vers les cafés de la ville pour nous offrir de la bière mousseuse et du vin gris de Lorraine.
A la joie de ces pauvres gens, on pouvait deviner ce qu’ils avaient souffert depuis quarante-quatre ans, traités en suspects dans leur propre pays, épiés par les immigrés qui les détestaient, obligés de surveiller leurs paroles, de cacher leurs sympathies, molestés souvent par une administration despotique et tracassière.
A présent il leur semblait que tout était fini, qu’ils s’éveillaient après un mauvais rêve, et ils se moquaient des regards de haine que leur lançaient les femmes allemandes restées au pays.
Naturellement on fouilla les maisons suspectes et l’on prit les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité ; mais nos troupes, — est-il besoin de le dire? ne commirent pas le moindre excès.
Guillaume II passant une revue.
En ce qui nous concernait, notre lieutenant-colonel nous félicita de notre tenue et de notre conduite pendant notre trop court séjour dans la bonne et hospitalière ville de Vie.
Toutes les maisons nous étaient ouvertes; on nous y choyait, on ne savait que faire pour nous être agréable, et nous nous sentions vraiment au milieu d’amis sincères.
Hélas! il fallut se quitter. Nous étions arrivés des premiers, nous partîmes également des premiers.
«Revenez bientôt! nous criait-on.
— Oui, bientôt!»
Nous avions tous le cœur un peu gros; mais nous nous consolions en pensant que nous allions nous battre pour libérer définitivement nos nouveaux amis; car, cette fois, c’était la bataille, et nos chefs ne nous l’avaient pas caché.
«Mes enfants, nous avait dit le lieutenant-colonel, nous allons avoir l’honneur de combattre pour la France contre un ennemi remarquablement préparé, supérieurement entraîné et certainement très brave, Je vous connais, je compte sur vous, je ne vous ferai donc pas de discours; entre nous c’est inutile; mais je tiens à vous dire ceci; Je sais que vous m’avez donné votre confiance, et je m’efforcerai de la mériter.»
Ces paroles nous touchèrent profondément, nous allèrent droit au cœur; et, certes, elles valaient tous les discours du monde.
Notre capitaine nous exprima à son tour ses sentiments à notre égard, puis il nous renouvela des recommandations qu’il nous avait faites souvent, nous donna de sages conseils.
«Surtout, nous dit-il, jamais d’affolement. N’oubliez pas que le calme est une des premières qualités militaires, sinon la première et la plus utile. Ne brûlez pas votre poudre aux moineaux, ne tirez qu’à bon escient et lorsque vous verrez l’ennemi à portée. Souvent je serai là pour vous guider; mais parfois, sans doute, vous vous trouverez livrés à vous-mêmes et vous aurez à faire preuve, non seulement de courage, — là-dessus je suis tranquille, — mais aussi d’initiative, d’énergie, d’audace. Alors, pas d’hésitation, sus à l’ennemi! c’est le mot d’ordre.»
D’une traite le régiment atteint Château-Salins, dont nos troupes, — notre artillerie surtout, — a chassé les Allemands, et nous traversons la ville au milieu d’une foule dont l’enthousiasme ne le cède en rien à celui des habitants de Vie. On chante la Marseillaise, des femmes pleurent de joie, des jeunes filles présentent des bouquets aux officiers, on crie: «Vive la France!»
Au loin, vers le nord, le canon tonne, et l’on entend par instants le crépitement de la fusillade. Certains corps sont évidemment en contact avec l’ennemi; mais pourtant l’on se rend compte qu’aucun combat sérieux n’est engagé.
Nous rencontrons des coloniaux, qui arrivent directement de Nancy, puis un régiment d’infanterie de cette ville, qui gagne Habondange et a déjà échangé des coups de fusil avec les Allemands. Le lieutenant-colonel nous apprend alors que nous allons prendre position à Marthil, petit village situé à l’ouest de Mohrange,
Pendant un certain temps nous longeons la forêt de Château-Salins, et nous traversons parfois des villages proprets où la population nous acclame.
En Alsace. — Tableau de Chaperon. (Phot. Vizzavona.)
A droite et à gauche, à droite surtout, on entend toujours, par moments, le crépitement de la fusillade et la voix grave du canon.
L’étape est longue et assez dure, le sac se fait de plus en plus lourd à mesure que se déroulent les kilomètres. On marche en silence, un peu impressionné à l’idée qu’on peut entrer dans la danse d’un instant à l’autre.
Pourtant nous n’apercevons rien, pas l’ombre d’un casque à pointe. J’entendis le lieutenant-colonel qui disait à un commandant:
«Ce calme ne me va guère; je trouve que les Allemands nous laissent avancer bien facilement. Pourvu que cela ne cache pas quelque traquenard!»
Notre chef de corps étant un homme prudent qui ne négligeait jamais une précaution, nous étions parfaitement éclairés, non seulement en avant, mais aussi sur les flancs.
Bien nous en prit; car, en vue de Marthil, nous essuyâmes des coups de feu sur la droite, qui nous tuèrent un sous-lieutenant et blessèrent quelques hommes.
Si nous n’avions pas été gardés de ce côté, l’ennemi eût peut-être prononcé une attaque sérieuse.
Notre commandant fit aussitôt déployer une compagnie en tirailleurs dans un champ, et, derrière cette compagnie, nous attendîmes messieurs les Boches de pied ferme.
Ils ne se montrèrent pas et se contentèrent de nous envoyer quelques obus et quelques balles, de sorte que nous pûmes occuper, sans difficultés sérieuses, les positions qui nous avaient été assignées à Marthil.
Cette journée du 19 août avait été horriblement fatigante.