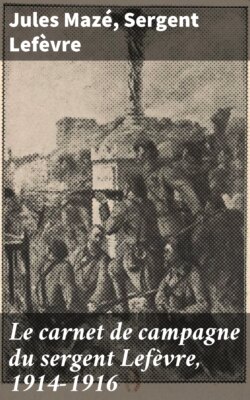Читать книгу Le carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916 - Jules Maze - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES COMBATS DE LA COTE 316
ОглавлениеA la droite de Crévic, en allant vers Dombasle, une jolie route blanche monte vers Haraucourt, traversant, entre les deux villages, un petit bois dit bois de la Forêt. Au-dessus de Crévic, à droite de la route d’Haraucourt, le terrain s’élève assez rapidement jusqu’au bois de Crévic, qui habille de son feuillage sombre un mamelon formant plateau. Entre ce bois et le bois d’Einville, sur le même plan, se dresse un second mamelon, non boisé, que coupe la route de Maixe à Drouville et qui est séparé de chacun des bois par un ravin peu profond et de faible largeur.
Ce mamelon, qui, entre ses deux frères hirsutes, produit l’effet d’un crâne chauve, porte, sur la carte d’état-major, la cote 316.
Chassés du village, les Allemands escaladèrent les hauteurs; mais ils ne purent prendre pied dans le bois de Crévic, qui était fortement occupé par nous et d’où partirent de nombreuses salves à leur adresse. Ils s’installèrent alors à la cote 316, c’est-à-dire sur le mamelon non boisé, le bois d’Einville abritant leurs réserves et leur matériel.
Des combats acharnés et meurtriers eurent lieu, jusqu’au 12 septembre, entre le bois et la cote 316, l’ennemi s’efforçant de nous déloger du bois, et nous de lui enlever la cote.
Malgré les rafales d’obus qui fauchaient les arbres, et aussi les hommes, le bois tint bon, et la cote finit par céder.
Mais on ne saura jamais quels trésors d’héroïsme furent dépensés en ce petit coin du paysage lorrain; jamais l’on ne pourra se faire une idée de l’horreur de ces charges, de ces corps à corps, qui comblèrent de cadavres le minuscule ravin, où les enfants du village viendront, l’été, cueillir des fleurs.
Quatre mille cadavres, dont deux mille cinq cents d’Allemands, furent relevés sur ce seul point, devant cette partie de la barrière sacrée.
Obusier français de 270.
Après avoir contribué de son mieux à nettoyer le village, ma compagnie rejoignit, derrière le bois, le gros du régiment, et nous dûmes creuser des tranchées. Pour la première fois je me vis transformé en terrassier. Je devais, par la suite, devenir très habile dans le métier, et je crois bien que peu de terrassiers de profession ont remué autant de terre que moi.
Grâce aux efforts et à la bonne volonté des braves poilus de mon escouade, nous fûmes bientôt installés d’une façon, sinon confortable, du moins très acceptable; et j’avais si bien choisi mon emplacement, que pas un de mes hommes ne fut blessé par obus au cours de la bataille.
Je n’entreprendrai pas de décrire tous les épisodes de cette bataille de quinze jours, car je ne pourrais que me répéter sans cesse, et mon récit deviendrait monotone. Je me bornerai à raconter plus loin les deux journées les plus chaudes.
Chaque jour on échangeait des balles avec les Boches d’en face, et lorsqu’ils réussissaient à descendre dans le ravin, malgré nos feux, une section ou une compagnie, selon l’effectif de l’assaillant, sortait de la tranchée et tombait dessus à la baïonnette.
On entendait des hurlements, des rugissements, des cris de douleur; puis nos hommes remontaient, — pas tous naturellement car on ne fait jamais de ces omelettes-là sans casser quelques œufs, — suant, soufflant, leurs effets déchirés, leurs fusils rouges de sang. Alors on établissait, autant que faire se pouvait, le compte des manquants, morts, blessés, disparus.
A la nuit, avec des précautions et des ruses d’apaches, nos brancardiers descendaient dans le ravin pour ramasser les blessés, dont souvent on avait entendu les plaintes et les appels pendant des heures.
Il fallait aux brancardiers beaucoup de courage et de sang-froid pour accomplir leur besogne ingrate et sans gloire; car au moindre bruit, — une pierre qui roulait sous les pieds, une branche qui craquait, un blessé qui gémissait, — les Allemands tiraient sans pitié.
Souvent ils étaient accompagnés par l’aumônier de la division, — un brave que rien ne troublait, — qui les aidait dans leur tâche, les encourageait, et réconfortait de son mieux nos blessés.
Plus d’un de nos brancardiers a payé son dévouement de sa vie.
Chaque jour, des corvées descendaient à Crévic, où l’on trouvait encore des provisions et parfois quelques douceurs; mais le voyage n’était pas sans danger, car les Allemands, furieux d’avoir été chassés du village, le bombardaient violemment.
Pendant dix-huit jours, le pauvre village reçut des projectiles de gros calibre, qui écrasèrent une partie des maisons épargnées par le feu.
L’adjoint au maire, le brave M. Royer, s’employait avec activité aux devoirs de sa charge, au ravitaillement de la petite population groupée autour du clocher, et plus d’une fois je l’ai rencontré dans les rues en plein bombardement, alors que tout le monde se réfugiait dans les caves. Il avait vu la mort de si près, qu’il semblait ne plus la craindre.
Le matin du 1er septembre, le canon tonnait plus fort que d’habitude; mais ce ne fut pas son tonnerre qui donna le signal du réveil, car il ne nous réveillait plus. Nous savions que la journée serait mouvementée, car les Français allaient attaquer un peu partout, et il fallait veiller au grain, notre rôle consistant surtout à harceler l’ennemi pour l’obliger à ne pas se dégarnir devant nous et à ne pas employer ailleurs les réserves qu’il devait avoir dans le bois d’Einville.
La matinée était splendide. Les oiseaux, — qui, sans doute comme nous, s’habituaient au bruit du canon, — chantaient dans les vergers voisins. La brume légère des matins d’automne s’évanouissait dans la profondeur de l’azur, sous les premières caresses du soleil.
Le combat, qui n’arrêtait pas, depuis le 25 août, à l’ouest de Lunéville, semblait gagner rapidement en violence, et ce fut une grande bataille qui se livra, ce jour-là, en avant de la forêt de Vitrimont, à Vitrimont, Frescati, autour du village d’Anthelupt, des fermes de Léomont et de Saint-Epvre; une bataille au cours de laquelle la division de Nancy, la division de fer, se couvrit d’une gloire immortelle. Si elle ne put, en cette mémorable journée de septembre, avoir raison d’un ennemi très supérieur en nombre et puissamment outillé, du moins elle l’ébranla fortement.
L’histoire, un jour, dira l’héroïsme splendide et jamais surpassé des soldats qui escaladèrent, sous un déluge de mitraille, les pentes de Léomont et de Saint-Epvre, de ce régiment qui, à Frescati, voyant tomber son colonel, l’intrépide Courtot de Cissey, tué net, et son lieutenant-colonel, blessé grièvement, fonça sur l’ennemi à la baïonnette pour les venger.
Mais revenons à Crévic, où notre action, pour être plus modeste, n’en fut pas moins, autant que j’en puis juger, des plus utiles.
Dès que nos braves cuistots nous ont apporté le liquide étrange prétentieusement décoré du nom de café, le lieutenant nous dit, en suçant son éternel cigare:
«Mes amis, on va embêter les kamarades d’en face.
— Ce sera pain bénit!» fait Bataille, dont la haine pour les Boches ne connaît plus de limites depuis qu’ils lui ont passé toute une colonie d’insectes dont les meilleures pommades n’arrivent pas à le débarrasser.
Nous commençons par quelques décharges, et bientôt notre artillerie entre en scène, arrosant copieusement leurs tranchées de la cote 316 et le bois d’Einville.
Le concert dure quelque temps, puis le lieutenant nous fait cesser le feu, l’artillerie continuant à tirer, regarde sa montre et nous dit:
«Il est 6 heures moins dix. A 6 heures, nous descendrons dans le ravin et nous dirons un mot à ces gaillards. Préparez-vous.»
L’annonce d’une expédition de cette nature produit toujours une certaine impression, même chez les plus braves. On sait, en effet, qu’on va au-devant de la mort, s’offrant à ses coups à découvert; on sait que tous ne reviendront pas, que bien des camarades manqueront à l’appel, morts, blessés, disparus.
L’ennemi, qui devine notre intention, nous canarde vigoureusement à son tour et nous envoie des bordées d’obus, espérant nous clouer dans nos trous.
Y réussira-t-il?
Notre lieutenant le craint, sans doute, et je lui vois faire une chose splendide, inouïe.
Tranquillement, il grimpe sur le talus de la tranchée, et là, en plein soleil, sous la tempête de mitraille, se promène de long en large, le cigare à la bouche, sans faire un pas plus vite que l’autre.
C’est tellement beau, que nous ne respirons plus, puis nous applaudissons et nous supplions notre officier de rentrer.
«Pas la peine, répond-il en regardant sa montre, il n’y a plus qu’une minute.»
Alors, transportés, électrisés par un tel exemple, sans même attendre le moment fixé, nous bondissons à notre tour, et presque aussitôt, sur un geste du lieutenant, nous dégringolons dans le ravin, tête baissée, baïonnettes en avant. Très éprouvés par des feux de mitrailleuses, qui pourtant ne nous arrêtent pas, nous franchissons le fond de verdure et atteignons la tranchée adverse.
Un grand diable qui n’a pas mauvaise mine dirige sa baïonnette vers ma poitrine. Sans redresser mon fusil, j’appuie sur la détente, et il tombe. Je me défends encore contre un tout jeune officier, qui tient absolument à essayer sur moi son revolver tout neuf, et que je m’efforce d’attraper avec ma baïonnette. Je me demandais lequel de nous deux aurait le dessus lorsqu’une balle, venant je ne sais d’où, le frappa en pleine poitrine.
C’est tout ce que j’ai vu de ce corps à corps, dont je me suis tiré sans une égratignure.
Au moment où le jeune officier boche tombait, l’ordre nous fut donné de rentrer chez nous, et j’appris ensuite que nous avions couru le risque d’être cernés et pris comme des rats dans la tranchée allemande.
Du reste, notre but était atteint: nous avions tenu l’ennemi en haleine.
La même scène se répéta pendant toute la journée; mais ma section n’eut plus à marcher, d’autres effectuant les attaques jugées nécessaires.
Nous avions eu, au cours de notre petite opération, huit hommes tués, une quinzaine de blessés et six disparus.
Notre lieutenant était sorti de la bagarre avec une balafre profonde à la joue droite et une large déchirure du cuir chevelu; mais il refusa formellement de nous quitter, même pour aller au poste de secours.
Quelques jours plus tard, les Allemands nous attaquèrent à leur tour; et, sous la violence extrême de leurs assauts, sous le poids de leurs masses compactes, sous l’orage formidable de leur artillerie lourde, la barrière céda un moment. Mais s’ils nous obligèrent à reculer, ils ne purent nous briser, et, dans un élan furieux, nous reprîmes à la baïonnette tout le terrain perdu, infligeant à nos ennemis des pertes terribles.
La toilette au bord du ruisseau.
Ils nous avaient refoulés vers le Rambêtant.
C’était un recul assez sérieux; mais dame! lorsqu’on fléchit sous une poussée pareille, il n’est pas facile de s’arrêter.
Nous nous arrêtâmes pourtant, et, cramponnés au sol, nous fîmes tête à la horde qui nous pressait.
Des ordres furent alors donnés. Les hommes de liaison coururent dans toutes les directions, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre qu’on allait charger.
C’était ce que nous attendions tous.
«Vaincre ou mourir!» cria simplement notre chef de corps.
Et il vit bien qu’il n’était pas besoin d’en dire plus long.
Debout sous la mitraille, superbes, les clairons sonnèrent la charge à pleins poumons.
Ce fut une ruée splendide, fantastique, quelque chose de si beau et de si grand, que l’imagination la plus ardente ne saurait le concevoir.
Nous abordâmes l’ennemi en chantant la Marseillaise, tous nos clairons continuant à sonner.
Sous le choc, la masse allemande chancela, puis elle se redressa, chancela de nouveau, et enfin perdit pied, commençant un mouvement de recul.
Ce fut lent d’abord; mais nous frappions à coups redoublés, nous étions ivres de sang et de carnage, la vie ne comptait plus pour nous, ni la nôtre, ni celle des autres.
Ces Allemands étaient braves, — ceux qui disent le contraire ne les ont jamais vus au combat, — et ils se défendaient avec acharnement, ne s’occupant pas plus que nous de leurs pertes. Pourtant leur mouvement de recul s’accentua bientôt. Nous les tenions.
Le soir, nous avions regagné tout le terrain perdu et nous réoccupions nos positions.
Au plus fort de la mêlée, en chargeant à notre tête, notre lieutenant-colonel était tombé héroïquement.
Il fut pleuré par tout le régiment. Nous avions en lui un chef excellent, aimant ses hommes par-dessus tout et s’intéressant à leurs moindres besoins, mais sachant se faire obéir et ne badinant pas avec la discipline.
Les chefs de cette trempe sont généralement adorés du soldat, qui aime, avant tout, à se sentir commandé.
Pendant plusieurs nuits, après la rude journée, nous ne pûmes trouver le sommeil, ou tout au moins un sommeil réparateur. Nous avions subi une excitation telle, supporté une telle tension nerveuse, que l’équilibre se rétablissait difficilement et lentement.
Pendant quelques jours, les Allemands se montrèrent relativement calmes; et ma foi! nous n’étions pas fâchés, je l’avoue, de pouvoir souffler un peu.
Nous les supposions fatigués, et sans doute il y avait de cela; mais à la fatigue s’ajoutait certainement, — nous ne le savions pas alors, — l’inquiétude que causait à leur commandemeut la bataille de la Marne.
Lorsqu’ils furent convaincus que l’échec de leurs armées du Nord sur la Marne était définitif, c’est-à-dire le 12 septembre, ils déménagèrent sans tambour ni trompette pour se rapprocher de leur frontière.
Il était temps, car nous les serrions de près, et leur situation en Lorraine et dans les Vosges devenait difficile et dangereuse, par suite du recul de leurs armées battues sur la Marne et de celui de l’armée du kronprinz dans la région de Verdun. Leur ligne se trouvait, en effet, assez en l’air et eût pu être prise à revers, s’ils avaient essayé de la maintenir aussi loin de la frontière.
Ce fut, pour la région, la fin d’un cauchemar; et je pus, quelques jours plus tard, me rendre compte de la joie des habitants de Lunéville, qui avaient beaucoup souffert pendant l’occupation allemande.