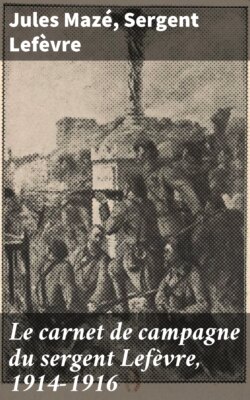Читать книгу Le carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916 - Jules Maze - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CANON!
ОглавлениеLe lendemain, tout le monde était debout bien avant l’heure du réveil. Nous nous imaginions naïvement que nous allions recevoir l’ordre de partir immédiatement et de foncer sans délai sur les Allemands d’en face, dont nous nous promettions de faire une marmelade.
Le réveil sonna, et aucun ordre ne vint, sinon l’annonce de théories diverses.
Ce fut de la stupeur: la guerre était déclarée, et l’on ne marchait pas!
Le jeune sous-lieutenant nous expliqua, en sirotant un quart de café, que la guerre était chose très compliquée et que nous jouions simplement le rôle des pions sur un échiquier.
«Alors, fit Bataille, voilà des pions qui ont plus de chance que nous!»
Et il montrait une route lointaine où l’on voyait défiler de l’artillerie dans un poudroiement de soleil, tandis qu’un mamelon la dominant se trouvait transformé en fourmilière par le passage d’une nombreuse infanterie.
Avec une inlassable patience, le sous-lieutenant essaya de nous inculquer de vagues notions de tactique, de nous faire comprendre qu’on ne lance pas ainsi une troupe à l’aventure, qu’il faut assurer la sécurité de ses derrières et de ses flancs, son ravitaillement en vivres et en munitions, que son action, pour ne pas demeurer vaine, doit être combinée avec celles d’autres troupes et d’autres armes.
Enfin notre tour arriva quelques jours plus tard: on nous poussa sur l’échiquier humain, vers la frontière, vers la terre promise.
Tout le monde était joyeux, les officiers rayonnaient, et le lieutenant-colonel qui nous commandait, un ancien soldat d’Afrique, ne tenait plus en place.
Patrouille de spahis.
Par un temps splendide et chaud, nous nous acheminâmes vers Athienville petit village paisible entouré de mamelons verdoyants, puis vers Arracourt, modeste chef-lieu de canton dont les maisons blanches aux volets verts bordaient la large route qui traverse la frontière à moins de trois kilomètres de là et file, en terre annexée, sur Moyenvic.
Dans cette jolie campagne, éclairée par le radieux sourire du soleil, nos yeux ne rencontraient que des images de paix et de bonheur.
Devant les maisons, coquettes et bien entretenues, des vieux fumaient leur pipe, des ménagères tricotaient, des enfants jouaient.
On nous saluait au passage en nous criant: «Bonne chance!» Les enfants nous faisaient un bout de conduite en s’efforçant de marcher au pas.
Ces tableaux charmants nous rappelaient les grandes manœuvres par beau temps, et je n’ai jamais perdu le souvenir d’une jeune et fraîche paysanne qui lavait tranquillement son linge devant la porte d’une ferme et me tendit un bol de lait au passage.
Pourtant nous sentions que, derrière ce calme, l’orage se préparait.
Nous savions que nos patrouilles opéraient déjà de nombreuses reconnaissances au delà de la frontière, et un paysan nous conta le fait suivant, qui nous arracha des cris d’indignation et de rage.
Le 6 août, on venait prévenir le président de la Croix-Rouge de Vic-sur-Seille, ville du territoire annexé, qu’un dragon français, blessé par des uhlans au cours d’une patrouille, était resté sur le terrain, dans la plaine, aux portes de la ville.
Le président fit aussitôt appeler des jeunes gens de sa société, les pria de prendre une civière, et le groupe se dirigea vers l’endroit où gisait le blessé ; mais un soldat allemand du régiment n° 138 avait eu connaissance du renseignement donné au président de la Croix-Rouge. Enfourchant une bicyclette, ce misérable se rendit auprès du blessé français, et, froidement, à dix mètres, le tua de trois coups de fusil.
Le malheureux cavalier français, première victime de la guerre dans cette région, repose au cimetière de Vie. Il se nommait Henry (Nicolas), était originaire de Reims et appartenait au 8e régiment de dragons.
«Retiens bien cette histoire, l’ancien, me dit Bataille, et quand nous aurons des Allemands devant nous, pense au dragon de Vic-sur-Seille.»
On nous arrêta tout près de la frontière, dans les environs du village de Juvrecourt, au-dessus d’Arracourt. Le moment n’était pas encore venu pour nous de passer chez l’ennemi; mais nous étions désormais sans impatience, car nous savions que la danse allait commencer et que nous serions appelés à y jouer notre rôle.
«Ouvrons l’œil, et le bon! fit notre jeune caporal. Ça sent le Prussien par ici!»
Sur notre gauche, dans la forêt de Bezange, qui vient mourir là, nous apercevions d’autres troupes. Devant nous, des batteries d’artillerie étaient en position, et l’on en voyait passer d’autres qui devaient aller s’installer au delà de la frontière.
Au cours de la nuit, nos sentinelles furent tenues en éveil par des coups de feu isolés qui partaient on ne savait d’où. Nous les entendîmes aussi, et l’on ne dormit guère. C’étaient les premiers, et l’on a beau dire, ça fait toujours quelque chose.
Notre sous-lieutenant effectua une reconnaissance volontaire sur la ligne des sentinelles et même au delà. Il ne découvrit rien de suspect, mais revint enchanté : il avait franchi la frontière.
Le lendemain matin, 14 août, — une date que je n’oublierai jamais, — nous fûmes arrachés à notre sommeil fiévreux par une détonation formidable.
Tirailleurs marocains.
Nous nous regardâmes ahuris, incapables de prononcer une parole, et je remarquai que mes camarades étaient très pâles.
Enfin l’un d’eux fit d’une voix blanche:
«Le canon!»
Notre caporal, qui se ressaisit le premier, exécuta une cabriole joyeuse et cria:
«Bravo! les artilleurs ouvrent le bal!»
Il m’est difficile de décrire ce que j’éprouvais. Était-ce de la peur? Je ne sais. Je me sentais la tête horriblement vide, et un léger tremblement nerveux, que je m’efforçais de vaincre, me secouait par instants.
Je devais être très pâle, moi aussi, car Bataille me dit, en me frappant sur l’épaule:
«Baste! tu verras, on s’y fait très bien.»
Je pus, du reste, pratiquer ce jour-là un entraînement sérieux; car ma compagnie fut désignée comme soutien d’une batterie qui opérait à la lisière du bois, sur la frontière même, au lieu dit Champ-Vautrain. D’autres batteries tiraient aussi, sur notre droite, au-dessus de Juvrecourt.
Bientôt les batteries allemandes répondirent avec rage, et ce fut, pendant des heures, un monstrueux concert, une musique infernale, qui vous martelait les tempes, vous tordait les nerfs, vous secouait tout entier.
Un artilleur m’expliqua que nous arrosions les batteries et les tranchées allemandes du secteur limité par Juvelize, Blanche-Église et la ferme de Bourrache.
Ils étaient merveilleux, les artilleurs, et en somme c’était leur début, à eux aussi; car, s’ils avaient souvent entendu le canon, ils n’avaient jamais reçu d’obus.
Ils en recevaient, je vous assure, et ces maudits engins éclataient avec fracas, projetant, dans un nuage de fumée noire, une pluie de morceaux d’acier dont le plus petit pouvait tuer son homme, de pierres et de terre.
Les artilleurs procédaient avec calme à leurs intéressantes manœuvres, paraissant ne rien voir et ne rien entendre. Fort heureusement les Allemands ne tiraient pas très juste, de sorte qu’il y eut seulement quelques blessés parmi les servants, et encore les blessures étaient légères.
Pour nous, nous n’eûmes pas à souffrir, grâce à la bonne idée qu’avait eue notre capitaine de nous établir sur la pente d’un mamelon. L’obus, en effet, passait au-dessus de nos têtes lorsque le coup était trop long et tombait devant le mamelon lorsqu’il était trop court.
Pourtant nous eûmes un blessé, — oh! rien de bien grave: un mollet labouré par un morceau d’acier gros comme une fève; mais enfin le sang coula. C’était une blessure, une vraie blessure. Chacun voulut voir notre premier blessé, lui serrer la main, lui demander ses impressions. Lui, très fier, montrait sa jambe un peu tuméfiée et expliquait qu’il avait senti un choc, comme un coup de bâton, mais que cela ne faisait aucun mal. A l’entendre, c’était presque un plaisir de recevoir un éclat d’obus quelque part. Et, de fait, le brave garçon n’eût pas échangé contre les galons de sergent la gloire d’être le premier blessé du régiment.
Le 15 et le 16 août, le duel au canon continua, de plus en plus rageur, de plus en plus violent, et nous n’entendions pas sans un certain émoi, causé par le manque d’habitude, le tonnerre de l’artillerie lourde allemande, qui, du mont Saint-Jean, au-dessus de Vie, envoyait ses énormes projectiles dans la direction de la ferme Haute-Burthecourt, située en avant de la forêt de Bezange, où de nombreuses troupes se rassemblaient.
Dans la matinée du 16, au plus fort de l’action, nous pûmes jouir d’un spectacle merveilleux, encore nouveau pour nous, qui nous arracha des cris d’admiration.
Sous l’azur, dans la coulée d’or du soleil, un avion français, un biplan, qui évoluait avec une aisance parfaite, apparut du côté de Nancy, se dirigea d’abord vers nous, puis, faisant un crochet, fila comme une flèche vers les positions allemandes, qu’il survola bientôt.
Des centaines d’obus, des milliers de balles, montèrent vers l’oiseau de France, que nous contemplions, haletants, le cœur serré par la crainte de le voir s’abattre, blessé à mort, chez nos ennemis; mais il continua d’évoluer avec la même aisance, laissant à chaque instant tomber une fusée dont nous apercevions très bien la traînée blanche, qui ondulait sous le souffle d’une brise légère; puis, ayant accompli sa mission, il prit de la hauteur et disparut dans les profondeurs de l’azur.
Alors notre artillerie augmenta l’intensité de son feu, qui devint vraiment effroyable, et bientôt les canons allemands cessèrent de rugir.
Nous avons appris le lendemain, à Vie, que la plupart des pièces avaient été démolies par nos obus et les servants tués ou blessés.
L’oiseau de France avait superbement joué son rôle.