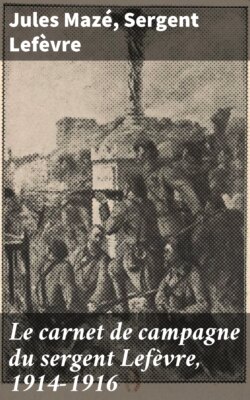Читать книгу Le carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916 - Jules Maze - Страница 5
DEVANT LA FRONTIÈRE
ОглавлениеUn beau matin, dans la deuxième quinzaine de juillet 1914, un gendarme imposant et grave me remit un ordre de l’autorité militaire m’invitant à rejoindre, immédiatement et sans délai, à Toul, le régiment d’infanterie que j’avais quitté l’année précédente, à ma libération, pour occuper un modeste emploi à Paris.
Cela, je l’avoue, me donna un petit coup au cœur..
Pourtant l’on espérait encore que la guerre pourrait être évitée, et l’on se disait qu’en tout cas, si cet espoir se trouvait déçu, le conflit serait certainement de courte durée.
«Veinard! faisaient mes amis, tu vas voir du pays aux frais de l’État. Ce sera une promenade, une simple promenade.»
Lorsque je quittai la capitale, l’on s’y sentait oppressé comme à l’approche d’un violent orage, l’on y vivait dans une sorte d’angoisse pénible qu’entretenaient les nombreuses éditions des journaux. Je tombai, à Toul, en plein branle-bas de combat.
Chose étrange, le contraste me fit du bien.
Là-bas, dans l’atmosphère enfiévrée de la grande ville, tous les regards allaient vers les diplomates, qui jouaient leur dernière carte. Ici, ils se portaient vers la frontière, vers le pays annexé, qui apparaissait à tous comme une sorte de terre promise.
Là-bas, c’était l’attente. Ici, c’était déjà l’action.
J’eus beaucoup de peine à gagner la caserne; car les rues étroites de la vieille ville lorraine présentaient un extraordinaire encombrement. Chacune de ces rues était devenue comme le lit d’un fleuve étrange où roulaient, pêle-mêle, au milieu d’une foule bruyante, les véhicules les plus divers, depuis la charrette branlante chargée de vivres pour la troupe jusqu’à l’automobile de luxe où se distinguait la silhouette d’un général.
Lorsque, enfin, je pus pénétrer dans la cour du quartier, il me sembla que tous les fleuves de la ville y déversaient leurs véhicules hétéroclites et une partie de leurs vagues humaines. Jamais je n’avais vu pareil remue-ménage, jamais je n’avais entendu pareils cris.
Je m’étais arrêté, étourdi, ahuri, ne sachant de quel côté diriger mes pas, lorsque je reçus dans le dos une tape vigoureuse, en même temps qu’une voix connue disait:
«Ah! mon vieux, je suis content de te revoir!»
Je me retournai vivement, tout heureux de ne plus me sentir isolé dans la cohue, et me trouvai en face de mon ami Bataille, mon ancien caporal devenu sergent.
Nous nous embrassâmes cordialement; puis Bataille, qui aime la plaisanterie, s’écria:
«Tu sais, on n’attendait plus que toi pour partir.
— Comment, pour partir!
— Dame! te figures-tu qu’on t’a envoyé ici pour cultiver le potager de la compagnie?
— Non, mais...
— Eh! mon bon, nous sommes les gardiens de la frontière, nous autres, nous sommes sa couverture, tu le sais bien. Alors nous allons la couvrir, c’est simple, et nous laisserons nos casernements à ceux de l’arrière.»
Mon brave sergent désignait ainsi, non sans une nuance de dédain assez comique en la circonstance, les corps de troupe qui, plus éloignés de la frontière, se mobilisent moins rapidement, dont nous devions protéger la mobilisation, et qui nous rejoindraient un peu plus tard.
«La guerre est donc déclarée? demandai-je, assez ému.
— Non, elle ne l’est pas encore, et vraiment je ne sais ce qu’ils font dans ton Paris; mais nous espérons tous qu’elle le sera bientôt. Alors, en attendant le lever du rideau, on va se placer aux premières loges.
«Allons! dépêche-toi de t’occuper de ton fourniment; et tu sais, tu n’as pas besoin de te casser la tête pour le reste. Je t’ai fait placer dans ma section, je suis ton chef, et tu n’auras qu’à te rallier à mon panache. J’espère que tu feras honneur à la compagnie.
Régiment d’infanterie se rendant à la gare.
«Là-dessus, rompez, et au trot! Ce n’est pas l’instant de jaboter avec les camarades.»
Pour le moment, les gradés ne savaient où donner de la tête; ils s’agitaient comme des diables dans l’eau bénite, harcelés par leurs hommes, qui avaient mille choses à demander, happés au passage par les nouveaux venus comme moi, qui ne savaient à quel saint se vouer, attrapés vigoureusement par les officiers à propos de tout et de rien.
A cette heure, je me félicitais d’avoir été assez sage, au cours de mon service militaire, pour ne pas désirer de galons; et, au milieu du formidable remue-ménage, il me semblait très doux d’être simple soldat, de n’avoir qu’à suivre le troupeau, qu’à obéir.
L’enthousiasme délirant qui gonflait les cœurs et enfiévrait les cerveaux ne contribuait pas peu à augmenter une agitation assez naturelle en la circonstance. Pourtant, je ne tardai pas à m’apercevoir qu’il y avait de la méthode dans cette agitation, et qu’une volonté ferme canalisait vers le but à atteindré des efforts en apparence assez incohérents.
Le régiment, en effet, se trouva prêt en un rien de temps, et je vous assure que je me sentis fier d’appartenir à cette troupe d’élite lorsqu’elle s’aligna dans la cour, devant son drapeau déployé, et que le clair soleil de Lorraine fit scintiller l’acier de ses milliers de baïonnettes.
A ce moment-là, nous sentîmes passer en nous un grand frisson d’héroïsme, et le salut au drapeau fut comme un acte de foi et d’espérance où nous mîmes toute notre âme, tout notre cœur.
En cette minute émouvante et solennelle, que je ne voudrais pas ne pas avoir vécu, nous jurâmes tous de mourir pour la France.
Beaucoup d’entre nous ont déjà tenu leur serment, et tous ceux que j’ai eu la douleur d’assister à l’instant suprême se montrèrent aussi héroïques devant la mort qu’ils l’avaient été devant l’ennemi.
Il faisait chaud, et le sac me sembla bientôt terriblement lourd. Où allions-nous? Je n’en savais rien et ne tenais pas à le savoir. Mes voisins avaient entonné une chanson de route; mais c’est à peine si je les entendais.
Arraché brusquement à une existence sédentaire et plongé dans un milieu plein d’agitation et de fièvre, je payais d’un peu de dépression nerveuse le manque de transition entre deux états si différents.
Malgré moi, je pensais au village natal où vivait encore ma vieille mère, aux bons amis que j’avais laissés derrière moi, à mon bureau tranquille où la besogne quotidienne était douce, à la chambre claire et gaie que j’avais aménagée avec amour et d’où j’apercevais la verdure de Meudon.
Et tout cela me paraissait loin, très loin, comme perdu dans une brume de rêve.
Bref, pour employer une expression qui n’allait pas tarder à entrer, en compagnie de beaucoup d’autres, dans le vocabulaire militaire, j’avais le cafard.
Cela n’était pas surprenant, et nombre de camarades qui marchaient en silence, courbés sous le poids du sac, traversaient probablement la même crise.
«Alors, l’ancien, ça ne va pas, la santé ? demanda mon caporal, un jeune engagé plein d’ardeur, qui devait devenir pour moi le meilleur des amis.
— Oh! si, très bien.
— On ne le dirait guère; tu as l’air de porter le diable en terre.
— Je suis seulement un peu fatigué : le voyage, le branle-bas de la caserne, l’émotion du départ, tout cela coup sur coup...
— Eh! oui, mon vieux, dans les corps de couverture, tout se fait à la vapeur: aussitôt pris, aussitôt pendu. Mais aussi songe que nous serons les premiers à canarder les casques à pointe. Ceux de l’arrière vont en crever de jalousie. Allons, du cran! le ciel est clair, la route est large, la vie est belle!»
La revue des troupes avant le départ pour la frontière.
Brave gamin!
J’avoue que, pour le moment, je ne trouvais pas la vie extraordinairement séduisante.
Il faut bien dire la vérité, se montrer tel que l’on est. Que celui qui, au début, parmi les réservistes, n’a pas un peu payé le tribut au cafard me jette la première pierre.
Chez moi, du reste, la crise fut de courte durée. Une bonne nuit passée dans la paille odorante d’une grange me remit un peu l’esprit en place. La bonne humeur de Bataille, mon sergent, et de mon jeune caporal firent le reste. Au bout de deux jours, la cure était complète, l’adaptation parfaite, et il me semblait que je n’avais jamais quitté le régiment.
Nous menions l’existence d’une troupe aux manœuvres, vagabondant, pour ainsi dire, dans la superbe campagne lorraine, traversant des villages où l’on nous faisait fête, rencontrant d’autres troupes que l’on saluait par des cris joyeux.
Peu à peu l’insouciance nous gagnait. Je parle des réservistes, des anciens; car ceux de l’active avaient quitté la caserne comme pour une partie de plaisir, et la seule chose qui troublât leur bonheur, c’était la crainte que les choses ne finissent par s’arranger, la crainte de rentrer à la caserne sans en avoir décousu avec les casques à pointe.
Le soir, dès l’arrivée au cantonnement, on entourait les officiers.
«Eh bien, mon capitaine, c’est-y pour aujourd’hui?
— Pas encore, les enfants; on cause toujours.»
Mon caporal, le plus joyeux des mortels, en devenait neurasthénique, le sergent Bataille était menacé de jaunisse.
Je crois que, s’ils avaient tenu les bavards qui s’obstinaient à parler quand les cartouches tintaient si joyeusement dans les gibernes, quand la baïonnette était si bien aiguisée, ces messieurs eussent passé un vilain quart d’heure.
Je fis vraiment connaissance avec le régiment dans un cantonnement où l’on nous arrêta pendant plusieurs jours, entre la forêt de Champenoux, qui allait devenir célèbre, le bois Morel et la forêt de Bezange.
Nous ne nous doutions guère qu’un drame formidable se jouerait bientôt dans ce site vraiment enchanteur, que les jolis villages où nous allions aux provisions flamberaient bientôt comme des torches, que les fermes où l’on nous accueillait si cordialement s’effondreraient sous les obus, que des ruisseaux de sang arroseraient les vallons délicieux où nous faisions l’exercice.
Cependant nous ne tardâmes pas à comprendre que les diplomates devaient perdre un peu l’espoir d’arranger les choses. Mon caporal retrouva sa gaieté endiablée, le sergent Bataille ses couleurs et sa bonne humeur.
Les officiers, en effet, prenaient un air grave, nous faisaient mille recommandations, nous donnaient mille conseils, — «des conseils qui sentaient la poudre,» comme disait Bataille. Le nombre des sentinelles avait été augmenté, et leur consigne était devenue des plus sévères.
A la compagnie, nous avions des officiers charmants. Notre capitaine, jeune et plein d’ardeur, s’occupait sans cesse de nos besoins et de notre bien-être. Avant de penser à lui, il pensait à ses hommes. Il nous connaissait tous et avait pour chacun un mot aimable lorsqu’on se trouvait en sa présence; il aimait ses hommes, et ses hommes l’adoraient.
«Avec un chef comme lui, disait mon caporal, on irait au bout du monde!»
Notre lieutenant était également un officier d’élite, mais d’allure plus réservée. Il fallait apprendre à le connaître, et alors on s’apercevait que son apparente froideur était faite tout simplement d’un peu de timidité et de beaucoup de calme.
Je ne devais pas tarder à le voir, debout sous la mitraille et les balles, alors que nous étions aplatis contre le sol, allumer tranquillement un cigare et le fumer aussi posément qu’à la terrasse d’un café. Des gens m’ont dit: «C’est idiot de s’exposer ainsi!» Possible; mais je vous assure que ça vous remonte fameusement le troupier, que ça donne du cœur aux plus froussards, et qu’un officier dont les hommes ont admiré l’héroïsme tranquille peut tout leur demander.
J’ai entendu exposer un jour une théorie originale, mais qui m’a paru fort juste.
Un lieutenant-colonel qui avait été grièvement blessé en enlevant Vauquois à la tête d’un régiment de la 10e division se remettait assez péniblement, lorsqu’il apprit que son successeur venait également d’être blessé. Aussitôt il demanda qu’on lui rendît le commandement de son ancien régiment.
Comme on le félicitait, tout en lui faisant remarquer qu’il aurait dû attendre encore avant de rentrer dans l’action, il répondit:
«Ne me félicitez pas, car ce que vous prenez pour de l’héroïsme n’est que de l’habileté. On me connaît dans ce régiment, que j’ai commandé en dix combats; je n’aurai donc pas à prouver à mes hommes que je suis brave. Si j’attends, au contraire, j’aurai un régiment où l’on ne me connaîtra pas, où je serai un «bleu», malgré ma croix de guerre à trois palmes, et où je devrai faire mes preuves, ce qui pourrait me coûter cher.»
Et ce colonel avait raison: il faut qu’un chef digne de ce nom se fasse connaître de ses soldats, il faut que ceux-ci disent de lui: «C’est un brave!»
Nous avions aussi, à la compagnie, un tout jeune sous-lieutenant, un enfant presque, à qui la menace de guerre avait ouvert avant l’heure les portes de l’école Saint-Cyr.
Bien que très jeune, notre Cyrard connaissait son métier et avait le feu saoré, un feu dévorant. Tout de suite il nous avait conquis par sa bonne grâce, par sa façon charmante de nous traiter en amis plus âgés. Le pauvre petit n’est plus; il est tombé à notre tête, victime de sa folle bravoure. Nous l’avons tous pleuré, et son souvenir vivra toujours en mon cœur.
De plus en plus nous avions l’impression d’être en guerre, bien qu’on attendît toujours, — et avec quelle impatience! — la déclaration officielle. D’étranges nouvelles circulaient dans les villages et faisaient le tour du cantonnement, nouvelles souvent fausses ou certainement très exagérées. Tantôt il s’agissait d’une reconnaissance allemande qui avait violé la frontière et emmené, pieds et poings liés, toute la population d’un village; tantôt c’étaient des uhlans qui étaient apparus dans les faubourgs de Nancy.
Nous ne tenions plus en place, le fusil nous brûlait les doigts, et nous nous demandions pourquoi l’on nous tenait si loin de cette frontière dont nous étions les gardiens désignés.
Le capitaine, qui comprenait notre état d’esprit, finit par nous expliquer que le Gouvernement, pour éviter des conflits avant la déclaration, avait prescrit de ne pas pousser les troupes jusqu’à la frontière, de les en tenir éloignées d’une dizaine de kilomètres.
Il est certain que les fusils seraient partis seuls.
«Encore un peu de patience, mes enfants, nous dit le capitaine. Je crois bien que ce ne sera plus très long!»
Des bravos prolongés accueillirent ces dernières paroles.
De partout des troupes arrivaient. La 11e division s’alignait sur notre gauche, couvrant Nancy. On signalait, sur notre droite, des chasseurs à pied et des dragons de Lunéville. Derrière les bois, il y avait comme un grouillement d’hommes et de chevaux, comme un fourmillement de canons, de fusils. La nuit, lorsqu’on était de garde, on entendait le roulement sourd des convois, pareil à un tonnerre lointain qui n’aurait pas cessé.
De plus en plus ça sentait la guerre.
A présent, du reste, les Allemands ne se gênaient plus; nous savions, par les habitants des villages, qu’ils poussaient sur notre territoire des reconnaissances rapides.
Nous nous sentions devenir enragés.
Enfin, le 3 août, la grande nouvelle nous parvint: la guerre était déclarée.
Qui nous l’annonça? Je ne sais, mais on la connut partout à la fois. Et ce fut une joie folle. On criait, on dansait, on s’embrassait. A ma section, nous vîmes apparaître du champagne offert par le jeune sous-lieutenant. Où avait-il pu dénicher les bouteilles? Le capitaine et le lieutenant trinquèrent avec nous, et l’on but au succès de nos armes, à la gloire de la France.