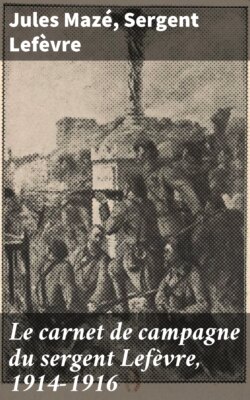Читать книгу Le carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-1916 - Jules Maze - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA BATAILLE DE MOHRANCE
ОглавлениеJe n’ai pas, bien entendu, la prétention de décrire la bataille de Mohrange, qui, je l’ai su par la suite, se composa d’une série de rencontres entre les troupes françaises avançant de toutes parts entre Delme et Sarrebourg, et les Allemands qui attendaient le choc.
Je ne puis raconter que ce que j’ai vu, ce que voit un combattant, c’est-à-dire ce qui se passe autour de lui, dans sa compagnie.
Mohrange a donné son nom à la bataille parce que là se trouvait la plus importante, la plus forte position ennemie.
En réalité, notre lieutenant-colonel avait eu raison de se méfier: nous tombions dans un traquenard.
De la frontière à Mohrange, nous avions eu devant nous un simple rideau de troupes, et ces troupes ne devaient pas avoir pour mission de nous arrêter, mais, au contraire, nous attirer à leur suite jusqu’à une ligne de défense formidablement préparée dès le temps de paix et renforcée encore pendant qu’on nous tenait à distance, en attendant la déclaration de guerre.
A Mohrange, notamment, pour ne parler que de ce que j’ai pu voir, nos ennemis avaient construit des tranchées en ciment armé où ils avaient entassé des hommes, des mitrailleuses et des obusiers, et le terrain environnant se trouvait sous le feu d’une puissante artillerie.
Ma compagnie avait été favorisée sous le rapport du cantonnement: nous occupions une ferme à la lisière du village, et je pus, le 19, dormir dans une grange bien close, après avoir dîné d’une omelette délicieuse préparée par la fermière.
La brave femme avait très peur et tremblait non seulement pour elle-même, mais aussi pour le troupeau qui constituait son seul avoir.
Je la plaignais de tout cœur, elle et les autres, les pauvres gens de la frontière qui allaient se trouver en pleine tourmente, qui allaient, une fois de plus, supporter toutes les misères, toutes les calamités qu’entraîne forcément la guerre.
Le Kaiser, le Kronprinz et le prince Oscar.
Elle nous raconta, en pleurant, que son fils unique était mobilisé dans l’armée allemande et se trouvait actuellement dans un dépôt d’instruction.
La situation était vraiment cruelle pour cette Lorraine, restée française de cœur.
Le 20 août, réveil à 4 heures, rassemblement du bataillon, puis départ.
Le canon tonne violemment, surtout vers la droite.
«Ça doit chauffer du côté de Dieuze,» me dit le sous-lieutenant, qui a sa carte à la main.
Dieuze? Le nom ne me dit pas grand’chose. Nous avons rencontré des troupes du 15e corps qui montaient par là.
Je n’ai, du reste, pas le temps de réfléchir; car, dès notre sortie du village, les obus se mettent à dégringoler autour de nous, et le commandant fait prendre en hâte les formations de combat.
Bataille, mon sergent, m’apprend que nous avons deux hommes tués.
J’ai la tête vide, les tempes serrées comme dans un étau, la gorge sèche. Mes oreilles bourdonnent. Il me semble que mon cœur a cessé de battre.
La mort est là ; elle nous enveloppe, nous harcèle, joue avec nous comme le chat avec la souris.
J’ai peur, c’est incontestable. Dame! je n’eus jamais la prétention d’être un héros.
Parviendrai-je à dominer cette peur?
Boum! un obus éclate tout près de moi et me couvre de terre. Un homme tombe en poussant des cris de douleur.
Le lieutenant se précipite et s’aperçoit sans doute que nous avons besoin d’être encouragés.
«Ce n’est rien, les enfants; on s’y habitue très bien, vous verrez. Allons! en avant, et du cœur au ventre!»
Comme toujours, il est très calme; certainement il n’a pas peur, lui.
Le son de sa voix m’a fait du bien. Je m’efforce de réagir et me traite de lâche, en me disant que le lieutenant n’a pas plus l’habitude que moi.
Boum! un autre obus à dix mètres. Je sens sur mon sac comme un violent coup de poing. Instinctivement je rentre les épaules. Rien de cassé ; mon sac a reçu le morceau d’acier.
Chose étrange, et que je ne me charge pas d’expliquer, je sens que ça va mieux. J’avale plus facilement ma salive, les tempes me font moins mal, et mon cerveau recommence à fonctionner. Le lieutenant doit avoir raison: on s’habitue, seulement l’habitude vient plus ou moins vite. C’est une question de tempérament et de nerfs.
Les obus nous suivent comme une nuée de taons; ils tombent en avant, en arrière, partout, creusant des trous dans lesquels on trébuche.
Bientôt, dans la grande rumeur du canon, j’entends un bourdonnement singulier.
«La chanson des balles!» me glisse à l’oreille mon caporal.
Nous ne devons pas être loin de Mohrange.
Le capitaine nous fait coucher derrière un petit mur, mur de jardin ou de verger, sans doute. A notre droite, une grosse meule arrête les balles, qui s’y enfoncent avec un bruit sourd.
Je ne sais ce que sont devenues les autres compagnies.
Naturellement les obus tombent toujours, et de plus en plus dru, écornant parfois la muraille derrière laquelle nous sommes étendus.
Notre capitaine, qui est à genoux, se soulève de temps à autre pour regarder au-dessus du mur, et ce simple geste, je vous assure, dénote un beau courage.
Il vient de nous apprendre ce que l’on attend de nous.
«Mes enfants, nous a-t-il dit, le moment est venu de montrer que nous sommes de bons soldats et de bons Français; nous allons entrer dans la fournaise. Nous devons atteindre la crête que vous avez vue tout à l’heure, rejoindre les compagnies qui doivent y être déjà et tomber sur l’ennemi à la baïonnette. La tâche est rude; elle est digne de notre beau régiment... Votre capitaine compte sur vous.»
Cinq minutes plus tard, un homme de liaison apporte au capitaine un ordre du lieutenant-colonel.
Aussitôt la compagnie se forme par sections, non sans subir quelques pertes; puis nous nous dispersons dans les champs, en tirailleurs.
Il ne doit pas être loin de 6 heures, et le soleil caresse de ses premiers rayons la scène de carnage.
Les obus tombent comme une véritable pluie d’orage. Nous marchons sous une nappe de fer et de feu, et je fais le sacrifice de ma vie; car il me paraît impossible qu’un seul d’entre nous atteigne la crête.
Un homme de ma section est décapité par un éclat d’obus; un autre tombe, le ventre ouvert, et pousse des cris déchirants. Hélas! nous ne pouvons rien pour lui; il faut avancer au plus vite.
Je constate que le sergent Bataille traîne la jambe gauche, et lui en demande la raison.
«Un peu de fer dans la cuisse, fait-il en haussant les épaules; mais cette babiole ne m’empêchera pas d’embrocher les Boches.»
Je vois avec stupéfaction notre chef de section, le jeune sous-lieutenant, qui enfile des gants blancs, et je crains qu’il ne soit subitement devenu fou.
Comme à un moment donné il se trouve à côté de moi, je ne puis m’empêcher de lui dire:
«Vous allez vous faire canarder avec ces gants, qui doivent se voir à deux kilomètres.»
Entre deux éclatements d’obus il me répond:
«Nous avons tous juré, à l’École, de charger, pour la première fois, gantés de blanc.»
Je trouve cela très français, mais bien imprudent.
Nous montons toujours vers le but qui nous a été assigné. Le soleil commence à chauffer ferme. Sous l’azur clair, au loin, j’aperçois une maisonnette blanche qui se détache en vigueur sur le feuillage d’un coin de bois, et, je ne sais pourquoi, cette vision m’attendrit, me fait penser au village natal.
L’éclatement d’un obus, qui nous tue encore un homme, me rappelle à la réalité, et je constate que nous approchons de la fameuse crête, sur laquelle, du reste, on n’aperçoit personne.
Je me demande ce que sont devenus les camarades des autres compagnies.
Tout à coup un feu d’infanterie d’une extraordinaire violence est ouvert contre nous: de face, par des soldats installés dans des tranchées et qui nous visent comme au tir à la cible; de flanc, par des mitrailleuses.
C’est vraiment une effroyable tourmente. L’air est comme saturé de balles, il semble qu’on en respire.
Nous sommes tombés dans le piège si habilement tendu, et sans doute les Allemands espèrent que pas un de nous n’en sortira vivant.
Je constate avec une légitime fierté qu’en ce moment tragique personne n’eut la pensée de reculer.
Sans commandement, nous nous jetâmes à plat ventre sur le sol nu, et, pendant plus de trois heures, blottis sous nos sacs, nous supportâmes le déluge de balles, attendant une accalmie pour nous jeter à la baïonnette contre les maudites tranchées. Aucune accalmie ne se produisant, la colère finit par nous empoigner, et nous suppliâmes le capitaine de nous lancer à l’assaut.
C’était aller au-devant de son désir, car il tenait avant tout à exécuter l’ordre qu’il avait “reçu, c’est-à-dire à occuper la crête; seulement il attendait une occasion favorable.
Notre sous-lieutenant lui fit alors observer fort justement que nos pertes augmentaient rapidement, et que bientôt la compagnie ne serait plus en état d’effectuer une attaque avec chance de succès.
Cela le décida; il se dressa sous les balles, leva simplement le bras, et nous partîmes en poussant des hurlements sauvages, pareils à des démons furieux.
D’un bond nous arrivâmes devant la première tranchée, dont les défenseurs furent massacrés en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire.
J’avais suivi de très près mon jeune sous-lieutenant, qui s’était emparé du fusil d’un mort et avait déjà transpercé plusieurs Allemands, lorsqu’une balle, partie d’une tranchée voisine, vint le frapper entre les deux yeux.
Auto anglaise détruite par les obus sur le plateau de Quennevières.
Il tomba dans mes bras en murmurant:
«... Meurs pour la France!... Heureux!... Portefeuille...»
Ce fut tout.
Rapidement j’ouvris sa vareuse et m’emparai du portefeuille, que j’ai fait, par la suite, parvenir à sa famille.
Son pauvre corps resta- dans la tranchée ennemie. Qu’est-il devenu?
Un de ses gants, celui de la main gauche, qu’il avait instinctivement posée sur sa blessure, était rouge de sang.
Les yeux embrumés de larmes, je sautai hors de la tranchée pour me porter en avant avec les camarades.
Hélas! nous ne devions pas aller loin; le piège était bien tendu.
Une terrible bordée d’artillerie lourde faucha nos rangs. Il fallut reculer.
Sur notre droite, d’autres troupes battaient en retraite.
Un sergent du 79e me raconta l’attaque de son bataillon, qui, le 19, avait cantonné à Conthil; un soldat du 37e, celle de sa compagnie vers Pévange, en avant de Mohrange.
Leur histoire était la nôtre, avec cette exception, pourtant, qu’ils n’avaient pas eu la satisfaction d’aborder l’ennemi.
Alors ce fut la retraite sous les obus, une retraite qui eût pu devenir dangereuse si un brave régiment colonial, dont je regrette de ne pas connaître le numéro, ne s’était sacrifié héroïquement pour arrêter des forces bavaroises importantes qui menaçaient notre gauche.
Nous éprouvâmes tous un véritable chagrin en repassant la frontière, en abandonnant la terre promise, cette Lorraine annexée où nous avions pénétré si pleins d’ardeur, si joyeux, où l’on nous avait témoigné une si chaude sympathie.
«Nous reviendrons, nous dit notre capitaine Haut les cœurs, mes enfants!»
Le moral restait excellent, malgré la déception cruelle, malgré les pertes douloureuses.
A chaque instant on rencontrait des blessés étendus sur de la paille, dans des carrioles de paysans, et je ne me lassais pas d’admirer le courage de ces pauvres camarades; ils avaient toujours le mot pour rire et nous saluaient, au passage, de quelque plaisanterie.
Je vois encore un pauvre bougre du 37e, tout enveloppé de linges sanglants, qui nous criait, en nous montrant son bras gauche privé de la main:
«Ils m’orit laissé la bonne! On reviendra vous aider à taper sur les Boches!»
Les Allemands nous serraient de près, suivaient sur nos talons. Plusieurs fois nous eûmes à faire face en arrière pour les repousser, et un jour, comme nous les avions rejetés vers Arraucourt, une de nos compagnies, cernée par un bataillon, dut s’ouvrir un passage à la baïonnette.
Le 25 août, à Hoéville, nous reçûmes l’ordre de descendre vers Crevic, village situé sur des hauteurs d’où l’on domine Lunéville, pour nous substituer aux groupes du 15e corps, que les Allemands refoulaient un peu trop rapidement depuis Dieuze.
Notre retraite était terminée, et nous allions de nouveau faire face à l’ennemi sur toute la ligne.
Triste retour. — Tableau de Samson. (Phot. Vizzavona.)