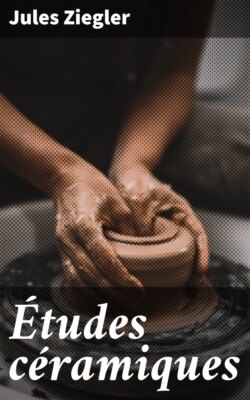Читать книгу Études céramiques - Jules Ziegler - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SEPTIÈME ÉTUDE.
ОглавлениеTable des matières
LOI DU SENS.
SENS MATÉRIEL. — DÉFINITION. — TEMPLES ANTIQUES. — NOMBRE IMPAIR DES COLONNES LATÉRALES. — LE FRONTON. — TEMPLE D’ÉLEUSIS — D’OLYMPIE. — LES ACROTÈRES. — TEMPLE DE PHIGALIE-D’ÉRECHTHÉE. — LE COLISÉE. — VERSAILLES. — LA COLONNADE ET LA COUR DU LOUVRE. — DU CARRÉ. — DALLAGES. — PANNEAUX. — MÉTOPES. — BAIES CARRÉES — EURYTHMIQUES.
Nous ne savions encore les définir ces idées, mais nous savions les voir.
P. ANDRÉ.
On comprend que d’une division hiérarchique résultent la variété, l’ordre, l’harmonie; mais comme les formes primitives ne comportent que des rapports simples de hauteur et de largeur, le motif déterminant des quantités relatives, inégales, n’a pas une origine aussi évidente. Cette origine nous la trouvons dans la loi du sens.
Le sens est un état de la forme qui permet de saisir au premier coup d’œil les différences entre la hauteur et la largeur, entre une façade et ses côtés. L’indication des milieux est aussi une dépendance de cette loi. Trop méconnue dans nos édifices, la loi du sens a été parfaitement comprise des architectes des temples antiques, comme du Parthénon, du grand temple de Pæstum, etc. Leur façade est d’une largeur double de la hauteur. La longueur latérale est de quatre à cinq fois la hauteur. Ces rapports rendent tellement sensibles les différences de leurs dimensions, qu’il ne peut rester aucun doute à cet égard dans le jugement du spectateur. C’est une expression franche, loyale et satisfaisante d’où résulte la beauté. Quelques architectes anciens, et à leur suite quelques modernes, n’ont pas tenu suffisamment compte de cette importante condition du beau, qui cependant a été observée dans les colonnades du Louvre et de la place de la Concorde.
Les Grecs, dans leurs plus beaux ouvrages, ont poussé le sentiment de cette loi qui nous est inconnue, au point de distribuer leurs colonnes en nombre impair sur les côtés, afin d’établir une différence de plus avec la façade dont les colonnes sont nécessairement en nombre pair comme la porte des temples l’exige. Le temple de Cérès à Eleusis est une exception qui confirme la règle. Il était quadrangulaire, de dimension égale sur chacune de ses quatre faces, mais il avait un portail en avant-corps composé de douze colonnes. Pas de colonnes sur les autres côtés. Cette forme mystique ne peut s’expliquer que par les cérémonies et le culte lui-même, si secret que Pausanias n’a pas osé faire la description de cet édifice. On pourrait peut-être considérer les douze colonnes de ce portail comme le symbole des douze mois, et les quatre faces égales comme l’emblème des quatre saisons, des quatre points cardinaux... Quoi qu’il en soit, le portique de douze colonnes surmontées d’un vaste fronton donnait un sens très-remarquable à la façade et à la forme extérieure et lointaine de l’ensemble.
En général, le fronton formé par les lignes inclinées de la toiture est un admirable couronnement d’un portique: il tire une partie de sa valeur du sens qu’il donne aux édifices, en indiquant non-seulement les façades mais encore le milieu de ces façades. Un monument quadrangulaire à quatre frontons, nos barrières d’octroi le démontrent, perd une partie de son mérite faute d’une direction et d’un sens.
Si le fronton s’élève trop à son sommet, et qu’il se rapproche du triangle équilatéral, il perd son sens; aussi un fronton est-il d’autant plus beau que les lignes de côté diffèrent plus sensiblement de celle de la base jusqu’à un point déterminé où cesserait l’effet pyramidal.
La loi du sens peut seule rendre compte de la beauté qui résulte de l’abaissement des frontons. Dans les climats froids, le sentiment de bien-être porte l’homme à préférer les toits aigus, qui préservent des pluies et des neiges; néanmoins ce sentiment si vivace est combattu par la beauté sensible qui résulte de l’abaissement du fronton, tant est puissante l’influence du sens en fait de beauté.
«Mais, dira-t-on, le fronton, qui distingue les
«faces des côtés, ne distingue pas la façade anté-
«rieure de la façade postérieure; il ne remplit donc
«qu’à moitié les fonctions que lui impose cette loi
«du sens. Les sculptures du fronton antérieur le
«font reconnaître aisément; mais, à une certaine
«distance, leur caractère disparaît, et avec lui cette
«précieuse qualité que vous prétendez révéler.»
Les Grecs l’ont parfaitement senti eux-mêmes; et, pour obvier à cet inconvénient qui ne pouvait échapper à la délicatesse athénienne, ils imaginèrent les acrotères, angulaires et médians. Ainsi la façade du temple d’Olympie avait de chaque côté du fronton à ses angles deux immenses trépieds, au milieu une statue colossale sur son piédestal. Rien sur le fronton postérieur. A Phigalie, des acrotères indiquaient également la façade antérieure. A Égine, la façade était indiquée par deux figures au sommet du fronton et un sphinx à chaque angle. Au Parthénon, c’étaient des boucliers de bronze; dans les petits temples, des antéfixes. La loi du sens surmontait ainsi le fâcheux effet de statues ou de trépieds isolés sur les rampants extrêmes du fronton.
Le Colisée, à Rome, dont le principal mérite est d’être un colosse, a l’inconvénient de n’indiquer ni les entrées, ni les milieux, outre le défaut plus grand encore d’avoir des divisions à peu près égales en importance contrairement à la loi des proportions.
C’est en vertu de cette loi du sens, que dans l’art céramique un sphéroïde aplati est plus agréable que la sphère; par le même motif un ellipsoïde régulier ou ovale plaira moins que l’ovoïde: si cette vérité n’était pas prouvée par mille exemples dans les œuvres humaines, elle le serait par l’œuvre du Créateur, par les contours d’un beau visage.
L’immense façade du palais de Versailles sur les jardins pèche surtout par l’uniformité des lignes. Rien n’indique à distance le centre de ces vastes bâtiments; un milieu leur manque, et l’effet en est d’autant plus fâcheux, que la chapelle qui s’élève à gauche attire les regards dans un porte-à-faux que rien ne contre-balance.
La Bourse de Paris, dont les proportions générales sont fort satisfaisantes, a le même défaut: le milieu n’y est pas suffisamment indiqué par un drapeau sur l’entablement et par un cadran accroché en dessous.
La colonnade du Louvre, au contraire, est parfaitement eurythmique, et le pavillon central, fortement accentué jusque sur le ciel, relie et domine les ailes en d’heureuses proportions.
La cour du Louvre serait un grand bassin de pierre sans l’indication des milieux par le fait des frontons. Mais l’indication des milieux serait elle-même insuffisante, si un énorme pavillon et sa toiture en dôme ne donnaient à cette cour une direction, une orientation, un sens.
Nous excluons de la belle forme le cube géométrique, qui n’a pas de sens: nous considérons qu’un carré est une forme ingrate, dépourvue de sens et réservée aux dallages; qu’un tableau de hauteur et de largeur égales est d’une fausse proportion, quel que soit, du reste, le mérite de la peinture; il en est de même des fenêtres et des portes d’un édifice.
Nous n’admettons pas au nombre des belles formes céramiques un cylindre de hauteur et de largeur égales. Hormis les pavages, le carré n’est guère employé que comme correctif en architecture: ainsi les battants d’une porte élevée ayant en hauteur quatre et cinq fois leur largeur gagneront à être ornés de panneaux carrés qui agiront sur la vue par opposition et par répétition. Il en est de même des métopes répandues sur la frise de l’ordre dorique. L’effet des métopes carrées, augmenté encore par l’interposition des triglyphes, coupe heureusement avec une sorte de cadence le long bandeau de l’entablement.
Ici encore la forme carrée asservie à l’ensemble produit son effet par opposition et comme correctif; elle tire un sens de la répétition.
C’est toujours par opposition, comme correctif, et en vue du contraste, que la porte saillante sur la longue muraille d’une ville, un pavillon en avant-corps d’une galerie, peuvent être de hauteur et de largeur égales et produire un bon effet dans l’ensemble. Les pavillons des colonnades de la place de la Concorde et ceux de la place Vendôme sont dans ce cas. Je citerai même des fenêtres carrées qui produisent l’effet heureux des métopes, dans certains édifices où la forme ronde domine. Par exemple, à la barrière Saint-Martin, où l’ensemble rond est supporté par des arcades rondes sur des colonnes rondes; le bandeau de fenêtres carrées qui percent le nu du mur produit un effet eurythmique et en même temps un effet de contraste. Ce résultat eût été le même à l’extérieur du théâtre Ventadour, si les exigences locales n’avaient obligé l’architecte à superposer deux rangées de ces fenêtres carrées, qui ne sont pas nécessitées quant à l’effet général par une suffisante quantité de lignes courbes environnantes.
Puisque j’ai prononcé le mot Eurythmie, dont la définition viendra plus tard, je saisis cette occasion de dire que les proportions d’une ouverture peuvent être: 1° relatives à sa hauteur comparée à sa largeur; qu’elles peuvent être, 2° relatives aux dimensions de l’édifice lui-même, mais que les lignes, les angles, les ombres qui lui donnent une figure spéciale, indépendamment de ses proportions, font de cette baie un membre eurythmique concourant à la décoration de l’ensemble, c’est-à-dire à l’Eurythmie.
Je reconnais que certains jolis temples de la Grèce, celui de la Victoire Aptère, par exemple, celui des propylées d’Éleusis, etc., avaient une façade de hauteur et de largeur égales; mais ces temples étaient des édifices secondaires qui ne peuvent entrer en comparaison avec les monuments de premier ordre, les seuls qui doivent être analysés comme types de la belle forme.
Quoique n’ayant pas été formulée, la loi du sens existe à l’état d’instinct dans les impressions et les jugements populaires, qui sont la voix de Dieu. Cela n’a pas de sens se dit comme une condamnation. Voilà le sens est une locution qui implique l’idée d’un sens incomplet mais reconnaissable. Lorsque enfin le sens se démontre de lui-même, qu’il brille par son évidence, la loi du sens est satisfaite, une des conditions du beau est remplie, et cela dans l’ordre moral comme dans l’ordre matériel. Le sens moral des édifices mérite aussi de notre part un examen rapide.