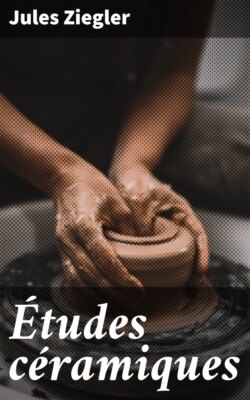Читать книгу Études céramiques - Jules Ziegler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
QUATRIÈME ÉTUDE.
ОглавлениеTable des matières
DE LA FORME EN GÉNÉRAL.
DÉFINITION. — LE CUBE ET L’ARCHITECTURE. — LE CYLINDRE ET LA CÉRAMIQUE. — LA SPHÈRE ET L’ART DU VERRIER. — DU BEAU EN GÉNÉRAL. — DE LA BEAUTÉ DES FORMES ARCHITECTURALES ET CÉRAMIQUES EN PARTICULIER.
Il n’est rien en quoi la nature montre peut-être plus de fécondité que dans la manière dont elle diversifie le contour des choses.
LAUGIER.
La forme est une abstraction, un mode d’exister ou d’apparaître soit à l’imagination, soit à la vue, soit au toucher.
Toutes les formes matérielles peuvent se décomposer, avons-nous dit, en lignes droites et en lignes courbes, dont le cube et la sphère sont le résumé le plus sensible.
L’art céramique offre une innombrable variété de formes que nous diviserons en trois classes: les Primitives, les Mixtes et les Composites. Nous ne considérerons la forme dans l’art céramique que comme contour en élévation ou silhouette; quant à la coupe dans le sens du diamètre, ou section horizontale, nous la supposerons toujours circulaire, telle qu’elle est produite par le tour du potier. Ainsi, un cylindre de hauteur et largeur égales, est la représentation du cube, dont il offre la silhouette, et réciproquement.
Les Cylindroïdes et les Sphéroïdes sont les formes Primitives.
La forme Canopienne et ses dérivés, la forme Phocéenne et ses dérivés, ainsi que les Corolles, composent la série des formes Mixtes, c’est-à-dire produites du mélange de la sphère et du cylindre.
Enfin, lorsque dans un vase diverses formes superposées concourent à l’ensemble, nous l’appelons Composite.
Le cube, le cylindre et la sphère nous semblent être dans les arts le point de départ de trois modes d’exécution différents.
Le cube, éminemment géométrique, est le type de toutes les formes quadrangulaires et architecturales auxquelles s’appliquent les lois de proportions que nous nous proposons d’établir au sujet des formes primitives. Le cube symbolise l’architecture, soit dans l’ensemble, soit dans le détail des constructions, depuis le plan général jusqu’à la figure brute de la moindre pierre.
Le cylindre est plus particulièrement affecté aux formes céramiques. La pratique seule nous conduit à cette conclusion. Nous voyons en effet les potiers, du moins les plus habiles, aussitôt que le tour est en mouvement, creuser l’argile plastique et la dresser en cylindroïde plus ou moins allongé. La hardiesse et la régularité de cette opération, qui précède l’ébauche, sont un signe auquel se reconnaissent les ouvriers renommés des diverses fabriques. C’est la ligne droite d’Apelle, devinée par Protogène. Le cylindre se perdra ensuite par mille inflexions: il pourra s’élever en colonne? s’évaser en fleur, s’arrondir comme la coupe des festins antiques, s’abaisser comme la lampe sépulcrale, s’étaler en disques variés jusqu’à l’aplanissement où finit l’art des formes...
La sphère, au contraire, semble le type originel des ouvrages de verrerie. Le vase du verrier prend naissance d’une bulle d’air qui se développe dans une larme incandescente: la bulle produit une sphère, la sphère subit un nombre infini de modifications. Elle pourra même devenir un cylindre, dont la forme à son tour étalée s’évanouit en feuille plane et transparente...
Après avoir défini la forme et parcouru d’un coup d’œil rapide quelques-uns de ses aspects primitifs, une considération de l’ordre le plus élevé se présente.
Qu’est-ce que la belle forme? qu’est-ce que le beau? telles sont les questions auxquelles il semble aisé de répondre, car le sentiment du beau est partout et les jugements sur la beauté se prononcent avec une telle facilité, une telle fréquence, que les motifs doivent en être à la portée de chacun. «On veut, dit le P. André, du beau partout, du beau dans les ouvrages de la nature, du beau dans les productions de l’art, du beau dans les ouvrages d’esprit, du beau dans les mœurs; et si l’on en trouve quelque part, c’est peu de dire qu’on en est touché : on en est frappé, saisi, enchanté. Mais de quoi l’est-on?» «Comment se fait-il, ajoute Diderot, que presque tous les hommes soient d’accord qu’il y a un beau, qu’il y en ait tant d’entre eux qui le sentent vivement où il est, et que si peu sachent ce que c’est.»
Le P. André (Essai sur le beau) et Diderot (Traité du beau) s’accordent à dire que Platon dans son grand Hippias enseigne plutôt ce que le beau n’est pas, que ce qu’il est; dans le Phèdre, qu’il parle moins du beau que de l’amour qu’on a pour lui.
L’un et l’autre citent saint Augustin, qui avait composé un traité sur la nature du beau; mais cet ouvrage est perdu, et il ne nous reste de saint Augustin que des idées éparses dans ses écrits, par lesquelles on voit que ce rapport exact des parties d’un tout entre elles qui les constitue un était selon lui le caractère distinctif de la beauté. «Si je demande à un architecte, dit ce grand homme, pourquoi ayant élevé une arcade à une des ailes de son bâtiment il en fait autant à l’autre, il me répondra sans doute que c’est afin que les membres, de son architecture symétrisent bien ensemble. — Mais pourquoi cette symétrie vous paraît-elle nécessaire? — Par la raison qu’elle plaira. — Mais qui êtes-vous pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou ne pas plaire aux hommes? et d’où savez-vous que la symétrie nous plaît? — J’en suis sûr, parce que les choses ainsi disposées ont de la décence, de la justesse, de la grâce, en un mot parce que cela est beau. — Fort bien; mais, dites-moi, cela est-il beau parce que cela plaît, ou bien cela plaît-il parce que cela est beau? — Sans difficulté cela plaît parce que cela est beau. — Je le crois comme vous, mais je vous demande encore pourquoi cela est-il beau? et si ma question vous embarrasse, parce qu’en effet les maîtres de votre art ne vont guère jusque-là, vous conviendrez du moins sans peine que la similitude, l’égalité, la convenance des parties de votre bâtiment réduit tout à une espèce d’UNITÉ qui contente la raison. — C’est ce que je voulais dire. — Oui: mais prenez-y garde, il n’y a point de vraie unité dans. les corps puisqu’ils sont composés d’un nombre innombrable de parties dont chacune est encore composée d’une infinité d’autres. Où la voyez-vous donc cette unité qui vous dirige, cette unité que vous regardez dans votre art comme une loi inviolable; cette unité que votre édifice doit imiter pour être beau, mais que rien sur la terre ne peut imiter parfaitement, puisque rien sur la terre ne peut être parfaitement un? Or de là que suit-il? Ne faut-il pas reconnaître qu’il y a au-dessus de nos esprits une certaine unité originale, souveraine, éternelle, parfaite, qui est la règle essentielle du beau et que vous cherchez dans la pratique de votre art?» D’où saint Augustin conclut, dans un autre ouvrage, que c’est l’unité qui constitue pour ainsi dire la forme et l’essence du beau en tout genre. Omnis porro pulchritudinis forma unitas est.
Après avoir cité ce remarquable dialogue, ni le P. André, qui traite la question dans ses rapports les plus étendus et dans le plus beau langage, ni Diderot qui le suit de loin, n’ont ajouté un degré à la connaissance du principe fondamental de la beauté architecturale dont saint Augustin s’est le plus rapproché, de sorte que la question adressée par ce Saint à l’architecte subsiste encore dans toute sa hauteur, qu’elle n’a été atteinte par aucune réponse, et qu’elle a été dépassée par celle de saint Augustin lui-même, qui exige une connaissance approfondie de la divinité chrétienne: unité originale, souveraine, éternelle, parfaite. Or, comme les plus beaux ouvrages de l’art datent du Polythéisme, il s’ensuit que saint Augustin s’est tellement élevé dans sa sublime réponse, qu’il semble n’avoir pas touché à la question.
Mais si nous admettons que l’homme est l’image de la Divinité, qu’il réunit en lui-même les qualités de symétrie, de proportions, d’où résulte la hiérarchie des masses et des détails, proportions et hiérarchie visibles desquelles dépend l’ordre, la variété, tandis que chaque partie concourt à l’unité, nous aurons saisi la cause réelle de tous nos jugements sur la beauté dans l’architecture et l’art céramique, savoir, que l’homme est lui-même le terme de comparaison de tout ce dont il examine la beauté, et que l’admiration de ses semblables aussi bien que l’amour de soi le dirige à son insu dans ses décisions sur ce qui est beau ou ce qui ne l’est pas.
En résumé, quand saint Augustin disait à l’architecte: Où la voyez-vous donc cette unité qui vous dirige dans la construction de votre dessin; cette unité que vous regardez dans votre art comme une loi inviolable; cette unité que votre édifice doit imiter pour être beau? l’architecte eût répondu victorieusement s’il eût dit: Je la vois cette unité dans l’œuvre la plus parfaite de la création, dans l’image de Dieu sur la terre; j’y vois la symétrie d’un côté à l’autre, j’y vois la diversité de haut en bas, j’y vois partout la hiérarchie; à une masse qui est le corps sont subordonnées les extrémités qui se divisent et se subdivisent pour former l’ensemble; j’y vois dans l’ordre moral les mêmes lois de beauté ; à une intelligence supérieure sont subordonnés cinq sens d’où naissent l’instinct, les idées de conservation, d’équité, de justice, de poésie, de religion, etc., corps et intelligence, sens et idées, membres et facultés, activité matérielle et morale, enfin UNITÉ.
Ces rapports n’avaient pu échapper aux Grecs qui n’étaient pas moins philosophes qu’architectes. Vitruve nous a transmis une maxime qu’il tenait d’eux sur cette matière: Non potest ædes ulla sine symetria atque proportione rationem habere nisi uti ad hominis bene figurati membrorum habuerit exactam rationem, l. I, chap. II.
S’il s’agissait d’imitation exacte, cette doctrine serait absurde; les anciens n’avaient donc en vue que les principes philosophiques de la raison en architecture.