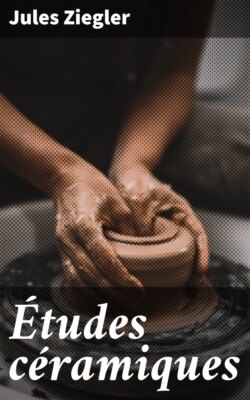Читать книгу Études céramiques - Jules Ziegler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CINQUIÈME ÉTUDE.
ОглавлениеTable des matières
NOMENCLATURE ET CLASSIFICATION.
LE MOT CYLITECHNIE MANQUE A LA LANGUE FRANÇAISE. — NOMENCLATURE ANTIQUE. — OTT. MULLER. — A. BRONGNIART. — CLASSIFICATION NOUVELLE DES FORMES.
On a beau classer, toujours quelque capricieux échappe à la catégorie.
THÉOPHILE.
Dès que par l’étude nous pénétrons dans un filon inexploré de la science, nous ne tardons pas à reconnaître l’insuffisance des ressources du langage; au delà d’une certaine limite, les mots manquent aux idées nouvelles et la nécessité se fait sentir de créer des termes nouveaux. A cet égard les savants s’accordent réciproquement une somme d’indulgence: mais quand au point de départ l’expression générique n’existe pas, quand la base manque, cette liberté de créer le mot inconnu ne dépend plus d’une seule classe d’initiés, mais de la nation elle-même. Alors la difficulté devient grande en face des catégories de juges dont quelques-unes ne comprennent pas: d’autres pour sentence ont la moquerie et pour pénalité infligent le ridicule.
Dans le sujet que je traite, l’art des vases considéré comme forme, comme invention, comme fraction des beaux arts, n’a pas une expression représentative.
Au sens propre, art céramique (du mot Céramos, quartier d’Athènes où se faisaient les briques et les poteries, Céramis, potier) exprime l’œuvre du potier depuis la tuile jusqu’à la porcelaine. L’art des vases n’est qu’une partie de l’art céramique, et réciproquement l’art céramique n’est qu’une section, un département de l’art des vases.
Les vases d’or, d’argent, d’agate, d’ivoire, de bronze, d’émail, de verre, d’électre et de térébinthe... n’appartiennent pas à l’art du potier, du céramiste, ils ressortent d’un art dont la Forme est la hase, le lien général, quelle que soit la matière. Cet art n’a pas de nom dans la langue française. Jamais origine grecque (græca fons) ne fut plus nécessaire qu’à l’expression qui comblerait cette lacune. Déjà du mot générique Poterioon, vases à boire, nous avons pu faire poterie. Mais les Grecs avaient une expression plus générale encore. Pour désigner les dissertations, les théories sur les vases, ils employaient le mot cylikeegorein. Un buffet chargé de vases de toute nature se nommait cylikein. Enfin le cylix ou kylix a donné son nom au calice, l’un des vases sacrés des chrétiens.
Par toutes ces raisons, la CYLITECHNIE serait le terme qui répondrait à mon dessein: lui seul représente l’idée générale et abstraite de l’art des vases; tandis que la céramique ne représente que l’emploi des terres cuites à différents degrés, l’orfévrerie exprime l’emploi des métaux précieux, la verrerie celui des matières vitreuses, etc.
A quel art appartiennent ces coupes, l’une d’agate-onix, l’autre de bois de lierre? Comme matière, la première est l’œuvre du lapidaire, la seconde l’ouvrage du tourneur. Mais l’art qui a présidé aux formes de ces chefs-d’œuvre quel est-il? Le mot n’existe pas. Ce pourrait être la cylitechnie.
En adoptant pour ce livre le terme de Céramique, j’ai entendu dire l’art des vases en général, considérés sous le rapport de la forme; j’ai mieux aimé donner de l’extension à une locution incomplète mais acceptée, qui rendait la plus grande partie de ma pensée, que de créer un mot générique nouveau, qui cependant l’eût rendue tout entière. En cela, je me suis autorisé de l’exemple de Cléopâtre, femme de Philippe, qui appelait Céramos des vases d’or et d’argent exécutés d’après les modèles céramiques.
Si je regrette l’absence de la cylitechnie, si j’y renonce par respect pour le maintien du langage, je n’en suis pas moins convaincu qu’avant toute dissertation comme avant toute discussion, il est important de s’entendre sur la valeur des mots et plus encore d’avoir des mots qui permettent de s’entendre sur la valeur des choses.
J’essaierai donc de régler l’emploi de certaines expressions, et de décrire avec précision ces formes innomées ou désignées jusqu’ici par des termes si nombreux, si étranges, qu’il est impossible de les appliquer clairement et utilement sans le secours du dessin, comme on peut le voir ci-après.
Athénée, dans son Banquet des Savants, fait dénombrer par ses convives les divers vases à boire (poterioon) en usage parmi les Grecs. Cette nomenclature ayant un intérêt archéologique, je crois devoir la reproduire dans l’ordre alphabétique.
VASES A BOIRE. — POTERIOON.
Aiakis.
Aleison.
Amphosis.
Amystis.
Anaphaia.
Ankyle.
Aooton.
Argyris.
Arokon.
Aryballos.
Batiakion.
Baukalis.
Beessa.
Bikos.
Bombylios.
Bromiades.
Heémitomos.
Hédypoutides.
Chalkidika.
Chrytides.
Chytridia.
Connoi.
Cyathis.
Cyssibion.
Dactyloton.
Deinos.
Depas.
Depastron.
Ekpomata.
Eléphas.
Emhasikoiton.
Ephèbos.
Grammatikon.
Gyalai.
Manées.
Mastos.
Histiakon.
Holmos.
Istmion.
Kadiscos.
Kados.
Kalpion.
Kantaros.
Karkesion.
Kélèbe.
Keras.
Kerater.
Kernos.
Kiborion.
Kissibion.
Kondy.
Kononios.
Kostabis.
Kothon.
Kotylos.
Kranion.
Kroyneia.
Kylix.
Kymbia.
Kypellon.
Labronia.
Lakainoi.
Legynon.
Leibasion.
Lepaste.
Lesbion.
Louteerion.
Lykourgeis.
Matallide.
Mélée.
Métaniphoon.
Oodos.
Oon.
Ooskyphia.
Oxybaphon.
Panathénaïke.
Pelikai.
Pellis.
Pentaploon.
Petachon.
Phiale.
Philotesia.
Phtois.
Pristis.
Proaron.
Prochoïs.
Pronsias.
Psygeus.
Rheouta.
Rhodias.
Rhytis.
Rhyton.
Sarmakra.
Seleukis.
Skallion.
Skaphis.
Skyphos.
Tabaïtos.
Térikléios.
Tragélaphos.
Voilà cent noms divers (seulement pour les vases à boire) dont la description, sous le titre de Cyligraphie, est reportée après la 24e étude. K. Ottfried Muller, dans son ouvrage sur les monuments grecs, désigne un certain nombre de vases en usage dans l’antiquité. Il est facile de voir, en jetant les yeux sur les dessins qui accompagnent le texte de ce savant, que les noms les plus différents sont donnés aux mêmes formes, et que des noms semblables sont donnés aux formes les plus différentes.
Je donnerai sa nomenclature entière, quoique plusieurs désignations fassent partie de la liste d’Athénée.
Amphore égyptienne.
thyrrénienne.
panathénaïque.
bacchique.
de Nola.
apulienne.
pélique.
avec anses à volute.
à têtes de Gorgone.
en forme de candélabre.
à roues.
Hydria.
Calpis.
Kelebe.
Stamnos.
Cratère.
Oxybaphon.
Stamnos.
Karkesion.
Cantharos.
Cyalthès.
Holmos.
Holkion.
Skiphos.
Kylix.
Phiale.
Lépaste.
Lekane.
OEnoche.
Rhyton.
Askos.
Lekythos.
Aryballos.
Kotiliskos.
Bombylios
Alabastron.
Dans la description du musée céramique de Sèvres par MM. Brongniart et Riocreux, je trouve d’autres dénominations, outre quelques-unes de celles que je viens de citer. Elles sont puisées à diverses sources. Néanmoins ni O. Muller ni M. A. Brongniart n’ont pu compléter cette vaste nomenclature éparse dans les écrits des anciens auteurs grecs.
Voici plusieurs noms cités par M. Brongniart:
Diota.
Orca.
Lanx.
Phascon.
Chous.
Paropsis.
Rhophaloton.
Akatos.
Pinax.
Prosopoutta.
Sauf quelques termes acceptés et significatifs, comme les rythons par exemple, qui passent pour les premiers vases, pour les plus anciennes formes des temps héroïques (ces rythons étaient d’abord des keramos ou cornes, d’où les Grecs ont tiré le mot céramique), sauf quelques termes acceptés, on comprend la difficulté d’utiliser et de faire entrer dans la langue usuelle une telle série d’hellénismes dont l’origine est due, soit à la matière, soit aux pays de fabrication, soit aux noms des potiers, soit à la destination, soit à la mesure locale de contenance, etc.
La confusion et l’incertitude ne peuvent manquer d’assaillir notre raison et notre mémoire dès que nous voyons à combien de formes diverses et opposées tous ces noms sont appliqués par les savants. Sans vouloir proscrire la légion de dénominations antiques et respectables que j’ai dénombrée, j’essaierai, partant de la ligne droite et de la ligne courbe, de classer et de nommer les formes les plus simples par des termes auxquels on pourra facilement joindre des expressions, soit acceptées, soit nouvelles, selon les besoins de la science.
CLASSIFICATION ET NOMENCLATURE.
La classification ci-jointe est une Formule analogique des modes suivis dans la nature pour la production des êtres, des familles et des genres.
FORMÉS GÉNÉRATRICES.
A. Ligne droite et cube.
Z. Ligne courbe et sphère.
FORMES PRIMITIVES.
Lignes droites.
B. 1. Cylindre.
B. 2. Conoïde.
B. 3. Clavoïde.
Lignes courbes.
C. 1. Sphéroïde.
C. 2. Ovoïde.
C. 3. Ogivoïde.
FORMES MIXTES
Participant du cylindre et de la sphère, les courbes étant dirigées
en dedans.
D. 1. Canopienne.
D. 2. Napiforme.
D. 3. Turbiniforme.
E. 1. Phocéenne.
E. 2. Lacrimiforme.
E. 3. Piriforme.
FORMES MIXTES
Participant du cylindre et de la sphère, les courbes étant dirigées
en dehors.
F.1. Corolle s’évasant du tiers supérieur.
F. 2. Corolle s’évasant du tiers inférieur.
F. 3. Campanule s’évasant du tiers supérieur et se fermant du tiers inférieur.
CRATÉROIDES
Ayant en largeur de deux à cinq fois la hauteur.
G. 1. Cratéroïde segmentaire.
G.2. Cratéroïde de cinq hauteurs, canopien.
G. 3. Cratéroïde de quatre à trois hauteurs, campanuliforme.
DISCOIDES
Ayant en largeur au moins cinq fois la hauteur.
H.1. Discoïde segmentaire.
H.2. Discoïde canopien, tore de chapiteau dorique.
H.3. Discoïde tectiforme. Couvercles, pieds de vases
TIGES
Ayant en hauteur plus de trois fois le diamètre.
J.1. Tige évasée du tiers supérieur.
J. 2. Tige évasée du tiers inférieur.
J. 3. Tige campanuliforme à double courbure.
Les variétés orbiculaires, pomiformes, bulbiformes, ficiformes, fusiformes, etc., se rattachent aux différents signes de notre classification.
Je crois important d’ajouter que mon travail a été soumis dans ses derniers jours à l’illustre M. Alexandre Brongniart, qui portait à cet essai le plus vif intérêt, soit pour l’art en lui-même, soit par l’effet d’une ancienne et réciproque amitié. J’ai l’espoir que ces vingt-quatre figures, semblables à un alphabet nouveau, seront un jour d’un emploi facile et peut-être usuel.