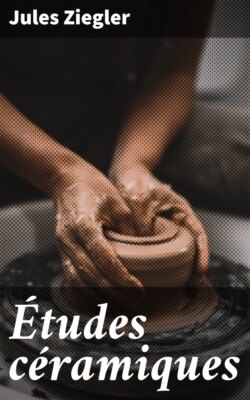Читать книгу Études céramiques - Jules Ziegler - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
LA LETTRE SUIVANTE, RELATIVE A LA PUBLICATION DES ÉTUDES
CÉRAMIQUES, PEUT EN ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME
L’INTRODUCTION CONFIDENTIELLE.
«L’intérêt que vous portez au livre dont je m’occupe, Monsieur, m’inspire la plus sincère reconnaissance, et je m’empresse, selon vos désirs, de vous expliquer l’objet de cet ouvrage en vous racontant l’épisode qui me donna lieu de l’entreprendre.
«Avant toute chose, je dois répondre aux reproches obligeants que vous me faites sur le partage de mon temps entre la peinture et l’art céramique; partage fort inégal, et que je ne puis comparer aux alternatives nécessaires du repos et du travail, car, je le répète, l’art céramique n’a été qu’un court épisode dont ce livre sera je l’espère la conclusion finale.
«Pourquoi reprocher aux artistes vivants cette double activité qu’on admire dans les artistes d’autrefois? Je sais combien peu il est permis de se comparer à eux, mais vous m’accorderez qu’ils sont dignes d’être nos modèles. Socrate, le sculpteur des trois Grâces qui se voyaient aux Propylées d’Athènes, a-t-il eu tort d’enseigner la philosophie, ou a-t-il eu tort de sculpter les trois Grâces? Plaindriez-vous Phidias, statuaire, d’avoir fait le vase des Panathénées, et d’avoir dirigé la construction du Parthénon? Regrettez-vous que Michel-Ange, le peintre de la Sixtine, ait fait le Pensiero, et qu’il ait tracé le contour des candélabres et des balustres de la chapelle Laurentine, ou qu’ayant fait le dôme de Saint-Pierre il ait construit les fortifications de San-Miniato et de Florence? Giotto et le Campanile de Florence, Albert Durer, peintre et graveur, Léonard de Vinci, peintre-ingénieur, etc., enfin l’immortel Raphaël donnant les plans de Santa-Maria-della-Pace, où il peignit les Sibylles, sont-ils des exemples à suivre ou à éviter? Je crois que les grands exemples, quelle que soit la distance qui nous en sépare, méritent d’être suivis dans leur dualité. — Ces modèles sont trop grands! eh bien, tournons nos regards vers l’ordre matériel: ne voyons-nous pas les arbres porter alternativement des fleurs et des fruits; s’il en est qui s’ornent de fleurs sans donner de fruits, et d’autres qui, comme le figuier, produisent des fruits sans trace de fleurs, ne devons-nous pas comprendre que ces caprices de la nature se rencontrent aussi bien dans les hommes que dans les végétaux, sans qu’ils aient droit de s’en louer ou de s’en plaindre, et sans qu’on puisse le leur reprocher?
«Les détails que vous me demandez ne doivent intéresser qu’un ami, et, à ce titre, je ne puis vous les refuser. Permettez-moi de remonter à une époque dont vous avez gardé le souvenir; à ce temps de première jeunesse, où, terminant mes études, ma vue fatiguée inspirait de vives inquiétudes à ma famille.
«Alors il lui décidé que je passerais une année au milieu des champs et des bois, dans la maison paternelle, sans autre occupation que la chasse ou ma fantaisie. C’était au village de Soyers, l’un des plus modestes de la Haute-Marne. Or Soyers est bâti sur la glaise; une argile rouge et tenace s’y rencontre partout, jusqu’aux portes de l’église.
«Mon activité n’étant pas suffisamment alimentée par la chasse, ma fantaisie fut de peindre sur une planche de chêne le tableau de neiges et de brume que vous connaissez; mais la peinture m’était interdite; je songeai à faire quelque ouvrage de faïence dont je rêvai les dessins; guidé par les descriptions de l’Encyclopédie, je travaillai avec une ardeur juvénile à la construction de tous les appareils nécessaires à mon entreprise. Il se trouva que mon grand-père maternel avait eu la même pensée, et qu’il avait été sur le point de la mettre à exécution; aussi ma mère se joignit-elle de cœur à mon projet, soit par respect pour la mémoire de son père, soit par tendresse pour la personne de son fils. Mon père au contraire se tenait indifférent et froid: mais son silence donnait à mes occupations l’attrait du fruit défendu, et je comptais sur la réussite pour obtenir son approbation. Hélas! il n’en fut rien. Le jour où sur la roue du tourneur la terre s’éleva en spirale, le jour où le sol se jonchait de fraîches amphores déposées avec soin, un orage éclata. La réflexion mûrie de mon père, se combinant à une répugnance progressive, il se fit un grand mouvement, et ma création disparut; les tours du potier démontés furent transportés, disséminés dans les combles; les lourdes roues si bien équilibrées qui, le matin, tournaient légèrement, prirent à midi la place des hiboux sur les plus hautes charpentes des plus hauts greniers de la maison paternelle. J’en suis encore ému aujourd’hui!
«Dix-sept ans plus tard, je terminais mes travaux à l’église de la Madeleine. Ma vue était de nouveau fatiguée. déformée, si je puis ainsi dire, par les surfaces courbes et obscures de la voûte où j’avais peint. Un repos absolu m’était ordonné. Je me résignai à déposer les pinceaux pour aller vivre hors des tentations de l’art qui s’en prenait à mes yeux. En comptant sur des loisirs, j’avais compté sans les astres. La comète céramique, reparaissant après une longue période, fit de nouveau sentir son influence. Aux premiers jours de ce repos, l’ancienne fantaisie comprimée dans l’enfant se dilata dans l’homme. Alors apparurent, comme des visions, les galeries de vases antiques que j’avais parcourues avec l’œil ami du potier, en visitant l’Italie, l’Allemagne et l’Angleterre. Des compositions céramiques s’élevaient en gerbes au souvenir du Vatican de Munich, de Londres, etc. Ce fut alors que B. Palissy m’indiqua Voisinlieu et m’y conduisit. Voici ses propres paroles écrites en 1570: «Il y a une
«espèce de terre en Beauvoisis que je cuide qu’en France,
«n’y en a point de semblable, car elle endure un merveil-
«leux feu sans être aucunement offensée, elle a ce bien là,
«de se laisser former autant ténue et déliée que nulle des
«autres, et quand elle est extrêmement cuite, elle prend un
«petit polissement vitrificatif qui procède de son corps même:
«et cela cause que des vaisseaux faits de ladite terre tiennent
«l’eau fort autant bien que des vaisseaux de verre.» Mon dessein était de réaliser pendant la belle saison tous mes rêves céramiques; mais, quand cette belle saison fut passée, il se trouva que j’avais couru les carrières, les gisements variés des terres, ainsi que les forêts du Beauvoisis, que j’avais crayonné, sculpté même, force modèles, que de patients porcelainiers les avaient exécutés sous mes incessantes retouches: il se trouva que les moules étaient faits, mais que le feu s’était montré ingrat et rebelle. Sur les rives du Therain on voyait amoncelées des pyramides étranges: c’étaient des poteries défournées, d’un aspect mat, terreux, irritant, et, pour compenser d’énormes dépenses, il avait été vendu pour 12 francs de cendres.
«Alors commença ma mission. Il me fallut combattre par la persuasion, par le raisonnement, par une vigoureuse volonté, les fausses méthodes d’une famille entière de potiers à mon service, race obstinée s’il en fut. Pour obtenir de diriger, selon mes vues, selon mon instinct, le feu d’où sortirent enfin ces grès bruns qui me rappelaient les bons grès allemands des bords du Rhin, dont le secret avait disparu plus que celui de la peinture sur verre, j’eus à résister aux routines énergiques du père, aux menaces du fils, aux pleurs des femmes et des enfants. Ces temps sont passés.
J’ai réalisé mon rêve: les dessins de vases que contiendra mon Recueil sont faits d’après quelques-unes des pièces sorties de mes fours. La plupart des fabriques d’Europe ont copié mes modèles où s’en sont inspirées. Ma fabrique a prospéré ; elle est louée depuis le 24 août 1843 à M. Mansart, qui la dirige à son gré. Je repousse toute solidarité dans les ouvrages produits depuis cette époque, soit dans ma fabrique, soit dans les cinq fabriques rivales qui surgirent le jour du succès. Je n’accepte d’autre responsabilité que celle de mes œuvres, de l’initiative, et de la matière qui n’a pas démérité depuis Palissy.
«Revenu à ma peinture, j’ai souvent reporté mes souvenirs et les regards de mon imagination sur les causes de la beauté dans les formes céramiques. Souvent j’ai analysé et démontré à mes amis des principes de proportions qui étaient le résultat de mon expérience et des nombreuses observations que j’ai faites durant trois années. Quelquefois, pour rendre ma pensée, je trouvais des inductions, des comparaisons, dans l’architecture et les monuments les plus remarquables de l’antiquité. L’Analogie me surprit plutôt que je ne la cherchai; l’influence de l’art céramique sur les ouvrages des architectes grecs m’apparut de plus en plus évidente; alors je me livrai à l’étude des monuments d’Athènes. Je recherchai dans les écrits des philosophes grecs les vestiges d’une civilisation où les beaux-arts jouèrent un si grand rôle. Puissé-je avoir retrouvé les traces de ces lois d’Analogie, de Proportions et d’Eurythmie, dont les Grecs ont conservé le secret jusque dans Rome, guidé que j’étais par l’espoir de faire une œuvre utile.
Études, Analyses, Synthèses, voilà, monsieur, de quoi se composera le livre, au sujet duquel vous me donnez un nouveau témoignage de votre honorable amitié.
«Un homme ne doit pas mourir sans avoir planté un arbre. Le peintre comme le statuaire doit laisser après lui une image de la beauté, soit telle qu’il l’a rêvée, soit telle que la nature lui en a offert le modèle Celui qui a pu un moment porter ses regards au delà des limites de la science, ne fût-il que simple potier, doit aussi une offrande au trésor de la tradition où d’abord il a puisé lui-même.
«Je fais des vœux, monsieur, et aussi des efforts pour que vous trouviez dans les pages que je publierai un jour, quelque pensée digne de la tradition, digne de vous surtout et des hommes éminents auxquels j’espère les soumettre.
Veuillez, Monsieur, agréer, etc.
J. ZIEGLER.
Le 1er décembre 1849.