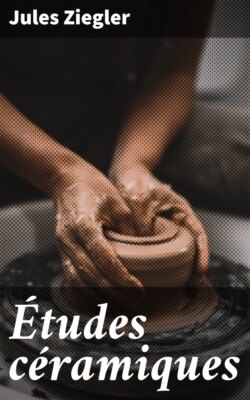Читать книгу Études céramiques - Jules Ziegler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HUITIÈME ÉTUDE.
ОглавлениеTable des matières
SENS MORAL
OU CONVENANCE DE STYLE.
SENS-DE L’ARCHITECTURE OGIVALE. — LES CATHÉDRALES. — SENS DE L’ARCHITECTURE ROMANE. — LA CHAPELLE DE LOUIS XVI. — LA CHAPELLE DE SABLONVILLE. — L’HOTEL DE VILLE DE PARIS. — ARCHITECTURE COMMUNALE.. — LE PALAIS DU QUAI D’ORSAY. — LES THÉATRES. — LES BIBLIOTHÈQUES. — LES HALLES ET MARCHÉS. — LES HOPITAUX. — LES BAINS. — LES STATIONS DE CHEMIN DE FER. — LES FONTAINES. — LES PORTES SAINT-DENIS ET SAINT-MARTIN. — L’ORDRE ROMAIN ET L’ORDRE FRANÇAIS. — LES ORDRES GRECS ET LES ORDRES DE FER.
Nous avons dit que le sens était un état de la forme matérielle, qui permet de saisir au premier coup d’œil les différences entre la hauteur et la largeur, entre une façade et ses côtés, etc.
Le sentiment auquel s’adresse en nous ce genre de beauté nous porte à vouloir encore que chaque œuvre d’architecture ou de céramique ait un aspect et des conditions de forme en rapport avec la destination même de l’œuvre, de telle sorte qu’au premier coup d’œil la destination soit sensible. Nous nommons sens moral cette précieuse qualité.
Quel est le sens moral de l’architecture ogivale? Soit par la direction des grandes voûtes, soit par l’effet de ses merveilleux élancements, le style ogival a un sens éminemment religieux, au point que nous voudrions le voir exclusivement consacré aux églises chrétiennes. Le style du magnifique palais ogival de Westminster à Londres, où sont réunies la chambre des pairs et celle des communes, a un sens en Angleterre et n’en aurait pas chez nous. En effet, dans les solennités, ces corps d’État sont présidés par les rois et reines de la Grande-Bretagne, qui sont à la fois chefs politiques et religieux. La religion et la politique devaient donc imprimer leur caractère à l’édifice le plus important des trois royaumes. Ici le sens moral qui résulte de l’architecture ogivale est parfaitement motivé. Quant au défaut providentiel ou calculé de symétrie, on peut s’en rendre compte par le caractère schismatique du dogme anglican.
La religion qui créa les temples grecs en l’honneur des dieux de l’Olympe a disparu, tandis que ses monuments sont restés. Ils n’auraient aucun sens moral, dans les sociétés modernes, s’ils ne réveillaient en nous le culte des grands souvenirs, celui des beaux-arts et des chefs-d’œuvre antiques; aussi une place leur doit être assignée de nos jours au milieu des populations les plus civilisées: collections de statues antiques, musées de peinture et de sculpture, consécrations des faits mémorables, glorification des grands hommes, telle doit être la destination de ces édifices. Ils auraient ainsi un sens moral qui en ferait reconnaître l’usage, et les distinguerait de tous autres, comme on distingue une façade d’un de ses côtés.
Une chapelle sépulcrale aura un sens moral et sera appropriée à son objet si l’intérieur rappelle les cryptes et les fondements souterrains de nos belles cathédrales. La chapelle expiatoire de Louis XVI est un chef-d’œuvre par le sens moral dont elle est revêtue. Au premier aspect, l’édifice indique une inspiration et communique une pensée sans incertitude. La chapelle funéraire de Sablonville n’a pas moins le caractère et le sens moral de sa pieuse et lamentable destination.
Comment n’être pas saisi du sens funéraire des Pyramides, ces vains emblèmes de la stabilité dans l’élévation! Outre l’effet qui résulte de l’opposition de leurs angles nets et de leurs arêtes droites sur la ligne vaste et sinueuse du désert où l’œuvre de l’homme est isolée en présence de l’œuvre de Dieu, elles portent dans l’âme le sentiment de leur destination sépulcrale.
Le style roman semble être après la pyramide celui qui convient davantage aux sentiments qu’éveille en nous la vue des tombeaux.
D’autres édifices de nos villes tireraient leur beauté du sens de leur architecture; ainsi l’Hôtel de Ville de Paris pourrait être sous ce rapport un modèle de l’architecture communale.
Le palais du quai d’Orsay a bien le style qui convient aux délibérations d’un conseil d’État, d’une cour des Comptes et aux grands tribunaux de la nation.
Les fêtes, les théâtres ont aussi leur architecture; d’heureux essais en ont été faits à Paris dans ces derniers temps.
L’architecture des bibliothèques est à créer en France.
L’architecture des marchés et des halles est généralement un non-sens; elle se trouve en plein désaccord avec leur destination. Les municipalités, comme les architectes, ne voient dans ces constructions que l’occasion de faire un monument, une œuvre glorieuse; toutes sont d’une hauteur démesurée, ce qui les rend très-coûteuses. Quoiqu’il s’agisse d’y placer des marchandises à hauteur d’homme, comme graines, volailles, poissons, ces bâtiments semblent destinés à des entassements de mastodontes: la belle ordonnance de l’architecte ne tarde pas à être coupée par des persiennes, des abris de tous genres, car les pluies et le soleil font justice de ces grandes ouvertures: il règne alors un vide immense et sombre à l’intérieur; les vents s’y engouffrent, et il y gèle comme au milieu de la rue.
Parmi les édifices publics, les marchés doivent se distinguer par leur peu d’élévation. Ils doivent abriter de la pluie et du soleil le marchand, la marchandise et l’acheteur. Ils doivent de l’air à la marchandise, de la lumière à l’acheteur et de l’aisance au marchand. Cette sorte d’architecture comporte surtout une distribution largement calculée de grandes artères, d’avenues et de passages où les dégagements soient faciles et bien indiqués. Dans un marché comme celui des Innocents à Paris, au lieu d’une seule place centrale, il en faut de petites; au lieu d’une grande fontaine centrale, il faut des fontaines réparties et variées; au lieu de grands combles supérieurs, il faut des voûtes inférieures c’est-à-dire des caves partout où la conservation des aliments l’exige. Comme art, le sens de ce genre d’architecture est aussi à créer.
Il y a quelques édifices publics qui doivent manquer à cette condition du sens, à ce style, à ce caractère qui indique l’usage auquel ils sont consacrés. Ainsi les hôpitaux ne sauraient assez voiler leur triste destination sous une apparence agréable. Les cours pavées devraient y être remplacées par des jardins verdoyants, avec des chemins dallés pour la promptitude du service. Chaque fenêtre devrait donner le plus d’air, de soleil et de gaieté possible. Des pelouses, des points de vue sur des massifs de verdure et de fleurs, des promenades sablées, une architecture solide, sans emphase, modeste même, loin de la ville pour les incurables, près de la ville pour les accidents; des succursales ou administrations dans la ville avec des litières pour les différents hospices, tous loin des bords du fleuve ou de la rivière, aucun caractère générique d’architecture, tel devrait être la règle à l’égard de ce genre d’édifices. Si jamais un hôtel des Invalides civils est décrété, qu’il soit loin de Paris, là où les subsistances abondent à bas prix, en vue de la mer, et que ses constructions hospitalières soient variées, saines, rustiques et durables.
Les établissements de bains ou maisons de bains qui n’ont pas encore un substantif, un nom qui les désigne dans notre langue, n’ont pas encore une architecture dans notre capitale. Il n’en est pas de même en Allemagne. Vienne possède des modèles de ce genre. On en voit aussi à Londres et à Constantinople.
L’architecture des chemins de fer aura, nous l’espérons, un sens. La gare du chemin de Paris à Strasbourg en construction aujourd’hui annonce un sentiment du sens fortement exprimé : de belles masses au nombre de trois, un milieu largement indiqué, les formes principales tirées de la nature même et de la destination de l’édifice, composent un style particulier aux chemins de fer. Le duché de Bade a produit aussi des modèles: les stations du chemin de Kehl à Karlsruhe méritent d’être visitées non-seulement par les architectes des chemins de fer, mais par tous les architectes.
Il est à souhaiter que la gare du chemin de Paris à Lyon soit digne de la France. Si l’on en peut juger dès aujourd’hui, son orientation pourrait bien manquer à la loi du sens. Voilà une façade appelée sur Paris, qui vaut bien l’honneur qu’on le regarde, appelée par une rue qui part en ligne droite de la place de la Bastille, et cette façade regarde Vincennes’ Si parmi les conditions imposées à l’architecture des chemins de fer on compte la proximité de la ville, on peut dire encore que la gare de Paris à Lyon manque totalement à cette règle de convenance.
L’architecture des fontaines a été longtemps négligée en France. La fontaine des Innocents, malgré les sculptures de Jean Goujon, ne pouvait rivaliser avec les belles fontaines de Rome et de Sicile. Aujourd’hui, nous avons la fontaine de la place Louvois et celles des Champs-Élysées qui peuvent être citées comme des modèles en ce genre de constructions. Les fontaines ne doivent ressembler ni à des portails, ni à des piédestaux, ni à des tombeaux, ni à des campaniles, ni à des guérites. Elles ne doivent jamais entraver les voies de communication, et il serait fort regrettable que la fontaine des Innocents fût transportée dans la cour du Louvre, comme on en a le projet; outre son inutilité complète en ce lieu inhabité, elle formerait quatre obstacles: 1° au passage du pont des Arts à la rue Saint-Honoré ; 2° au passage des Tuileries à Saint-Germain-l’Auxerrois; 3° à la vue de l’Institut de l’entrée de la rue du Coq; 4° à la vue des Tuileries de l’entrée orientale du Louvre. La beauté d’une œuvre d’art compense quelquefois son inutilité, mais elle ne saurait compenser l’incommodité ou la gêne publiques.
Les portes Saint-Martin et Saint-Denis ne peuvent être considérées que comme des œuvres d’art, des arcs de triomphe, des ornements de la cité ; loin d’être nuisibles, elles ont un genre d’utilité fort recommandable. Leurs larges jambages et les trottoirs qui les entourent sont un abri pour les passants contre ces innombrables voitures qui arrivent de tous côtés dans ce lieu populeux. Ces abris pour le public à pied manquent à Paris dans les croisements de rues. A Londres il n’en est pas ainsi: dans les carrefours fréquentés, plusieurs bornes de fonte, étroites, hautes, d’une certaine simplicité élégante, forment au centre de ces carrefours un asile commode contre les voitures, et d’où les gardiens peuvent surveiller d’un coup d’œil toutes les rues aboutissantes. Ces abris manquent à Paris; en certaines places ils y seraient aussi utiles que des garde-fous à un pont. Rien ne s’opposerait à ce que ces Gardes-foule ne fussent des chefs-d’œuvre de sculpture: la fonte de fer se prête à toutes les conditions de résistance et d’ornementation.
La place des gardes-foule est indiquée en quelques endroits par les arbres de liberté ; une telle mesure de sécurité serait préférable à ces symboles mal choisis, car si l’allégorie ou la similitude ont quelque valeur en fait de symboles, que penser de ces agrestes habitants des prairies amis des clairs ruisseaux? transplantés dans nos rues, emprisonnés dans nos carrefours, ils sont un triste emblème de Liberté.
Les Grecs ont créé trois ordres d’architecture pour la pierre. Chacun de ces ordres, savoir, le dorique, l’ionique et le corinthien, a un sens moral, une convenance évidente pour trois usages différents.
Les Romains ont voulu créer un ordre qu’on appelle composite; en cela ils n’ont pas réussi, car les changements qu’ils ont cru faire au corinthien pour créer cet ordre composite ont abouti à quelques modifications insignifiantes; au contraire, ce que les Romains ont appelé dorique denticulaire se trouve être, à mon avis, une création qui leur appartient tout entière: le chapiteau avec quart de rond taillé d’oves est la plus distinguée de toutes les tentatives qui ont été faites pour créer un ordre, depuis les Grecs. Les annelets du filet, quelques rosaces dans le gorgerin, forment un composé eurythmique digne des Grecs, et qui mériterait le nom d’ordre romain, si la colonne n’eût été renflée outre mesure: sa place était entre le dorique et l’ionique.
Des essais ont été faits en France à plusieurs reprises pour créer un ordre français; les résultats furent infructueux, burlesques même. Perrault, qui a tenté le problème, échoua complètement. Sur un chapiteau corinthien, il avait travesti les feuilles d’acanthe en plumes de coq pour faire honneur à la Gaule; la fleur, en soleil, pour flatter le grand roi; les fleurs de lis, les colliers des différents ordres y figuraient aussi, afin que toutes les classes fussent intéressées dans l’ordre français. Une chose manquait, c’était l’ordre lui-même; il manquait les proportions fondamentales, il manquait la beauté, la nouveauté d’ensemble; et, comme il s’agissait d’un ordre nouveau, l’essentiel a manqué de toutes parts. Semblable aux Romains qui ont créé un chapiteau en croyant faire du dorique, Perrault a fait presque un ordre français sans le savoir par l’accouplement des colonnes; ce qui fut une charmante innovation.
J’ai la conviction que l’on peut encore faire de belles créations en architecture, mais vouloir de son vivant les embellir de la consécration des âges est une folle prétention, c’est croire qu’on peut donner à un enfant non-seulement l’expérience, mais les années d’un vieillard. Innover et sauf-garder l’innovation par le respect qu’inspire une antique origine, tel fut à la fois le calcul et l’écueil des innovateurs: ils pensaient naviguer sans quitter la terre ferme; ils espéraient découvrir l’île inconnue et y aborder sans oser sortir du continent.
Les architectes modernes ont un rôle important à remplir dans l’histoire de l’art: ils ont à créer trois ordres ayant un sens moral, une convenance d’actualité. Il s’agit de créer trois ordres de fer qui répondraient aux divers emplois de ce métal dans les nouvelles constructions, comme les ordres grecs correspondent à l’emploi de la pierre dans nos divers monuments.
Le sens moral de l’architecture ne peut se démontrer en tout par des exemples, puisqu’en plusieurs genres, la loi n’ayant pas été satisfaite, les exemples n’existent pas, et que les vrais modèles sont des raretés qui de temps à autre se dégagent des nuées du hasard dans le cours des siècles.