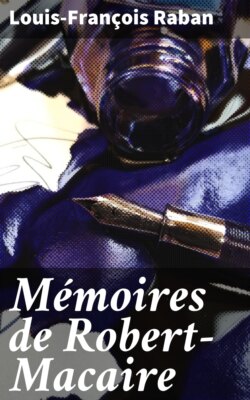Читать книгу Mémoires de Robert-Macaire - Louis-François Raban - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
FUITE
ОглавлениеTable des matières
Vingt-quatre heures avaient suffi pour me dégoûter de la marine en général, et, en particulier, du métier de mousse, auquel mon honoré père m’avait si libéralement destiné. Ce n’était pas que les travaux de cette profession me fussent pénibles; j’étais agile comme un écureuil, et je nageais comme un poisson; mais le biscuit, les coups de corde qu’on me distribuait avec un peu trop de générosité, et, par-dessus tout, l’idée d’être pendant des mois entiers emprisonné dans cette prison flottante qu’on appelle brick, tout cela me parut peu attrayant d’abord, puis horrible et insupportable.
Ainsi que je viens de le dire, vingt-quatre heures s’étaient écoulées depuis mon arrivée à bord de la Belle-Thérèse. Le jour allait finir; appuyé sur les bastingages du navire amarré vers le milieu du quai, je regardais tristement les passants, lorsque, tout à coup, j’aperçus Bertrand qui, à demi caché par les caisses de savon empilées près de là, me faisait signe de venir le joindre. D’un seul bond j’arrive sur le quai.
–Comment! capon! m’écriai-je en abordant Bertrand, tu m’as trahi pour me récompenser de ce que j’avais fait pour toi!…
–Ne te fâche pas, Robert. Tiens, je crois que si je n’étais pas parvenu à te revoir, j’en serais mort de chagrin. Ce n’est pas ma faute, vois-tu: ce vin m’avait rendu bête comme une oie, et j’ai parlé sans savoir ce que je disais.
–Et avec tout cela, me voilà mousse à bord de la Belle-Thérèse.
–Oui; mais tu es à terre pour le moment, et il n’y a personne, sur le pont, qui puisse nous voir.
Ces paroles furent pour moi un trait de lumière; ma résolution fut prise aussitôt.
–Bertrand! m’écriai-je; veux-tu me suivre?… nous irons à Paris. Dieu merci ci! je n’ai pas été aussi bête que toi, et j’ai sauvé mes trois écus. Partons.
Bertrand hésita; mais j’exerçais déjà un tel empire sur lui, qu’il lui fut impossible de résister.
Nous voilà donc arpentant le quai, passant hardiment devant la boutique de mon père, et montant la côte de Bon-Secours. Nous marchâmes ainsi pendant deux heures, sans faire la moindre halte, et presque sans nous parler. Cependant la nuit était devenue très sombre; nous apercevions à une certaine distance dans les terres, quelques lumières, et nous résolûmes de nous diriger de ce côté, pensant avec raison que la grande route était beaucoup moins sûre pour nous que les chemins de traverse. Arrivés au prochain village, nous soupâmes gaiement dans le premier cabaret borgne que nous rencontrâmes. Les maîtres de la maison furent d’abord surpris que des enfants de notre âge voyageassent seuls: six francs que je jetai sur la table levèrent tous les scrupules, et la nuit se passa très bien.
Le lendemain, nous nous remîmes en route; mais nous marchâmes avec beaucoup moins d’ardeur que la veille; avant midi, nous avions déjà déjeuné trois fois; à six heures du soir, nous avions fait quatre lieues, et deux de mes trois écus étaient dépensés. Mais nous étions si heureux; l’air de la liberté nous semblait si bon, et nous mangions de si grand appétit, qu’il nous était à peu près impossible de penser à autre chose.
Le troisième jour fut en tout semblable au second, avec cette différence pourtant que, vers le soir, il ne me restait pas un sou, et nous étions encore à vingt lieues de Paris!… Bertrand se mit à pleurer. Quant à moi, je songeai au plus pressé, qui était de trouver un gîte, et, grâce à quelque bon gros mensonge débité hardiment, j’obtins d’un fermier, pour moi et mon ami, la faveur de passer la nuit dans une grange, sur de la paille fraîche.
–Qu’allons-nous devenir? dit Bertrand quand il fit jour.
–J’y ai pensé, répondis-je: nous ne devons pas être éloignés d’un village appelé Doudeauville, dont mon oncle, le frère de ma mère, est le curé. Nous allons nous faire enseigner le chemin de ce village, et nous y rendre.
–Et que va-t-il nous dire, ton oncle?
–Je n’en sais rien; mais je suis sûr qu’il nous donnera à déjeuner, et je commence à avoir trop faim pour m’occuper d’autre chose.
Bertrand avait l’air bien piteux; il tremblait et pleurait en sortant de la grange; je ne pouvais parvenir à le rassurer. Ce brave garçon était alors ce qu’il a toujours été, fidèle, dévoué; mais peureux comme un lièvre.
Je ne m’étais pas trompé; le village de Doudeauville n’était qu’à une lieue de la ferme où nous avions passé la nuit, et c’était bien mon oncle, l’abbé Bouvard, qui en était le curé. Après une heure de marche, nous arrivâmes au presbytère.
–Que vas-tu dire à ton oncle? me demanda Bertrand.
–Ma foi, je lui dirai la vérité, seulement je mettrai des pièces de douze sous à la place des écus de six francs et j’augmenterai un peu la dose de coups de bâton que mon père m’a administrés.
Enfin, nous voici chez le bon curé, que j’avais vu une fois chez mon père, et qui me reconnut parfaitement. Ce brave homme répondit par une verte semonce au récit que je lui fis de notre escapade; je l’avais prévu, et cela ne m’affligea guère.
–Allons, Marie, dit-il en s’adressant à sa gouvernante, après la péroraison du discours dont il nous avait gratifiés, donnez à déjeuner à ces deux polissons: nous verrons ensuite ce que nous en ferons.
La bonne Marie ne se le fit pas répéter; nous fûmes servis en un clin d’œil, et une jolie petite fille de mon âge, à peu près, se mit à table avec nous. C’était la nièce de la gouvernante. Tant que dura le repas, cette charmante enfant ne cessa de s’occuper de moi: elle mettait sur mon assiette les plus belles poires, les plus grosses grappes de raisin, et elle me disait bien bas:
–Nous irons jouer dans le jardin, n’est-ce pas?.... Comment vous nommez-vous?
–Robert.
–Et moi je m’appelle Augustine.
–Et mon camarade se nomme Bertrand.
–Oh! ça m’est égal, je ne l’aime pas; il a l’air trop sournois.
Lorsque nous eûmes déjeuné, mon oncle m’adressa plusieurs questions auxquelles je répondis tant bien que mal; puis il me fit lire, écrire, et parut assez content de ce que je savais.
–On pourrait faire quelque chose de toi, me dit-il; mais ta mère, ma bonne sœur, ne peut pas te surveiller convenablement, et le séjour d’une grande ville n’est pas ce qu’il te faut. En conséquence, je vais écrire à ton père afin qu’il consente à te laisser passer quelques années ici; j’aurai soin de toi et je ferai ton éducation.
Vingt-quatre heures plus tôt, cet arrangement n’eût certainement pas été de mon goût; mais j’étais alors dans une disposition d’esprit tout à fait favorable aux projets de mon oncle; et puis, tandis que ce brave homme parlait, j’aperçus Augustine qui souriait, et dont les beaux yeux noirs semblaient me dire: «Quel bonheur! nous ne nous quitterons pas! Je remerciai donc mon bon oncle; je lui promis d’être toujours docile, respectueux, et de travailler de toutes mes forces pour mériter ses bontés. J’étais de bien bonne foi en faisant ces promesses, et je me trouvais si heureux, que j’avais complètement oublié ce pauvre Bertrand qui pleurait dans un coin.
–Ne te désole pas, mon garçon, lui dit le curé; j’ai aussi pensé à toi; je te renverrai à tes parents par le coche qui passe, après-demain, à un quart de lieue d’ici; mais auparavant je leur écrirai par la poste, et je suis sûr qu’ils te recevront bien.
Mais cette assurance ne pouvait consoler mon pauvre ami.
Il s’approcha de moi:
–Tu m’abandonnes donc, Robert? me dit-il d’une voix entrecoupée de sanglots.
–Dame! que veux-tu que je fasse? ne vaut-il pas mieux s’arranger de cette manière que d’aller mourir de faim sur la grande route?
–Ah!… oui… mais c’est toujours bien dur de se quitter comme ça. Et puis tu as toujours de si bonnes idées, toi, que nous aurions peut-être pu nous tirer d’affaire autrement, si tu l’avais voulu.
Bertrand avait raison; j’étais en ce moment un mauvais ami; mais la vue d’Augustine me subjugnait; il n’y avait que trois ou quatre heures que nous étions au presbytère, et ce lieu me semblait un véritable paradis terrestre où j’allais vivre de la vie des élus. Il fallut donc que le pauvre garçon montât tout seul dans le coche, quand l’heure fut venue. Nous nous embrassâmes en pleurant, mais une caresse d’Augustine eut bientôt séché mes larmes.