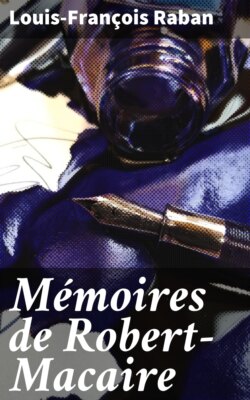Читать книгу Mémoires de Robert-Macaire - Louis-François Raban - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
DEUX PAS EN AVANT
ОглавлениеTable des matières
L’habitation de mon père se ressentait de son changement de fortune: il occupait une assez belle maison du faubourg Saint-Sever; il avait deux servantes, trois chevaux et un cabriolet; on faisait bonne chère tous les jours, et ma mère, à ce qu’il paraissait, s’était parfaitement accoutumée à ce genre de vie.
Je m’étais attendu à de graves reproches, sinon pendant le voyage, au moins lors de l’arrivée. Il n’en fut rien.
Le premier jour, on ne songea qu’à me bien traiter; dès le lendemain, on fit venir le tailleur afin qu’il montât ma garde-robe beaucoup trop modeste en raison de la fortune de monsieur le fournisseur des armées de la République.
–Çà, Robert, me dit mon père après quelques jours de repos, j’espère que tu ne penses plus à cette amourette que ton oncle s’est avisé de prendre au sérieux, comme n niais qu’il est?…... Tu es savant, bien taillé, et, de plus, ils unique d’un gaillard qui ne se laisserait pas couper es oreilles pour trois cent mille écus. Quand on part de à, il me semble qu’on peut aller où l’on veut, et j’ai nvie de te faire avocat pour commencer. Dans deux ours, nous partirons pour Paris où je te laisserai; je t’y erai cent louis de pension, afin que tu étudies vite et lien, et j’espère que tu nous feras honneur.
Faiblesse humaine! il n’en fallut pas davantage pour n’éblouir, pour me faire oublier le village où j’avais été i heureux, mes premières amours qui m’avaient semblé levoir être éternelles. Vivre à Paris avec cent louis de pension, quand on a l’âme ardente, les passions vives, et que l’on est arrivé à quinze ans sans avoir rien posédé, comment résister à une tentation si grande? Ma ésolution fut bientôt prise; je remerciai mon père, je ui promis de faire tout ce qu’il voudrait, et je me proposai d’oublier Augustine, ce à quoi je parvins bien plus promptement que je ne l’avais imaginé.
Nous voici à Paris. Mon père fait admirablement les choses: ma garde-robe est complétée, six mois de ma pension me sont comptés d’avance; je suis dans l’enchantement. Le citoyen Jérôme-Brutus Macaire n’était plus ce petit et ladre cabaretier du port de Rouen; c’était un personnage important, faisant sonner sur le pavé de la capitale les éperons de ses bottes à l’écuyère, dînant à la table du ministre de la guerre, et donnant vingt mille francs d’épingles à la maîtresse de ce dernier, pour avoir le droit d’en voler trois cent mille sur les fournitures à faire à l’armée de Sambre-et-Meuse.
Si l’on se forme vite, à Paris, c’est surtout lorsqu’on y arrive avec de l’argent, et les dispositions que j’apportais. Tandis que Jérôme-Brutus galopait vers l’armée de Sambre-et-Meuse, où il se rendait afin de s’assurer que les distributions s’y faisaient selon l’usage du temps, je faisais une foule de charmantes connaissances des deux sexes, et j’apprenais quantité de jolies choses, telles que la danse, l’escrime, le tir au pistolet, la prestidigitation, etc. Quant au droit, je m’en moquais comme de l’an quarante et j’étais bien résolu à ne point pâlir sur Cujas et Barthole.
Au nombre des bons amis que me valurent mon argent et l’excellent usage que j’en faisais, était un personnage qui demeurait dans la même maison que moi. Il disait être ancien officier et, bien qu’il eût l’air d’avoir fait toutes ses campagnes sur le pavé de Paris, il ne laissait pas de se plaindre amèrement de la parcimonie avec laquelle le gouvernement avait récompensé ses services; il connaissait, au moins de nom, tous les généraux en activité, et il en parlait comme d’anciens camarades à l’avancement desquels il disait avoir puissamment contribué. Grâce à cette jactance, à l’aplomb imperturbable qu’il possédait, il était reçu partout; il est vrai que la fureur du jeu était alors à son comble, et que le commandant Arnold (c’est ainsi qu’il se faisait appeler) jouait gros jeu et ne reculait devant aucune partie; mais je ne tardai pas à remarquer qu’il ne perdait jamais que les moins importantes. Ce personnage m’avait pris en amitié tout d’abord; mon air résolu lui plaisait. Il me présenta dans une foule de réunions, et ce fut lui qui me donna les premières leçons de prestidigitation.
J’étais bien jeune encore; mais j’étais grand, formé; un duvet noir très prononcé couvrait déjà ma lèvre supérieure. Je ne manquais pas d’adresse; j’étais doué d’une dextérité peu commune, et le commandant, enchanté de la manière dont je profitais de ses leçons, ne cessait de me répéter que, bientôt, tous les chemins me seraient ouverts et que je pourrais tout ce que je voudrais.
–Toutefois mon jeune ami, me disait-il un jour, il ne faut rien brusquer; mieux vaut atteindre le but que de le dépasser. Un homme capable use de sa supériorité et n’en abuse pas, et il arrive à la fin sans laisser voir les moyens qu’il emploie. Il ne vous manque rien, Robert, car vous joignez la force physique à la force morale. Et n’allez pas faire fi de cette force physique, mon jeune ami; ne dites pas, comme cette tourbe d’avortons, que la force physique ne signifie rien. «On ne se donne pas une large poitrine, des membres de gladiateur, des muscles herculéens», disent ces fantômes d’hommes.
Vraiment non, on ne se donne pas cela; mais se donne-t-on un esprit supérieur, une haute intelligence? Pas davantage. Il faut donc profiter de ces diverses facultés sans en être trop fier; marcher d’un pas ferme sans trop se presser, mettre les préjugés sous le pied, et passer sur le ventre aux imbéciles qui s’avisent de faire obstacle aux volontés d’hommes capables. Je vous le répète, mon cher ami, au point où vous en êtes, vouloir, c’est pouvoir.
–Parbleu! commandant, j’en suis enchanté. Ainsi il va me suffire de vouloir remplir ma bourse pour qu’elle cesse d’être vide, situation où elle se trouve depuis deux jours; ce qui est vraiment intolérable.
Le commandant fronça le sourcil, et cela me parut ne s’accorder guère avec ce qu’il venait de me dire.
–Diable! mon cher maître, repris-je, il paraît que vous avez horreur du vide.
–C’est que je sais, mon jeune ami, combien il est difficile de faire quelque chose avec rien... Mais remarquez, Robert, que je dis difficile, et non pas impossible… Ne vous reste-t-il absolument rien?
–Je ne possède pas un louis; mais mon père a si bien fait les choses jusqu’à présent, qu’il ne s’arrêtera pas, j’imagine, en si beau chemin, je me propose de lui écrire aujourd’hui même.
–Bien trouvé!… les livres de droit sont excessivement chers. vous suivez des cours particuliers, afin de vous pousser plus promptement… Vous êtes déjà fort avancé… etc…, etc. A la première lecture, le papa fait la grimace; à la seconde, la pilule lui semble moins amère, et, s’il arrive à la troisième, vous êtes sauvé.
J’écrivis donc au citoyen Jérôme-Brutus; la réponse ne se fit pas longtemps attendre.
«–Doucement, doucement, Robert, me disait mon honoré père. Diable! je veux bien faire un avocat, mais je ne veux pas me ruiner. Quand les affaires vont bien, je n’y regarde pas de si près; mais, depuis que je suis au quartier général, on dirait que tous ces gueux-là s’entendent pour me couper bras et jambes; les uns prétendent que je leur ai vendu des souliers de carton et des culottes de papier brouillard; les autres crient qu’ils sont las de manger du cheval pour du bœuf; et ce brutal de général en chef qui menace de me faire fusiller. Ce n’est pas tout. Le ministre m’écrit que: attendu les plaintes qui lui arrivent de toutes parts, il se trouve dans la nécessité de me rogner les ongles. Ainsi, pour peu que cela continue, nous serons obligés d’habiller ces animaux-là pour rien, et de les nourrir par-dessus le marché. Ce qui est certain, c’est que voici une campagne qui me coûtera cher. Heureuse-ment que je me suis associé avec l’ami Grandin, pour les vivres-viande de l’armée d’Italie, et j’espère que nous nous rattraperons sur les capucins. En attendant mon garçon, dépêche-toi de devenir avocat; car alors tu vendras tes paroles, et c’est une marchandise sur laquelle on ne risque pas de perdre.
Je t’envoie ci-joint un mandat de quatre cents francs sur l’ami Grandin; mais je te conseille de ne pas y revenir avant le semestre échu.»
Cette espèce de péroraison me fit passer sur l’exord; je courus chez mon ami Arnold, à qui je fis voir le mandat.
–Que pensez-vous de cela, mon cher commandant? lui dis-je.
Il jeta un seul coup d’œil sur le billet, et me répondit sans hésiter:
–Je pense, mon jeune ami, que le mot quatre cents commence la seconde ligne; que la première n’est pas tout à fait remplie, et qu’il ne faut que neuf lettres pour que ce mandat vaille cent louis.
–Je comprends, mon cher maître; mais la bouchée me paraît un peu forte!
–C’est que je ne vous prends pas pour une femmelette, Robert! Quand il s’agit de faire preuve d’audac e, il faut que cela en vaille la peine: les grands génies sont oseurs, et je crois que vous avez tout ce qu’il faut pour oser avec succès.
–J’oserai donc, dis-je avec résolution.
J’écrivis donc, sans trembler, deux mille, puis j’ajoutai un2au bon pour, et, deux heures après, le respectable associé de mon père me comptait cent louis.
–Eh bien! mon maître, dis-je au commandant en lui montrant la somme.
–Enfant! n’étais-je pas sûr du succès?… Je vous présenterai ce soir chez madame Darnière, une veuve charmante dont le salon est ouvert à la jeunesse dorée. Vous jouerez, Robert, et vous perdrez cinquante francs, d’abord. Mettez ces cartes dans vos poches; vous en userez lorsque vous me verrez porter la main à mon front, et je vous promets mille écus de bénéfice à la fin de la soirée.
Le premier pas était fait; mais alors qu’il ne l’eût pas été, j’avoue que je n’eusse pas reculé: j’avais déjà pour les hommes un mépris instinctif trop prononcé pour qu’il ne se manifestât point. Alors même que les leçons du commandant m’eussent manqué, le sentiment de ma valeur m’entraînait; mon mépris des hommes rejaillissait sur les choses, et je me disais que les lois et la morale, taillées à la hauteur de ces pygmées, ne devaient pas arrêter un gaillard de ma trempe.
Le soir vint. J’étais depuis une heure à une table de bouillotte, et, grâce au moyen de corriger la fortune, que le commandant m’avait enseigné, j’avais presque triplé mon argent, lorsqu’un des joueurs, qui perdait le plus, se leva tout à coup et s’écria en m’adressant la parole:
–Vous êtes un misérable! Voilà deux fois que vous faites sauter la coupe!…
Le commandant pâlit, son visage se décomposa; je crus qu’il allait tomber. Quant à moi, je me levai gravement, et, tandis que d’une main je souffletais mon adversaire, de l’autre, je jetais les cartes dans le feu…, On nous sépara. Rendez-vous fut assigné pour le lendemain et je sortis, emmenant avec moi le commandant qui semblait encore douter du témoignage de ses yeux.
–Robert, me dit-il quand nous fûmes dehors, je ne suis plus votre maître, c’est vous qui êtes le mien; il est bien malheureux que vous n’ayez pas maintenant douze heures à vivre!
–Allons donc, mon vieil ami! est-il possible que la peur vous trouble à ce point le cerveau?… que diable allez-vous me faire penser de mon courage?… est-ce que je ne mets pas une balle sur mouche, à vingt-cinq pas? est-ce que je n’ai pas toujours ce bon poignet que vous savez, et pour lequel une épée pèse moins qu’une plume?
–Je sais tout cela, mon pauvre ami, et cependant votre adversaire vous tuera: vous l’avez frappé; il devra tirer le premier, et je l’ai vu cent fois moucher une chandelle, à vingt pas, avec ses pistolets.
–Ainsi, il n’y a pas de chance pour moi?
–Aucune.
–Alors je ne me battrai pas.
–Impossible, mon ami.
–Oh! oh! maître Arnold, il me semblait que nous avions mis le préjugé sous le pied.
–Sans doute, mon ami; aussi, pour mon compte, vous approuverais-je fort de ne pas jeter votre vie comme un sot; mais il s’agit de ce qu’on pensera de vous dans le monde, et non de ce que j’en penserai moi-même si vous refusez de vous battre, vous ne pourrez désormais vous présenter nulle part; on vous montrera au doigt; tous les lâches vous insulteront pour se consoler de n’avoir pas de cœur. Vous aurez cinquante affaires au lieu d’une, et vous ne rétablirez pas votre réputation.
–Ainsi, commandant, il faut que je me fasse tuer ou que je pourrisse dans l’obscurité? Vous croyez qu’il n’est pas possible de sortir de cette alternative?
–Il n’y a pas de terme moyen.
–Alors, commandant, vous aviez raison tout à l’heure; vous n’êtes plus mon maître, et je puis devenir le vôtre, car, bien certainement, je sortirai de là autrement que vous ne l’imaginez. Qui veut la fin, veut les moyens, et tous les moyens sont bons quand ils conduisent au but; c’est vous qui m’avez enseigné cela, et puisque j’ai adopté ce principe, je ne reculerai pas devant ses conséquences. Bonsoir, maître Arnold, je vais dormir pour me rafraîchir le sang. Je ne mourrai pas demain, et je retournerai chez madame Darnière quand il me plaira.
Nous rentrâmes à l’hôtel, et le commandant me quitta en hochant la tête avec un certain air d’incrédulité peu propre à me rassurer si j’avais ressenti de la crainte; mais, depuis quelques heures, il me semblait que j’avais grandi de deux pieds en caressant, de la main, l’or qui remplissait mes poches. Je sentais augmenter ma confiance en moi-même, et, bien que je n’eusse rien imaginé pour sortir convenablement de l’espèce de mauvais pas où je me trouvais, je n’en fus pas moins bercé toute la nuit par les songes les plus riants.