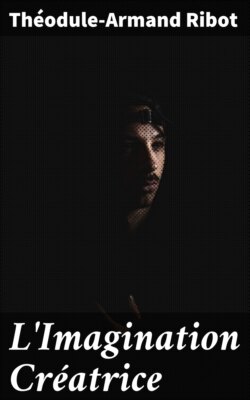Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Considérée sous son aspect intellectuel, c’est-à-dire en tant qu’elle emprunte ses éléments à la connaissance, l’imagination suppose deux opérations fondamentales : l’une négative et préparatoire, la dissociation ; l’autre positive et constituante, l’association.
La dissociation est l’abstraction des anciens psychologues qui ont très bien compris son importance pour le sujet qui nous occupe. Toutefois, ce terme « dissociation » me semble préférable parce qu’il est plus compréhensif. Il désigne un genre dont l’abstraction est une espèce. C’est une opération spontanée et d’une nature plus radicale : l’abstraction proprement dite n’agit que sur des états de conscience isolés ; la dissociation agit en sus sur des séries d’états de conscience qu’elle morcelle, fractionne, dissout et, par ce travail préparatoire, les rend propres à entrer dans des combinaisons nouvelles.
Percevoir est une opération synthétique et cependant la dissociation (ou abstraction) est déjà en germe dans la perception, justement parce qu’elle est un état complexe. Chacun perçoit d’une façon particulière, suivant sa constitution et l’impression du moment. Un peintre, un sportsman, un marchand, un indifférent, ne voient pas le même cheval de la même manière ; les qualités qui intéressent l’un sont négligées par un autre.
L’image étant une simplification des données sensorielles et sa nature dépendant de celle des perceptions antérieures, il est inévitable que ce travail de dissociation continue en elle. Mais, c’est trop peu dire : l’observation et l’expérience nous montrent que, dans la majorité des cas, il augmente singulièrement. Pour suivre le développement progressif de cette dissolution, nous pouvons diviser grossièrement les images en trois catégories — complètes, incomplètes, schématiques — et les étudier successivement.
Le groupe des images dites complètes comprend d’abord les objets sans cesse répétés dans l’expérience quotidienne : mon encrier, la figure de ma femme, le son d’une cloche ou d’une horloge voisine, etc. Dans cette catégorie rentrent aussi les images des choses que nous n’avons perçues qu’un petit nombre de fois, mais qui, pour des raisons accessoires, sont restées nettes dans notre mémoire. Sont-elles complètes au sens rigoureux du mot ? Elles ne peuvent l’être ; et la supposition contraire est une illusion de la conscience qui se détruit, lorsqu’on la confronte avec la réalité. La représentation peut moins encore que la perception renfermer toutes les qualités d’un objet ; elle est une sélection variable suivant les cas. Le peintre Fromentin qui se vantait de retrouver après deux ou trois ans « le souvenir rigoureux » de choses qu’il avait à peine entrevues en voyage, fait pourtant ailleurs l’aveu suivant : « Mon souvenir des choses, quoique très fidèle, n’a jamais la certitude admissible pour tous d’un document. Plus il s’affaiblit, plus il se transforme en devenant la propriété de ma mémoire et mieux il vaut pour l’emploi que je lui destine. À mesure que la forme exacte s’altère, il en vient une autre, moitié réelle et moitié imaginaire, que je crois préférable ». Remarquons que celui qui parle ainsi est un peintre, doué d’une rare mémoire visuelle ; mais des recherches récentes ont montré que, chez le commun des hommes, les images réputées complètes et exactes subissent des transformations et déformations. On le constate, lorsque après quelque temps, on est mis en présence de l’objet primitif et que la comparaison entre le réel et sa représentation devient possible[3]. Remarquons que dans ce groupe, l’image correspond toujours à des objets particuliers, individuels ; il n’en est pas de même pour les deux autres.
Le groupe des images incomplètes, selon le témoignage de la conscience elle-même, provient de deux sources distinctes : d’abord, des perceptions insuffisantes ou mal fixées ; ensuite des impressions d’objets analogues qui, trop souvent répétées, finissent par se confondre. Ce dernier cas a été très bien décrit par Taine. Un homme, dit-il, qui, ayant parcouru une allée de peupliers, veut se représenter un peuplier, ou, ayant regardé une basse-cour, veut se représenter une poule, éprouve un embarras : ses différents souvenirs se recouvrent. L’expérience devient une cause d’effacement ; les images s’annulant l’une l’autre tombent à l’état de tendances sourdes que leur contrariété et leur égalité empêchent de prendre l’ascendant. « Les images s’émoussent par leurs conflits comme les corps par leur frottement[4]. »
Ce groupe nous conduit à celui des images schématiques, totalement dépourvues de marques individuelles : la représentation vague d’un rosier, d’une épingle, d’une cigarette, etc. C’est le degré extrême de l’appauvrissement : l’image dépouillée peu à peu de ses caractères propres, n’est plus qu’une ombre. Elle est devenue cette forme de transition entre la représentation et le pur concept, que l’on désigne actuellement sous le nom d’image générique, ou qui du moins s’en rapproche.
L’image est donc soumise à un travail incessant de métamorphose, de suppressions et d’additions, de dissociation et de corrosion. C’est qu’elle n’est pas une chose morte ; elle ne ressemble pas à un cliché photographique dont on peut indéfiniment reproduire des copies. Dépendante de l’état du cerveau, elle change comme tout ce qui est vivant, elle est sujette à des gains et à des pertes, — surtout à des pertes. Mais chacune des trois classes précitées a son utilité pour l’inventeur ; elles servent de matériaux aux diverses espèces d’imagination : sous leur forme concrète au mécanicien, à l’artiste ; sous leur forme schématique au savant et à d’autres.
Jusqu’ici nous n’avons vu qu’une partie du travail de la dissociation et, à tout prendre, la moindre. Nous avons semblé considérer les images comme des faits isolés, des atomes psychiques ; mais c’est là une position purement théorique. Les représentations ne sont pas solitaires ; dans la réalité, elles font partie d’une chaîne ou plutôt d’une trame, d’un réseau, puisqu’en raison de leurs multiples rapports, elles peuvent rayonner en tous sens. Or, la dissociation agit aussi sur les séries, les tronque, les mutile, les démolit, les réduit à l’état de ruine.
La loi idéale de la réviviscence des images est celle connue depuis Hamilton sous le nom de « loi de réintégration »[5] qui consiste dans le passage de la partie au tout, chaque élément tendant à reproduire l’état complet, chaque membre d’une série la totalité de la série. Si cette loi existait seule, l’invention nous serait à jamais interdite ; nous ne pourrions sortir de la répétition, nous serions emprisonnés dans la routine ; mais il y a une puissance antagoniste qui nous affranchit : c’est la dissociation.
Il est assez étrange que tandis que les psychologues étudient depuis si longtemps les lois de l’association, nul n’ait recherché si l’opération inverse, la dissociation, n’a pas aussi ses lois. On ne peut tenter ici un pareil travail qui serait en dehors de notre sujet ; il suffira d’indiquer en passant deux conditions générales qui déterminent la dissociation des séries.
1º Il y a les causes internes ou subjectives. La réviviscence d’une figure, d’un monument, d’un paysage, d’un événement n’est le plus souvent que partielle. Elle dépend de conditions diverses qui ravivent l’essentiel et laissent tomber les détails secondaires, et cet essentiel qui survit à la dissociation dépend de causes subjectives dont les principales sont d’abord des raisons pratiques, utilitaires. C’est la tendance déjà mentionnée à négliger ce qui ne sert pas, à l’exclure de la conscience. Helmholtz a montré que, dans l’acte de la vision, divers détails restent inaperçus, parce qu’ils sont indifférents pour les besoins de la vie, et il y a beaucoup d’autres cas de cette espèce. — Ensuite des raisons affectives qui gouvernent l’attention et l’orientent dans une direction exclusive ; elles seront étudiées dans la suite de cet ouvrage. — Enfin des raisons logiques ou intellectuelles, en désignant sous ce nom la loi d’inertie mentale ou loi du moindre effort, par laquelle l’esprit tend vers la simplification et l’allègement de son travail.
2º Il y a les causes externes ou objectives qui sont les variations dans l’expérience. Lorsque deux ou plusieurs qualités ou événements sont donnés comme constamment associés, on ne les dissocie pas. L’uniformité des lois de la nature est le grand antagoniste de la dissociation. Bien des vérités (par exemple, l’existence des antipodes), se sont imposées difficilement, parce qu’il fallait briser des associations indissolubles. Le roi oriental dont parle J. Sully, qui n’avait jamais vu de glace, refusait d’admettre une eau solide. « Une impression totale dont les éléments ne nous auraient jamais été donnés à part dans l’expérience, serait réfractaire à l’analyse. Si tous les objets froids étaient humides et tous les objets humides froids ; si tous les liquides étaient transparents et si aucun objet non liquide n’était transparent, nous aurions beaucoup de peine à distinguer le froid de l’humide et la liquidité de la transparence ». Tout au contraire, ajoute W. James, « ce qui a été associé tantôt à une chose, tantôt à une autre, tend à se dissocier des deux.... ; c’est ce qu’on pourrait appeler une loi de dissociation par variations concomitantes[6] ».
Pour bien comprendre la nécessité absolue de la dissociation, remarquons que la réintégration totale est, par nature, un obstacle à la création. On cite des gens qui peuvent facilement retenir vingt ou trente pages d’un livre ; mais s’ils ont besoin d’un passage, ils ne peuvent l’extraire ; ils doivent reprendre dès le commencement et poursuivre jusqu’à l’endroit requis, en sorte que cette extrême facilité à retenir devient un sérieux inconvénient. Sans parler de ces cas rares, on sait que les gens ignorants et bornés font de chaque événement un récit invariable, toujours le même, où tout est sur le même plan, l’important et l’accessoire, l’utile et l’inutile : ils ne font grâce d’aucun détail ; ils sont incapables de trier. Les esprits de cette trempe sont impropres à l’invention. — On peut dire plus brièvement qu’il y a deux sortes de mémoire. L’une complètement systématisée (habitudes, routine, poésie ou prose apprise par cœur, exécution musicale impeccable, etc.), elle forme bloc et est inapte à entrer dans des combinaisons nouvelles. L’autre non systématisée, c’est-à-dire formée de petits groupes plus ou moins cohérents : celle-ci est plastique et apte à entrer dans des combinaisons nouvelles.
Nous n’avons énuméré que les causes spontanées, naturelles, de dissociation, omettant les causes volontaires et artificielles qui ne sont que l’imitation des premières. Par l’effet de ces diverses causes, les images et les séries sont morcelées, fragmentées, mises en pièces, mais d’autant plus propres à servir de matériaux à l’inventeur. C’est un travail analogue à celui qui, en géologie, produit de nouveaux terrains par l’usure des vieilles roches.