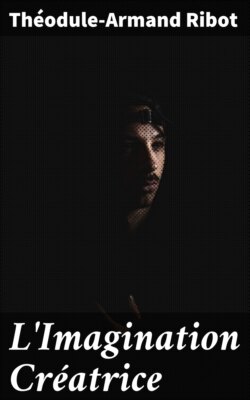Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
On a dit plus haut que la loi idéale et théorique de la réviviscence des images est celle de réintégration complète : par exemple, se rappeler tous les incidents d’un long voyage dans leur ordre chronologique, sans additions ni omissions. Mais cette formule exprime ce qui doit être, non ce qui est. Elle suppose l’homme réduit à l’état d’intelligence pure et à l’abri de tout élément perturbateur ; elle convient aux formes de la mémoire complètement systématisées, figées en routine et en habitude ; mais en dehors de ces cas, elle reste une conception abstraite.
À cette loi d’une valeur platonique s’oppose la loi réelle et pratique qui régit en fait la réviviscence des images. On l’a appelée avec raison la « loi d’intérêt » ou loi affective et on peut la formuler ainsi : Dans tout événement passé, les parties intéressantes se ravivent seules ou avec plus d’intensité que les autres. Intéressante signifie ce qui nous touche en quelque manière, sous une forme agréable ou pénible. Remarquons que l’importance de ce fait a été signalée non par les associationistes (on devait s’y attendre), mais par des écrivains moins systématiques, étrangers à cette école : Coleridge, Shadworth Hodgson, avant eux Schopenhauer. W. James l’appelle la « loi ordinaire » ou mixte d’association[11]. Sans doute, la « loi d’intérêt » est moins précise que les lois intellectuelles de contiguïté et de ressemblance. Toutefois elle semble pénétrer davantage dans les raisons dernières. Si, en effet, dans le problème de l’association, on distingue ces trois choses : — les faits, les lois, les causes — la loi pratique nous rapproche plus des causes.
Quoi qu’il en soit sur ce point, le facteur émotionnel crée des combinaisons nouvelles par plusieurs procédés.
Il y a les cas ordinaires, simples, à base affective naturelle, dépendant des dispositions momentanées. Ils consistent en ce que des représentations qui ont été accompagnées d’un même état affectif, tendent à s’associer ultérieurement : la ressemblance affective réunit et enchaîne des représentations disparates. Ceci diffère de l’association par contiguïté qui est une répétition de l’expérience et de l’association par ressemblance au sens intellectuel. Les états de conscience se combinent non parce qu’ils ont été donnés ensemble antérieurement, non parce que nous percevons entre eux des rapports de ressemblance, mais parce qu’ils ont un ton affectif commun. La joie, la tristesse, l’amour, la haine, l’admiration, l’ennui, l’orgueil, la fatigue, etc., peuvent devenir un centre d’attraction qui groupe des représentations ou événements sans rapports rationnels entre eux, mais qui ont la même marque émotionnelle : joyeuse, mélancolique, érotique, etc. Cette forme d’association est très fréquente dans les rêves et la rêverie, c’est-à-dire dans un état d’esprit où l’imagination jouit de sa pleine liberté et travaille au hasard. — On comprend aisément que cette influence, franche ou latente, du facteur émotionnel doit faire surgir des groupements tout à fait inattendus et offre un champ presque illimité aux combinaisons nouvelles, le nombre des images qui ont une empreinte affective commune étant très grand.
Il y a les cas rares, extraordinaires, à base affective exceptionnelle. Telle est l’audition colorée. On sait que plusieurs hypothèses ont été émises sur l’origine de ce phénomène : — embryologique, il serait le résultat d’une différenciation incomplète entre le sens de la vue et celui de l’audition et la survivance, dit-on, d’une époque lointaine où dans l’humanité cet état aurait été la règle ; — anatomique, supposant des anastomoses entre les centres cérébraux des sensations visuelles et auditives ; — physiologique ou de l’irradiation nerveuse ; — psychologique ou de l’association. Cette dernière hypothèse paraît convenir au plus grand nombre de cas, sinon à tous ; mais, comme Flournoy l’a observé, il s’agit d’une association « affective ». Deux sensations absolument hétérogènes (comme la couleur bleue et le son i) peuvent se ressembler par le retentissement commun qu’elles ont dans l’organisme de quelques privilégiés, et ce facteur émotionnel devient un lien d’association. Remarquons que cette hypothèse explique aussi les cas beaucoup plus rares d’olfaction, de gustation, de douleurs colorées, c’est-à-dire une association anormale entre les couleurs déterminées et des saveurs, odeurs, douleurs déterminées.
Quoiqu’on ne les rencontre que par exception, ces modes d’association affective sont accessibles à l’analyse, même clairs, presque palpables, si on les compare à d’autres cas subtils, raffinés, à peine saisissables dont l’origine se laisse soupçonner, supposer plutôt que comprendre. C’est d’ailleurs un mode d’imagination propre à peu de gens : certains artistes et quelques excentriques ou déséquilibrés. Ils ne se trouvent guère hors de la vie esthétique ou pratique. Je veux parler de ces formes de l’invention qui n’admettent que des conceptions fantastiques, d’une étrangeté poussée à l’aigu (Hoffmann, Poë, Baudelaire, Goya, Wiertz, etc.) ou des sentiments surprenants, extraordinaires, inconnus du reste des hommes (les symbolistes et décadents qui fleurissent actuellement dans les divers pays d’Europe et d’Amérique et qui, à tort ou à raison, croient préparer l’esthétique de l’avenir). Il faut admettre ici une manière de sentir toute spéciale, dépendant du tempérament d’abord et que beaucoup cultivent et raffinent comme une précieuse rareté. Là est la vraie source de leur invention. Sans doute pour l’affirmer pertinemment, il faudrait pouvoir établir les rapports directs de leur constitution physique et psychique et de leur œuvre ; noter même les dispositions particulières au moment de la création. Du moins, il me semble clair que la nouveauté, l’étrangeté des combinaisons, par son caractère de profonde subjectivité, indique une origine émotionnelle plutôt qu’intellectuelle. Ajoutons, sans insister, que ces manifestations anormales de l’imagination créatrice sont du ressort de la pathologie plus que de la psychologie.
L’association par contraste est, de sa nature, vague, arbitraire, indéterminée. Elle repose, en effet, sur une conception essentiellement subjective et fuyante, celle de contraire, qu’il est presque impossible de fixer scientifiquement ; car le plus souvent les contraires n’existent que par nous et pour nous. On sait que cette forme d’association n’est pas primaire et irréductible. Elle est ramenée par quelques-uns à la contiguïté, par la plupart à la ressemblance. Les deux opinions ne me semblent pas inconciliables. Dans l’association par contraste, on peut distinguer deux couches. L’une, superficielle, est faite de contiguïté : nous avons tous dans la mémoire des couples associés tels que grand-petit, riche-pauvre, haut-bas, droite-gauche, etc., qui résultent de la répétition et de l’habitude. L’autre, profonde, est faite de ressemblance : le contraste n’existe que là où une commune mesure est possible entre les deux termes. Comme le remarque Wundt un mariage peut faire penser à un enterrement (union et séparation des conjoints) mais non à un mal de dent. Il y a contraste entre des couleurs, contraste entre des sons, mais non entre un son et une couleur, à moins qu’il n’y ait un fond commun auquel on les rapporte, comme dans les cas cités plus haut d’audition colorée. Dans l’association par contraste, il y a des éléments conscients qui s’opposent l’un à l’autre et au-dessous un élément, inconscient, la ressemblance — non perçue clairement et logiquement, mais sentie — qui évoque et rapproche les éléments conscients.
Que cette interprétation soit exacte ou non, remarquons que l’association par contraste ne pouvait être omise, parce que son mécanisme plein d’imprévu se prête facilement aux rapprochements nouveaux. D’ailleurs, je ne prétends pas qu’elle est tout entière sous la dépendance du facteur émotionnel ; mais comme le fait observer Höffding, « le propre de la vie affective est de se mouvoir entre les contraires ; elle est déterminée tout entière par la grande opposition entre le plaisir et la douleur ; aussi les effets de contraste sont-ils bien plus forts que dans le domaine des sensations[12] ». Cette forme d’association prédomine dans les créations esthétiques et mythiques, c’est-à-dire de la libre fantaisie ; elle s’efface dans les formes précises de l’invention pratique, mécanique, scientifique.