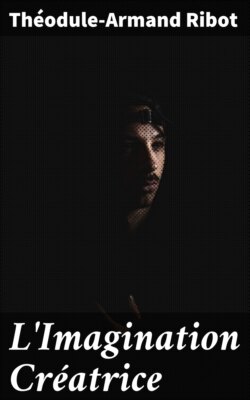Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
On a souvent répété que l’une des principales conquêtes de la psychologie contemporaine est d’avoir établi solidement le rôle et l’importance des mouvements, d’avoir montré notamment par l’observation et l’expérience que la représentation d’un mouvement est un mouvement qui commence, un mouvement à l’état naissant. Toutefois, ceux qui ont le plus fortement insisté sur cette thèse, ne sont guère sortis du champ de l’imagination passive ; ils s’en sont tenus à des faits de pure reproduction. Mon but est d’étendre leur formule et de montrer qu’elle explique, au moins en grande partie, la genèse de l’imagination créatrice.
Essayons de suivre pas à pas la transition qui conduit de la reproduction pure et simple à la création, en montrant la persistance et la prépondérance de l’élément moteur à mesure qu’on s’élève de la répétition à l’invention.
D’abord, toutes les représentations renferment-elles des éléments moteurs ? Oui, selon moi, parce que toute perception suppose des mouvements à un degré quelconque et que les représentations sont les résidus des perceptions antérieures. Sans examiner la question en détail, il est certain que cette affirmation est légitime pour l’immense majorité des cas. En ce qui concerne les images visuelles et tactiles, il n’y a aucun doute possible sur l’importance des éléments moteurs qui entrent dans leur composition. L’ouïe, pour un sens supérieur, est assez pauvrement dotée de mouvements ; mais si l’on tient compte de sa connexion intime avec les organes vocaux si riches en combinaisons motrices, il s’établit une sorte de compensation. L’olfaction et la gustation, secondaires dans la psychologie humaine, montent à un rang très élevé chez beaucoup d’animaux : aussi l’appareil olfactif acquiert chez eux une complexité de mouvements proportionnée à son importance et qui parfois le rapproche de la vision. Reste le groupe des sensations internes qui pourrait provoquer la discussion. En mettant à part les impressions obscures qui sont liées aux actions chimiques de l’intimité des tissus et qui sont à peine représentables, on constate que les sensations qui résultent des changements de la respiration, de la circulation, de la digestion, ne sont pas vides d’éléments moteurs. Le seul fait que, chez quelques personnes, le vomissement, le hoquet, la miction, etc., peuvent être déterminés par les perceptions de la vue ou de l’ouïe, prouve que les représentations de cette espèce tendent à se traduire en actes.
Sans insister, on peut donc dire que cette thèse repose sur une masse imposante de faits ; que l’élément moteur de l’image tend à lui faire perdre son caractère purement intérieur, à l’objectiver, à l’extérioriser, à la projeter hors de nous.
Cependant, il faut remarquer que tout ce qui précède ne nous fait pas sortir de l’imagination reproductrice, de la mémoire. Toutes ces réviviscences sont des répétitions ; or, l’imagination créatrice exige du nouveau : c’est sa marque propre et essentielle. Pour saisir le passage de la reproduction à la production, de la répétition à la création, il faut considérer d’autres faits plus rares, plus extraordinaires qui ne se rencontrent que chez quelques privilégiés. Ces faits connus depuis longtemps, entourés de quelque mystère et attribués d’une manière vague « à la puissance de l’imagination », ont été étudiés de nos jours avec beaucoup plus de méthode et de rigueur. Il suffit à notre but d’en rappeler quelques-uns.
On rapporte beaucoup d’exemples de fourmillements ou de douleurs qui apparaissent dans diverses régions du corps par le seul effet de l’imagination. Certaines personnes peuvent accélérer ou ralentir les battements de leur cœur à volonté, c’est-à-dire par l’effet d’une représentation intense et persistante : le célèbre physiologiste E. F. Weber avait ce pouvoir et a décrit le mécanisme du phénomène. Plus extraordinaires encore sont les cas de vésication produits par suggestion chez les hypnotisés. Enfin, rappelons l’histoire retentissante des stigmatisés qui, du xiiie siècle jusqu’à nos jours, ont été assez nombreux et présentent des variétés intéressantes : les uns n’ayant que la marque du crucifiement, d’autres de la flagellation, d’autres de la couronne d’épines[1]. Ajoutons les modifications profondes de l’organisme, résultats de la thérapeutique suggestive des contemporains ; les effets merveilleux de « la foi qui guérit », c’est-à-dire les miracles de toutes les religions, dans tous les temps et dans tous les lieux ; et cette brève énumération suffira à rappeler certaines créations de l’imagination humaine qu’on a une tendance à oublier.
Il convient d’ajouter que l’image n’agit pas seulement sous une forme positive, elle a quelquefois un pouvoir d’inhibition. La représentation vive d’un mouvement qui s’arrête est un commencement d’arrêt de mouvement ; elle peut même aboutir à un arrêt total. Tels sont les cas de paralysis by ideas décrits d’abord par Reynolds, plus tard par Charcot et son école sous le nom de paralysie psychique : la conviction intime du malade qu’il ne peut remuer un membre le rend incapable de tout mouvement et il ne recouvre sa puissance motrice que lorsque la représentation morbide a disparu.
Ces faits et leurs analogues suggèrent quelques remarques.
La première, c’est qu’il y a ici création, au sens strict du mot, quoiqu’elle soit renfermée dans les limites de l’organisme. Ce qui apparaît est nouveau. Si l’on peut soutenir à la rigueur que nous connaissons par notre expérience les formications, les accélérations et ralentissements du cœur, quoique nous ne puissions pas ordinairement les produire à volonté ; cette thèse est absolument insoutenable, quand il s’agit de vésication, de stigmates et autres phénomènes réputés miraculeux : ils sont sans précédents dans la vie de l’individu.
La seconde remarque, c’est que pour que ces états insolites se produisent, il y a nécessité d’éléments additionnels dans le mécanisme producteur. Dans son fond, ce mécanisme est fort obscur. Invoquer la puissance de l’imagination, c’est tout simplement substituer un mot à une explication. Heureusement, nous n’avons pas besoin de pénétrer dans l’intimité de ce mystère. Il nous suffit de constater les faits, de constater aussi qu’ils ont une représentation pour point de départ, de constater enfin que la représentation toute seule ne suffit pas. Que faut-il donc de plus ? — Notons d’abord que ces événements sont rares. Il n’est pas à la portée de tout le monde d’acquérir des stigmates ou de guérir d’une paralysie déclarée incurable. Cela n’arrive qu’à ceux qui ont une foi ardente, un désir violent que cela soit : c’est une condition psychique indispensable. Ce qui agit, en pareil cas, c’est un état non simple mais double : une image et en sus un état affectif particulier (désir, aversion, émotion ou passion quelconque). En d’autres termes, il y a deux cas :
Dans le premier, ce qui agit ce sont les éléments moteurs inclus dans l’image, résidus des perceptions antérieures ;
Dans le second, ce qui agit ce sont les éléments précités, plus des états affectifs, des tendances qui résument l’énergie de l’individu ; et c’est ce qui explique leur puissance.
Pour conclure, ce groupe de faits nous révèle au delà des images l’existence d’un autre facteur, à forme instinctive ou affective, que nous aurons à étudier plus tard et qui nous conduira à la source dernière de l’imagination créatrice.
Je crains que, entre les faits ci-dessus énumérés et l’imagination créatrice proprement dite, la distance ne paraisse énorme au lecteur. Pourquoi ? D’abord, parce que la création a ici pour unique matière l’organisme et parce qu’elle ne se sépare pas du créateur. Ensuite, parce que ces faits sont d’une extrême simplicité et que l’imagination créatrice (au sens ordinaire) est d’une extrême complexité. Ici, une seule cause opérante : une représentation plus ou moins complexe. Dans la création imaginative, plusieurs images coopérantes avec combinaisons, coordination, agencement, groupement. Mais il ne faut pas oublier que notre but actuel est simplement de découvrir une « forme de passage[2] » entre la reproduction et la production ; de montrer la communauté d’origine des deux formes d’imagination — la pure faculté représentative et la faculté de créer par l’intermédiaire des images — et de montrer en même temps le travail de séparation, de disjonction entre les deux.