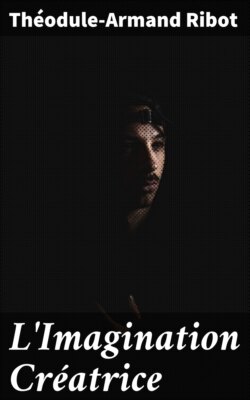Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
Jusqu’ici nous n’avons considéré le facteur émotionnel que sous un seul aspect — affectif pur — celui qui se révèle à la conscience sous une forme agréable, désagréable ou mixte ; mais les sentiments, émotions et passions renferment des éléments plus profonds — moteurs, c’est-à-dire impulsifs ou inhibitoires — que nous devons négliger d’autant moins que c’est dans les mouvements que nous cherchons l’origine de la création imaginative. Cet élément moteur est celui que la langue courante et même quelquefois les traités de psychologie désignent sous les noms d’« instinct créateur », d’« instinct de l’invention » ; ce qu’on exprime encore en disant que les créateurs sont des « instinctifs » et « sont poussés comme l’animal à accomplir certains actes ».
Si je ne me trompe, cela signifie que « l’instinct de la création » existe chez tous les hommes à quelque degré : faible chez les uns, saisissable chez d’autres, éclatant chez les grands inventeurs.
Or, je n’hésite pas à soutenir que l’instinct créateur, pris en ce sens strict, assimilé aux instincts des animaux, est une pure métaphore, une entité réalisée, une abstraction. Il y des besoins, appétits, tendances, désirs communs à tous les hommes qui, chez un individu donné, à un moment donné, peuvent aboutir à une création ; mais il n’y a pas une manifestation psychique spéciale qui soit l’instinct créateur. En effet, que serait-il ? Chaque instinct a son but propre : la faim, la soif, le sexe, les instincts spécifiques de l’abeille, de la fourmi, du castor, de l’araignée consistent en un groupe de mouvements adaptés à une fin déterminée, toujours la même. Or, que serait un instinct créateur en général qui, par hypothèse, produirait tour à tour un opéra, une machine, une théorie métaphysique, un système financier, un plan de campagne militaire et ainsi de suite ? C’est une pure chimère. L’invention n’a pas une source, mais des sources.
Considérons, de notre point de vue actuel, la dualité humaine, l’homo duplex :
Supposons l’homme réduit à l’état de pure intelligence, c’est-à-dire capable de percevoir, se souvenir, associer, dissocier, raisonner et rien de plus : toute création est impossible, parce qu’il n’y a rien qui la sollicite.
Supposons l’homme réduit aux manifestations organiques. Il n’est plus qu’un faisceau de besoins, d’appétits, de tendances, d’instincts, c’est-à-dire de manifestations motrices : forces aveugles qui, faute d’un organe cérébral suffisant, ne créeront rien.
La coopération de ces deux facteurs est indispensable ; sans l’un rien ne commence, sans l’autre rien n’aboutit ; et, bien que je soutienne que c’est dans les besoins qu’il faut chercher la cause première de toutes les inventions, il est clair que l’élément moteur ne suffit pas. Si les besoins sont forts, énergiques, ils peuvent déterminer une création, ou avorter si le facteur intellectuel est insuffisant. Beaucoup désirent trouver et ne trouvent rien. Un besoin aussi banal que la faim ou la soif suggère à l’un quelque moyen ingénieux de le satisfaire ; un autre reste totalement dépourvu.
En somme, pour qu’une création se produise, il faut d’abord qu’un besoin s’éveille, ensuite qu’il suscite une combinaison d’images, enfin qu’il s’objective et se réalise sous une forme appropriée.
Nous essaierons plus tard (dans la Conclusion) de répondre à cette question : pourquoi est-on imaginatif ? Posons, en passant, la question inverse. — On peut avoir dans l’esprit un trésor inépuisable de faits et d’images et ne rien créer. Exemple : les grands voyageurs qui ont beaucoup vu et entendu et qui ne tirent de leur expérience que quelques récits décolorés ; les hommes mêlés à de grands événements politiques ou aventures militaires, qui ne laissent que des mémoires secs et froids ; les prodiges de lecture, encyclopédies vivantes, qui restent accablés sous le poids de leur érudition. — D’un autre côté, il y a les gens faciles à émouvoir ou à agir, mais bornés, dénués d’images et d’idées. Leur indigence intellectuelle les condamne à la stérilité : cependant, plus près que les autres du type imaginatif, ils produisent quelques puérilités ou chimères. — En sorte qu’à la question posée on peut répondre : le non-imaginatif est tel, par défaut de matériaux ou par absence de ressort.
Sans nous contenter de ces remarques théoriques, montrons rapidement que c’est ainsi que les choses se sont passées, en fait. Tout le travail de l’imagination créatrice peut être ramené à deux grandes classes : les inventions esthétiques, les inventions pratiques ; d’une part ce que l’homme a créé dans le domaine de l’art et d’autre part tout le reste. Bien que cette division puisse paraître bizarre et injustifiée, elle a sa raison d’être, comme nous le verrons ci-après.
Considérons d’abord la classe des créations non esthétiques. Très différentes de nature, toutes les créations de ce groupe coïncident par un point : elles sont d’utilité pratique, elles sont nées d’un besoin vital ; d’une des conditions d’existence de l’homme. Il y a d’abord les inventions pratiques au sens strict : tout ce qui tient à l’alimentation, aux vêtements, à la défense, à l’habitation, etc. ; chacun de ces besoins particuliers a provoqué des inventions adaptées à un but particulier. — Les inventions dans l’ordre social et politique répondent aux conditions d’existence collective ; elles sont nées de la nécessité de maintenir la cohésion de l’agrégat social et de la défendre contre les groupes ennemis. — Le travail de l’imagination d’où sont issus les mythes, les conceptions religieuses, les premiers essais d’explication scientifique peuvent sembler d’abord désintéressés et étrangers à la pratique. C’est une erreur. L’homme en face des puissances supérieures de la nature dont il ne pénètre pas le mystère a besoin d’agir sur elle ; il essaie de se les concilier, même de les asservir par des rites et procédés magiques. Sa curiosité n’est pas théorique, il ne vise pas à savoir pour savoir, mais pour agir sur le monde extérieur et en tirer profit. Aux nombreuses questions que la nécessité lui impose, son imagination seule répond, parce que sa raison est vacillante et sa culture scientifique nulle. Ici donc, l’invention résulte encore de besoins urgents.
À la vérité, au cours du siècle et en raison de la civilisation croissante, toutes ces créations atteignent un deuxième moment où leur origine se dissimule. La plupart de nos inventions mécaniques, industrielles, commerciales, ne sont pas provoquées par la nécessité immédiate de vivre, par un besoin urgent ; il ne s’agit pas d’être, mais de mieux être. De même pour les inventions sociales et politiques qui naissent de la complexité croissante et des exigences nouvelles d’agrégats formant de grands États. Enfin, il est certain que la curiosité primitive a perdu partiellement son caractère utilitaire pour devenir, du moins chez quelques hommes, le goût de la recherche pure, théorique, spéculative, désintéressée. Mais tout ceci n’infirme en rien notre thèse ; car c’est une loi de psychologie élémentaire bien connue que, sur les besoins primitifs, se greffent des besoins acquis qui sont tout aussi impérieux : le besoin primitif s’est modifié, transformé, adapté ; il n’en reste pas moins le ressort fondamental de la création.
Considérons maintenant la classe des créations esthétiques. D’après la théorie généralement admise et qui est trop connue pour que je m’attarde à l’exposer, l’art a sa source dans une activité superflue, de luxe, inutile à la conservation de l’individu, qui se manifeste d’abord sous la forme du jeu. Puis le jeu, par transformation et complication devient l’art primitif, à la fois danse, musique et poésie étroitement unis en un tout d’apparence indissoluble. Quoique la théorie de l’inutilité absolue de l’art ait encouru de fortes critiques, acceptons-la momentanément. Sauf le caractère vrai ou faux d’inutilité, le mécanisme psychologique reste le même ici que dans les cas précédents ; nous dirons seulement qu’au lieu d’un besoin vital, c’est un besoin de luxe qui agit ; mais il n’agit que parce qu’il est dans l’homme.
Toutefois, l’inutilité biologique du jeu est loin d’être démontrée. Groos, dans ses deux excellents ouvrages sur ce sujet[13], a soutenu avec beaucoup de force l’opinion contraire. D’après lui, la théorie de Schiller et Spencer sur la dépense d’une activité superflue et la théorie opposée de Lazarus qui ramène le jeu à un délassement, c’est-à-dire à une restitution de force, ne sont que des explications partielles. Le jeu a une utilité positive. Chez l’homme, un grand nombre d’instincts existent qui, à la naissance, ne sont pas encore développés ; être inachevé, il doit faire l’éducation de ses aptitudes et il y arrive par le jeu qui est l’exercice des dispositions naturelles de l’activité humaine. Chez l’homme et les animaux supérieurs, les jeux sont une préparation, un prélude aux fonctions actives de la vie. Il n’existe pas un instinct du jeu en général, mais des instincts particuliers qui se révèlent sous la forme du jeu.
Si l’on admet cette explication qui n’est pas dénuée de solidité, le travail de l’imagination esthétique lui-même se ramènerait à une nécessité biologique et il n’y aurait plus de raison d’en faire une catégorie à part. Quelque parti qu’on adopte, il reste toujours établi que toute invention est réductible, directement ou indirectement, à un besoin particulier, déterminable, et qu’admettre dans l’homme un instinct spécial dont le caractère propre, spécifique, serait d’inciter à la création est une conception chimérique.
D’où vient donc cette idée persistante et à certains égards séduisante, que la création résulte d’un instinct ? C’est que l’invention géniale a des caractères qui la rapprochent évidemment de l’activité instinctive au sens exact de ce mot. D’abord, la précocité, dont nous donnerons plus loin de nombreux exemples et qui simule l’innéité de l’instinct. Ensuite, l’orientation dans un sens exclusif : l’inventeur est pour ainsi dire polarisé ; il est l’esclave de la musique, de la mécanique, de la mathématique, souvent impropre à tout hors de sa sphère. On sait le joli mot de Mme du Deffant sur Vaucanson, si gauche, si insignifiant, quand il sortait de la mécanique. « On dirait que cet homme s’est fabriqué lui-même. » Enfin la facilité avec laquelle souvent (non toujours) l’invention se manifeste, la fait ressembler à l’œuvre d’un mécanisme préétabli.
Mais ces caractères et autres semblables peuvent manquer. Ils sont nécessaires pour l’instinct, non pour l’invention. Il y a de grands créateurs qui n’ont été ni précoces, ni confinés dans un domaine étroit et qui ont enfanté péniblement, laborieusement. Entre le mécanisme de l’instinct et celui de la création imaginative, il y a des analogies souvent très grandes, non identité de nature. Chaque tendance de notre organisation, utile ou nuisible, peut devenir l’origine d’une création. Chaque invention est née d’un besoin particulier de la nature humaine, agissant dans sa sphère et pour son but propre.
Si maintenant on demande pourquoi l’imagination créatrice se dirige dans un sens préférablement à tout autre, vers la poésie ou la physique, vers le commerce ou la mécanique, la géométrie ou la peinture, la stratégie ou la musique, etc., nous n’avons rien à répondre. C’est un résultat de l’organisation individuelle dont nous n’avons pas le secret. Dans la vie ordinaire, nous rencontrons des gens visiblement portés vers l’amour ou la bonne chère, vers l’ambition, la richesse ou la piété : nous disons qu’ils sont ainsi faits, que tel est leur caractère. Au fond, les deux questions sont identiques et la psychologie actuelle n’est pas en état de les résoudre.
| [9] | Ueber Phantasievorstellungen, 1889. Graz, p. 48. |
| [10] | Die Spiele der Thiere, Iéna, 1896. Ce sujet est très bien traité par cet auteur, p. 294-301. |
| [11] | Psychology, t. I, p. 972 sq. |
| [12] | Höffding, Psychologie, p. 219. |
| [13] | Groos, Die Spiele der et Thiere Die Spiele der Menschen, 1899. |