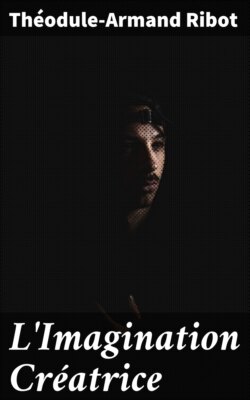Читать книгу L'Imagination Créatrice - Théodule-Armand Ribot - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеTable des matières
L’association est une des grandes questions de la psychologie ; mais comme elle n’appartient pas en propre à notre sujet, elle ne sera traitée que dans la mesure stricte de son utilité. Rien d’ailleurs n’est plus facile que de nous circonscrire. Notre tâche est réductible à une question très nette et très limitée : Quelles sont les formes d’associations qui donnent lieu à des combinaisons nouvelles et sous quelles influences se forment-elles ? Toutes les autres formes d’association, celles qui ne sont que répétition, doivent être éliminées. Par suite, ce sujet ne peut être traité en une seule fois ; il doit être étudié tour à tour dans ses rapports avec nos trois facteurs : intellectuel, émotionnel, inconscient.
On admet généralement que le terme « association des idées » est mauvais. Il est trop peu compréhensif, l’association régissant d’autres états psychiques que les idées. Il semble de plus indiquer une pure juxtaposition, tandis que les états associés se modifient par le fait même de leur connexion[7]. Mais comme il est consacré par un long usage, il serait difficile de le proscrire.
Par contre, les psychologues ne sont pas d’accord sur la détermination des lois ou formes principales d’association. Sans prendre parti dans ce débat, j’adopte la classification la plus répandue, la plus commode pour notre sujet : celle qui ramène tout aux deux lois fondamentales de la contiguïté et de la ressemblance. Dans ces dernières années, diverses tentatives ont été faites pour ramener ces deux lois à une seule ; les uns réduisant la ressemblance à la contiguïté, les autres la contiguïté à la ressemblance. Laissant de côté le fond de cette discussion qui me paraît assez vaine et qui n’est due peut-être qu’à un besoin excessif d’unité, il faut reconnaître pourtant que ce débat n’est pas sans intérêt pour l’étude de l’imagination créatrice ; parce qu’il a bien montré que les deux lois fondamentales ont chacune un mécanisme qui lui est propre.
L’association par contiguïté (ou continuité) que Wundt nomme externe, est simple et homogène ; elle reproduit l’ordre et la connexion des choses ; elle se réduit à des habitudes contractées par notre système nerveux.
L’association par ressemblance que Wundt nomme interne, est-elle au sens strict une loi élémentaire ? Beaucoup en doutent. Sans entrer dans les débats longs et souvent confus auquel ce sujet a donné lieu, on peut en résumer les résultats comme il suit. Dans l’association dite par ressemblance, il faut distinguer trois moments : 1º celui de la présentation ; un état A est donné par la perception ou l’association par contiguïté ; c’est le point de départ. 2º celui du travail d’assimilation ; A est reconnu comme plus ou moins semblable à un état a antérieurement éprouvé. 3º par suite de la coexistence de A et de a dans la conscience, ils peuvent plus tard s’évoquer réciproquement ; quoique, en fait, les deux événements primitifs A et a n’aient jamais coexisté antérieurement et même quelquefois n’aient pas pu coexister. Il est clair que le moment capital est le second ; et qu’il consiste en un acte d’assimilation active, non d’association. Aussi W. James soutient-il « que la ressemblance n’est pas une loi élémentaire, mais un rapport que l’esprit perçoit après le fait, comme il perçoit des rapports de supériorité, de distance, de causalité, etc..., entre deux objets évoqués par le mécanisme de l’association »[8].
L’association par ressemblance suppose un travail mixte d’association et de dissociation : c’est une forme active. Aussi est-elle la source principale des matériaux de l’imagination créatrice, comme la suite de ce travail le montrera à satiété.
Après ce préambule un peu long, mais indispensable, arrivons au facteur intellectuel proprement dit, dont nous nous sommes rapprochés peu à peu. L’élément essentiel, fondamental, de l’imagination créatrice dans l’ordre intellectuel, c’est la faculté de penser par analogie, c’est-à-dire par ressemblance partielle et souvent accidentelle. Nous entendons par analogie une forme imparfaite de la ressemblance : le semblable est un genre dont l’analogue est une espèce.
Examinons avec quelques détails le mécanisme de ce mode de pensée pour comprendre comment l’analogie est, de sa nature, un instrument presque inépuisable de création.
1º L’analogie peut reposer uniquement sur la quantité des attributs comparés. Soient abcdef et rstudv deux êtres ou objets dont chaque lettre désigne symboliquement les attributs constitutifs. Il est clair que l’analogie entre les deux est très faible, puisqu’il n’y a qu’un seul élément commun : d. Si le nombre des éléments communs augmente, l’analogie croîtra dans la même proportion. Mais le rapprochement symbolisé ci-dessus n’est pas rare chez les esprits étrangers à une discipline un peu rigoureuse. Un enfant voyait dans la lune et les étoiles une mère entourée de ses filles. Les aborigènes de l’Australie appelaient un livre « une moule », uniquement parce qu’il s’ouvre et se ferme comme les valves d’un coquillage.
2º Elle peut avoir pour base la qualité ou valeur des attributs comparés. Elle s’appuie sur un élément variable qui oscille de l’essentiel à l’accidentel, de la réalité à l’apparence. Entre les cétacés et les poissons, les analogies sont grandes pour le profane, faibles pour le naturaliste. Ici encore de nombreux rapprochements sont possibles, si l’on ne tient compte ni de leur solidité ni de leur fragilité.
3º Enfin, chez les esprits sans rigueur, il se produit une opération demi-inconsciente qu’on pourrait appeler un transfert par omission du moyen terme. Il y a analogie entre abcde et ghaif par le caractère commun a ; entre ghaif et xyfzq par le caractère commun f, et finalement une analogie s’établit entre abcde et xyfzq sans autre raison que leur analogie commune avec ghaif. Dans l’ordre affectif, les transferts de ce genre ne sont pas rares.
L’analogie, procédé instable, ondoyant et multiforme, donne lieu aux groupements les plus imprévus et les plus nouveaux ; par sa souplesse, qui est presque sans bornes, elle produit également des rapprochements absurdes et des inventions très originales.
Après ces remarques sur le mécanisme de la pensée par analogie, voyons les procédés qu’elle emploie pour créer. Le problème est, en apparence, inextricable. Les analogies sont si nombreuses, si diverses, si arbitraires qu’on doit désespérer d’abord de découvrir une régularité quelconque dans le travail créateur. Il semble pourtant qu’il est réductible à deux types ou procédés principaux qui sont la personnification et la transformation ou métamorphose.
La personnification est le procédé primitif : il est radical, toujours identique à lui-même, mais transitoire ; il va de nous-mêmes aux autres choses. Il consiste à tout animer, à supposer dans tout ce qui donne signe de vie et même dans l’inanimé des désirs, passions et volontés analogues aux nôtres, agissant comme nous en vue de certaines fins. Cet état d’esprit est incompréhensible pour l’homme adulte et civilisé ; mais il faut bien l’admettre, puisque il y a des faits sans nombre qui en démontrent l’existence. On me dispensera d’en citer. Ils sont trop connus ; ils remplissent les ouvrages des ethnologistes, des voyageurs en pays sauvages, des mythographes. D’ailleurs, tous, au début de notre vie, pendant notre première enfance, nous avons traversé cette période inévitable de l’animisme universel. Les ouvrages de psychologie infantile abondent en observations qui ne laissent aucun doute possible sur ce point ; l’enfant anime tout et d’autant plus qu’il est plus imaginatif : mais ce qui, chez le civilisé, ne dure qu’un moment, reste chez le primitif une disposition stable et toujours en action. — Ce procédé de personnification est la source intarissable d’où ont jailli la plupart des mythes, une masse énorme de superstitions et un grand nombre de créations esthétiques ; pour résumer en un seul mot : toutes les choses qui sont inventées ex analogia hominis.
La transformation ou métamorphose est un procédé général, permanent, à formes multiples, qui va non du sujet pensant aux objets ; mais d’un objet à un autre objet, d’une chose à une autre chose. Il consiste en un transfert par ressemblance partielle. Cette opération repose sur deux bases fondamentales. Tantôt elle s’appuie sur des ressemblances vagues fournies par les perceptions : un nuage devient une montagne, ou la montagne un animal fantastique, le bruit du vent est une plainte, etc. Tantôt c’est une ressemblance affective qui prédomine : une perception évoque un sentiment et en devient la marque, le signe, la forme plastique : le lion représente le courage, le chat, la ruse, le cyprès la tristesse, etc. Tout cela, sans doute, est erroné ou arbitraire ; mais le rôle de l’imagination est d’inventer, non de connaître. — Personne n’ignore que ce procédé crée les métaphores, les allégories, les symboles ; il ne faudrait pas croire cependant qu’il reste confiné dans le domaine de l’art ou de l’évolution du langage. Il se rencontre à chaque instant dans la vie pratique, dans l’invention mécanique, industrielle, commerciale, scientifique et nous en donnerons plus tard un grand nombre d’exemples.
Remarquons, en effet, que l’analogie, forme imparfaite de la ressemblance, comme on l’a dit plus haut, — supposant entre les objets comparés une somme de ressemblances et de différences à proportions variables — comporte nécessairement tous les degrés. À un bout, le rapprochement se fait entre des similitudes vaines ou extravagantes. À l’autre bout, l’analogie confine à la ressemblance exacte ; elle se rapproche de la connaissance proprement dite, par exemple dans l’invention mécanique et scientifique. Dès lors, rien d’étonnant si l’imagination est souvent un substitut et, comme le disait Gœthe, « un avant-coureur de la raison ». Entre l’imagination créatrice et la recherche rationnelle, il y a une communauté de nature : toutes deux supposent la faculté de saisir les ressemblances. D’autre part, la prépondérance du procédé exact ou du procédé approximatif établit, dès l’origine, une distinction entre « les penseurs » et les « imaginatifs ».
| [3] | Consulter particulièrement J. Philippe : « La déformation et les transformations des images » dans la Revue philosophique, mai et novembre 1897. — Quoique ces recherches n’aient eu pour objet que les représentations de la vue, il n’est pas douteux qu’il en est de même pour les autres, notamment celles de l’ouïe (voix, chant, accords). |
| [4] | De l’Intelligence, t. I, liv. II chap. 2. |
| [5] | Dans sa récente histoire des théories de l’imagination (La psicologia dell’immaginazione nella storia filosofia. Roma, 1898), Ambrosi montre que cette loi se trouve déjà formulée dans la Psychologia empirica de Ch. Wolff. « Perceptio prœterita integra recurrit cujus præsens continet partem ». |
| [6] | J. Sully. The Human Mind, I, 365. — W. James. Psychology, I, 502. |
| [7] | Pour une bonne critique de ce terme, voir Titchener, Outlines of Psychology, p. 190 sq., New-York, 1896. |
| [8] | Pour les débats sur la réduction à l’unité, on trouvera la bibliographie détaillée dans Jodl. : Lehrbuch der Psychologie (Stuttgart, 1896), p. 490. — Sur la comparaison des deux lois : W. James, Ouv. cité, I, 590. J. Sully, Ouv. cité, I, 331 et suiv. Höffding, Psychologie, 213 sq. |