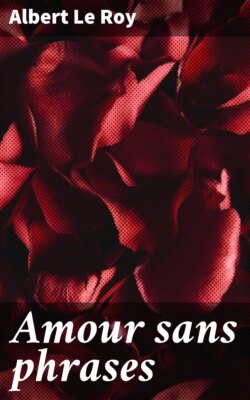Читать книгу Amour sans phrases - Albert Le Roy - Страница 7
ОглавлениеJUAN PEREZ
Quand le piqueur de la voie, M. Laurent, avait annoncé au chef de gare de Saint-Magloire-en-Crau, après lui avoir serré la main en descendant de wagon, qu’il venait pour s’assurer si le sacré mistral qui faisait rage depuis cinq jours n’avait pas démoli les poteaux télégraphiques et saccagé par trop les clôtures de la voie ferrée, le digne fonctionnaire réprima une forte envie de rire. Il connaissait, en effet, le but des promenades à Saint-Magloire de M. Laurent, un gros personnage qui régnait sur vingt kilomètres de chemin de fer et avait sous sa coupe tout un bataillon de garde-barrières, de poseurs de rails, de surveillants et de terrassiers.
A deux cents mètres de la gare, abritée par le talus, faite de pierraille blanche, la maisonnette du poseur Juan Perez montrait son toit de briques rouges. Elle se composait, comme toutes les constructions de ce genre, d’un simple rez-de-chaussée divisé en deux pièces assez vastes: la cuisine et la chambre à coucher. Autour de la maison, se trouvait un minuscule jardin potager entouré d’une haute bordure de cyprès destinée à protéger contre les fureurs du mistral les jeunes plants de tomates et les laitues en bas âge.
Le logis était propre et gai. Les murs étaient soigneusement badigeonnés à la chaux et quand le rideau à grands carreaux bleus et rouges, placé devant la porte d’entrée, était relevé, on apercevait dans la cuisine, occupée aux soins du ménage ou penchée sur un travail de couture, Thérèse, la femme de l’employé.
Juan Perez l’avait épousée par amour. Elle était la fille d’un journalier, d’un travailleur de terre qui en avait encore une demi-douzaine à caser. Pour elle, Juan avait abandonné son métier de gardien de chevaux dans la Camargue, un état libre qui convenait à ses instincts de silencieux et de révolté. Il s’était enrégimenté dans la grande armée des employés de chemins de fer, bravant la colère du père Perez, un Catalan sournois et vindicatif, échoué dans les paluds de Saint-Gilles, à la suite d’une affaire mystérieuse qui s’était passée dans son pays, à Estagel, et dans laquelle il avait joué un rôle mal défini.
Pour se soustraire au dur labeur de la maison paternelle, Thérèse avait accepté le galant, en dépit de son air en dessous et de ses allures de conspirateur.
Sa splendide beauté de brune aux formes sveltes s’était conservée en dépit des fatigues journalières de sa pauvre existence.
Son visage au profil correct resplendissait sous les bandeaux de cheveux noirs, nattés en chignon et emprisonné dans un élégant bonnet d’Arlésienne. Juan l’aimait comme un fou; elle le laissait faire comme si elle eût trouvé qu’il fût impossible qu’on l’aimât autrement; mais elle restait froide comme une belle idole, réservant ses ardeurs pour le chef de son mari, ce M. Laurent dont les fréquentes visites à Saint-Magloire mettaient en éveil la curiosité des gens de la gare.
Ce soir-là, Juan était de ronde. Il devait aller inspecter les disques avancés et s’assurer de leur bon fonctionnement, puis revenir surveiller l’aiguillage d’une voie de carrière distante de trois kilomètres environ de chez lui.
Quand, après avoir fait la première partie de sa ronde en compagnie de Turc, un dogue hargneux, aux crocs aigus, qui partageait avec Thérèse son affection, il passa devant la maisonnette, l’idée lui vint de s’assurer si la porte était bien close. Il s’approcha sans bruit pour ne pas effrayer sa femme. La porte était fermée, on n’entendait aucun bruit à l’intérieur. Juan, rassuré, allait s’éloigner, lorsqu’il lui sembla entendre un grattement derrière la maison, dans le petit jardin. Il tourna avec précaution l’angle du mur. La lumière filtrait au travers de la fente du volet de la fenêtre de la chambre, on entendait de là un bruit de soupirs. Le mari approcha, colla son visage contre la planche et resta là une minute.
Il reprit sa ronde, affectant en marchant sur le rail de faire sonner sur les cailloux de la voie le bout ferré de sa canne.
Arrivé à cinq cents mètres de chez lui, il descendit rapidement le talus, parcourut de nouveau la route qu’il venait de faire et alla se poster dans le voisinage de sa maison, au bord d’un raidillon qui conduisait sur la voie. Là, caché derrière un amas de traverses de rebut, il attendit les yeux fixés sur sa maison dont une partie se détachait en noir sur la colline crayeuse, tandis que l’autre partie était invisible, noyée dans l’ombre des cyprès.
Le petit jour allait paraître, lorsqu’un bruit de pas se fit entendre. L’amant partait. Il fila derrière une haie de ronces; puis Juan entendit le bruit de ses souliers ferrés sur le caillou du raidillon. La tête parut, une tête de bellâtre suant l’angoisse et dont les yeux effarés exploraient les deux côtés du sentier.
Soudain le bâton ferré s’abattit sur son crâne. Il chancela, voulut crier, mais le dogue lui sauta à la gorge. Un second coup le renversa inerte, en travers du petit chemin. Sans se presser, Juan avait écarté le chien; il sortait de sa poche son long couteau espagnol, lorsqu’un bruit sourd lui fit lever la tête.
Un train arrivait. Perez prit le corps et le traîna sur la voie. Il eut soin de le placer sur le rail de façon à ce que le train le prît en écharpe, puis il attendit, caché derrière la pile de traverses.
C’était un convoi de marchandises, composé de wagons vides, long, interminable. A dix pas de l’endroit où se trouvait le corps de Laurent, le mécanicien ouvrit la porte de fer du foyer pour piquer son feu. Une lueur rougeâtre éclaira les deux côtés de la voie. Perez fut pris d’un effroi indicible. Le mécanicien ou le chauffeur allait voir ce qui se passait! Il n’en fut rien. Le chauffeur, ébloui, regardait du côté de l’entrevoie, l’autre tisonnait dans sa fournaise.
L’énorme masse de fer écrasa le corps de Laurent. Des lambeaux de chair s’attachèrent aux roues noires de la locomotive; puis le tender et les wagons passèrent sur les restes pantelants. Quand le train se fut éloigné, Perez s’approcha. Le corps de l’amant de sa femme n’était plus qu’une masse informe. La tête avait été broyée, la cervelle avait jailli sur les cailloux et sur le rail, des mouchetures blanches et rouges marbraient le bois de la pile de traverse. Un morceau de cervelle avait été projeté à trois pas de là sur une touffe d’herbe. Le crâne, vide, était horrible à voir.
Le chien, attiré par l’odeur du sang, voulait avoir sa part du cadavre. Perez le prit par la peau du cou et le jeta au bas du remblai; il se baissa ensuite pour ramasser un objet et partit.
La nouvelle de l’accident fut connue une demi-heure après. On avait, à la gare suivante, constaté des traces de sang sur les roues. On télégraphia à Saint-Magloire, où les employés se mirent en quête et découvrirent bientôt le cadavre mutilé de M. Laurent.
Sur le seuil de la maisonnette, Thérèse attendait Juan. Elle l’embrassa gravement, sans plaisir mais sans répugnance.
–Ta soupe est prête, dit-elle. Et Turc, qu’en as-tu fait?
Avant que Juan eut le temps de répondre, le chien parut au détour du sentier, il tenait entre ses crocs un objet blanchâtre.
–Ah! le voilà, dit Thérèse. Ici, Turc. Oh! le porc, fit-elle ensuite, le voleur! Vois donc ce qu’il tient. Une cervelle!. Il aura volé ça au village!
Juan s’assit sur le banc de pierre, devant la maison, sans dire un mot.
Thérèse le regardait inquiète, soupçonnant un malheur.
Tout à coup arriva un homme d’équipe de la gare.
–Ah! Perez! Thérèse! quel malheur! M. Laurent, vous savez? Votre piqueur? Mort! écrasé par un train, sur la voie!
Thérèse s’était redressée, frémissante.
–Mort! mort! disait-elle.
–En bouillie, madame Perez! Écrasé, je vous dis! On a retrouvé la moitié du crâne, vide! Pas de cervelle dedans!
Thérèse regarda son mari: les yeux de l’Espagnol flamboyaient. Dans un coin, le chien était vautré, se pourléchant les babines.