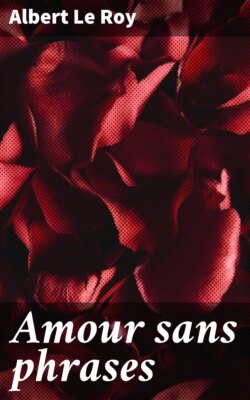Читать книгу Amour sans phrases - Albert Le Roy - Страница 9
ОглавлениеVACANCES
Après avoir pesté comme il convenait contre l’été ridicule de1882. un été qui ressemblait à s’y méprendre aux vilains hivers de la Provence ou du Languedoc, Paul Cavalier décida qu’il laisserait en plan son roman commencé et qu’il irait passer quelques semaines là-bas, au bord de la mer bleue, humer l’air et le vin du pays et se chauffer au bon soleil, au vrai, à celui qui brille pendant quatorze heures par jour, mûrissant les récoltes et surchauffant les cœurs.
Le lendemain, sa malle ficelée et cadenassée, Paul alla conduire à la gare Montparnasse Clara, sa maîtresse, une Bretonne un peu bébète, pas trop jolie, marquée de quelques taches de rousseur, une bonne fille au demeurant, qui était connue dans toutes les brasseries de Montmartre et des pays çircon voisins sous le nom du «collage Paul». On la traitait en camarade partout.
Tous les ans elle allait passer un mois chez elle, à Morlaix; on la croyait caissière dans un grand magasin de Paris, là-bas.
Cette fois, comme toujours, elle accepta la séparation avec résignation; pourtant, au moment de monter dans le train elle eut un mouvement de révolte.
–Tu pourrais bien, il me semble, dit-elle à Paul, t’arranger de façon à ce que nous puissions aller passer un mois à la campagne ensemble?
–Y songes-tu? ma chérie, répondit Paul en l’embrassant longuement, et ma famille, et la tienne?
Il partit deux heures après, et, le lendemain soir, un express de la ligne de Lyon le déposait, couvert de poussière noirâtre sur le quai de la gare de sa ville natale.
Paul déposa familialement une partie de ladite poussière sur les lèvres roses de ses sœurs et de ses cousines qui l’embrassaient à qui mieux mieux. La part faite aux premières effusions, on causa.
Depuis environ cinq ans Paul annonçait sa visite, puis, au dernier moment, il changeait son itinéraire, allant tantôt en Suisse avec un ami, tantôt seul visiter les musées belges ou hollandais. Il fut donc surpris du changement survenu parmi les siens. Sa sœur aînée, la maîtresse de la maison, qu’il avait laissée grande et svelte dans ses robes de deuil, s’était mariée au cours d’un assez long voyage qu’il avait fait en Amérique. Elle était là maintenant, à côté de son mari qu’il connaissait à peine: il l’avait vu deux ou trois fois à Paris; deux enfants se pendaient à ses jupes et il ne fallait pas l’examiner longtemps pour s’apercevoir que la famille ne tarderait pas à s’accroître. La frêle enfant était devenue une solide matrone, mafflue, haute en couleur, et pas poétique du tout. Le beau-frère était un marchand de bois quelconque.
Les embrassades continuèrent pendant la soirée et la journée du lendemain qui était le grand jour de marché. Parents urbains et suburbains accollèrent Paul à qui mieux mieux et lui firent promettre de venir «prendre quelque chose» chez eux avant son départ, ce qui n’était que relativement poli.
Dès le lendemain, la monotonie de la vie de province commença à prendre Paul dans son engrenage de lâcheté et de mollesse. Quand il eut visité les coins où il s’amusait étant gamin, les allées ombreuses du «Bosquet» où il avait prononcé des paroles amoureuses à l’adresse de filles de fabrique qui ne fleuraient pas précisément l’oppoponax, quand il fut las de courir après ses anciens camarades dont quelques-uns avaient disparu, il alla dans les champs, droit devant lui, contemplant l’éternel renouveau des fleurs et des arbres, écoutant la grande symphonie de la nature. Il revint le soir, couvert de poussière. Des messieurs qui prenaient l’absinthe devant le café d’Orient, fréquenté par les gros bonnets de la ville, firent observer qu’il avait une tenue bien négligée. Ce propos fut entendu par le beau-frère de Paul, qui le répéta à sa sœur.
Pour effacer la mauvaise impression produite par ce retour des champs, la sœur de Paul lui proposa, le lendemain, de l’accompagner pour aller rendre quelques visites. L’infortuné accepta en soupirant. Comme il était plutôt observateur que causeur et qu’il ne connaissait aucun des cancans de la petite ville, il parla fort peu, ce qui fit qu’on le trouva fort bête. Le soir, à la musique, il lâcha fort proprement sa famille et un jeune homme de «la société» vint apprendre une demi-heure après à son beau-frère qu’on l’avait vu se dirigeant, seul, vers un quartier désert où habitaient quelques-unes de ces demoiselles qui, au dire de M. Prud’homme, vont en journée la nuit.
Paul découcha, ce qui lui valut une scène horrible au déjeuner. Décidément la famille était un peu encombrante. Le soir, il alla dîner seul, au restaurant, avec un vieil oncle, un original qui vivait en garçon et qui se moquait du qu’en dira-t-on.
–Ah! mon garçon, répondit-il aux doléances de Paul, tu te figures sans doute être ici à Paris et pouvoir cascader à ton aise? Pas de ça, Lisette! Ici, on est gourmé, on est digne, on s’espionne, mais on ne s’amuse pas.
Le jeune homme se le tint pour dit.
Le lendemain, pendant qu’il se disputait avec un de ses camarades de collège qui lui reprochait de n’avoir fait qu’un livre en quinze ans tandis que lui avait trouvé le moyen de s’enrichir dans les huiles et les fruits secs, on apporta une lettre à Paul. Cette bienheureuse lettre contenait le prétexte désiré pour lâcher la famille. André Sénac, le musicien, avait besoin de lui pour les paroles d’un opéra-comique et il le priait de venir passer quinze jours avec lui au château de Fougerettes, près de Nevers.
Paul, d’un air désolé, montra cette lettre à son beau-frère et à sa sœur.
–C’est bien, pars, lui dit amèrement cette dernière!. Tu comprends bien que nous autres, pauvres petits bourgeois, nous ne pouvons lutter avec des gens qui ont des châteaux!.
Paul poussa un énorme soupir de satisfaction en voyant disparaître à l’horizon le clocher de sa ville natale.
A la gare voisine de Fougerettes, André l’attendait en compagnie de Totoche, sa maîtresse, qui jouait fort bien les châtelaines. On monta dans le break attelé de deux postiers que Totoche conduisit magistralement jusqu’au bas du perron de Fougerettes.
Le «château» était un grand bâtiment flanqué de deux pavillons, qui ne méritait pas ce titre prétentieux, mais il était admirablement situé, à mi-côte, entre un vaste tapis de prairies où paissaient, enfoncés dans l’herbe jusqu’au ventre, de bons gros bœufs au regard doux, et un bois qu’on appelait parfois le parc.
L’existence y était plantureuse, André était gai comme un pinson, Totoche ressemblait à une pouliche lâchée en plein champ. Pas de voisins, pas de visites, grâce à l’irrégularité bien connue du ménage.
Le soir, en servant le potage, pendant que Paul achevait de narrer à Totoche les embêtements qui avaient signalé son séjour dans sa ville natale, André s’écria tout à coup:
–A propos, Paul, et ton collage?
–Tiens, fit Totoche, c’est vrai, ça! Et Clara?
–Clara, répondit Paul? En province, en Bretagne, chez ses parents.
–Si elle s’y amuse comme tu t’es amusé chez toi!.
–Bah! que voulez-vous, je ne pouvais pourtant pas la conduire là-bas?
–Non, mais tu pourrais lui télégraphier de ’–venir ici te rejoindre?.
–Et séance tenante la dépêche fut rédigée.
Le «collage» arriva deux jours après et ce furent parties sur parties. Du livret d’opéra-comique on ne parla que vaguement.
L’avant-veille de son départ, Paul dit à André:
–Cette propriété dans laquelle tu vis pendant trois mois de l’année si librement et si largement, ne t’appartient pas, que je sache.
–Non, certes, elle est à mon oncle Bernard, présentement aux bains de mer de Blankenberghe, où il doit s’amuser comme un goujon dans une poêle à frire en compagnie de ma tante Augustine. Mais pourquoi cette question!
–C’est que je n’ai pu m’empêcher de comparer la liberté dont tu jouis chez tes parents, au ridicule esclavage auquel j’étais condamné chez ma sœur!.
–Ah! ah! mon vieux, fit André avec un sourire méphistophélique, tu ignores le fond des choses. Sache donc, ajouta-t-il en lui parlant à l’oreille, que l’oncle Bernard et la tante Augustine deux vieux Parisiens établis dans le pays depuis quinze ans, ne sont pas mariés du tout! C’est un vieux collage de cinquante ans, comme toi et Clara, moi et Totoche, mais un simple collage!!
Et alors, comme le père Bernard ne veut pas que la chose s’ébruite, il me céde sa propriété trois mois par an pour m’amadouer: seulement il file la veille de mon arrivée. Et voilà, mon cher! Allons prendre un verre de chartreuse!
Il se dirigea vers la porte-fenêtre de la salle à manger; Paul, rêveur, le suivait en murmurant:
–Oh! la famille!!!.