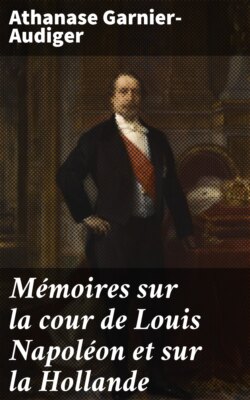Читать книгу Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande - Athanase Garnier-Audiger - Страница 13
ОглавлениеCHAPITRE X.
Le régime impérial substitué au pouvoir royal. — Le prince Lebrun gouverneur-général de la Hollande. — Le comte Daru organise les revenus de la couronne de France en Hollande. — Maison du gouverneur. — Courtisans chez le gouverneur. — Fêtes. — Auditeurs près le gouverneur. Taxe de 5o pour 0/0 sur les denrées coloniales. — Division de la Hollande par départemens. — Travaux du comte Daru, et opinion des Hollandais sur lui. — Fusion des employés subalternes de la maison du roi dans celle de l’empereur, à Paris.
LA politique de Napoléon avait placé la Hollande dans cette cruelle alternative, ou de passer volontairement sous une domination étrangère, ou de recevoir la loi d’une puissance formidable, à laquelle elle ne pouvait opposer qu’une très-faible et très-inutile résistance.
Ainsi, l’empereur des Français qui, en 1806, avait créé une monarchie en Hollande, en 1810, quand le roi Louis eut abdiqué, réunit ce pays à la France, et le régime impérial fut substitué au pouvoir du roi.
Par suite de cette grande résolution de Napoléon, M. Lebrun, duc de Plaisance, prince archi-trésorier de l’empire, fut nommé gouverneur-général de la Hollande, et M. le comte Daru, intendant-général de la maison de l’empereur, chargé de l’organisation des revenus et des dépenses de la couronne en Hollande, selon le mode de l’administration française.
Le prince, en arrivant à Amsterdam, refusa d’habiter le palais, pour s’établir modestement dans l’hôtel qu’occupait l’ambassadeur de France du temps du roi Louis.
La maison du gouverneur était peu nombreuse. Un secrétaire, sujet assez médiocre, et dont le maintien, les traits et la conduite caractérisaient assez bien quelqu’un qui essaie de la dévotion; un secrétaire-adjoint, Hollandais parlant et écrivant les deux langues; un aumônier, honnête homme, sous des dehors un peu trop mondains; un valet-de-chambre, une femme de charge et quelques hommes de livrée. Le secrétaire-adjoint, sachant seul le hollandais, se trouvait constamment en rapport avec un concierge qui ne sut jamais un mot de français.
A peine le prince eut-il fait son modeste établissement qu’on vit chez lui se glisser avec souplesse quelques rejetons de cette antique république batave, naguère si fière de son indépendance; on y vit aussi d’anciens courtisans du dernier stathouder, et auxquels succédaient tous ceux qui avaient été comblés de grâces du roi Louis, et qui avaient brillé près du trône. Partout les courtisans sont au premier comme au dernier venu. Sans physionomie morale, les frottemens multipliés qu’ils ont éprouvés les ont entièrement défigurés. On pourrait comparer les courtisans aux Juifs; sans former une nation, ils sont les mêmes partout.
Quoique le roi Louis fût généralement aimé de ses sujets, ce passage subit d’un régime à un autre ne produisit cependant aucune espèce d’effervescence, aucune opposition, aucun acte de grand dévouement: on se borna à gémir dans le silence.
Oubliant facilement les malheurs de la veille, les Hollandais prirent le nouveau joug avec calme, et le peuple hollandais, qui, tant de fois, montra de l’esprit public, en manqua absolument dans cette circonstance importante. Mais telle est souvent l’influence des temps; elle dirige les plus grands événemens, et les peuples se façonnent assez facilement aux situations nouvelles.
Un Alcibiade qui aurait affiché le faste aurait déplu aux Hollandais; mais les manières dignes de M. Lebrun leur inspirèrent la confiance et le respect. Dispensateur des grâces et de la fortune, il se trouva bientôt assailli de protestations semblables à celles qui jadis avaient été prodiguées au prince d’Orange et au roi Louis. Les esclaves se retrouvent toujours au séjour de la puissance.
L’archi-trésorier de France, malgré son goût prononcé pour une grande simplicité, jugea qu’il était nécessaire, à l’aurore d’un nouveau gouvernement, de déployer un peu de cette pompe qui environne les cours, et qui, dans les temps de détresse commerciale, offre aux futiles industries une apparence de prospérité : quelques yeux sont éblouis et la misère est partout. Il donna des fêtes, des réunions peu fastueuses, il est vrai, mais assez brillantes pour amollir encore davantage les courtisans. Les dames qui s’étaient montrées avec éclat à la cour de Louis, reparurent à celle du gouverneur, et leurs charmes brillèrent de nouveau dans l’arène ouverte aux plaisirs. On vanta partout la courtoisie du prince, son affabilité ; il eut le bon esprit de savoir amuser les grands et s’attacha le peuple avant de lui arracher tout l’or que devaient bientôt lui enlever d’énormes impôts .
Le prince-gouverneur avait été accompagné dans son gouvernement par trois auditeurs au conseil d’état, MM. Finot, Amyot et Busche, dont le dernier remplit assez long-temps les fonctions d’intendant des biens de la couronne. De la Hollande, il n’existait donc plus que son territoire. Là s’arrêta la soif de l’envahissement; les conquérans ne peuvent changer le climat d’un pays, en dénaturer le sol, détourner le cours des fleuves, détruire entièrement l’esprit national; mais tout, excepté cela, peut devenir la proie de leur ambition.
Le gouvernement resta à peu près le même; on conserva la division par départemens, telle qu’elle avait été faite sous le roi Louis: établie à l’imitation de la division de l’empire français, c’était comme déjà un acheminement à la réunion. La Hollande, devenue partie intégrale de la France. fut soumise aux lois du pays qui l’avait vaincue, et dans l’impuissance de résister au vainqueur, elle montra une docilité qui avait toute l’apparence de la satisfaction. Le gouverneur-général n’éprouva point, dans l’organisation de cette conquête de la France, ces oppositions qui obligent malheureusement quelquefois à déployer les étendards de la force, la sévérité, selon l’exigence des événemens; on n’eut rien à craindre d’une nation prompte à se plier sous le joug, et les Hollandais eurent, dans leur résignation, le bon esprit de se soumettre aux circonstances, et, mus par le principe que toute révolution leur eût été funeste, ils se fièrent au grand vengeur des peuples, au temps.
M. Lebrun, doué d’une longue et sage expérience, vieilli dans une école où il avait pu étudier le cœur humain, et non pas seulement de son beau côté, reconnut bien que l’administration française ne pouvait pas exclusivement s’adapter à l’état qu’il devait gouverner; autre pays, autres mœurs; autres préjugés et usages, et les idées de la métropole ne sont pas toujours adaptables à toutes les provinces. Aussi le gouverneur, sans s’affranchir des principes généraux, s’en éloignait quelquefois avec prudence, espérant prémunir le peuple contre quelques écarts qui trouvent leur excuse dans son ignorance. Aussi, dès que les Hollandais de distinction eurent compris qu’ils avaient pour gouverneur un homme sans exagération, ennemi des moyens violens, sachant ce que l’on doit d’indulgence aux préjugés d’un peuple qui en est idolâtre; enfin quand ils eurent reconnu en lui un homme disposé à s’identifier avec leur caractère, à maintenir dans un pays soumis à plusieurs dogmes, l’impartialité et la tolérance; ils secondèrent de tous leurs moyens l’administration paternelle du gouverneur général. Hommes et choses, tout a été entraîné.
Tandis que le prince s’occupait d’asseoir son gouvernement sur cette douceur qui n’exclut point la fermeté, de faire respecter les opinions, les croyances et les mœurs, le comte Daru, aussi grand administrateur que distingué par ses vastes connaissances littéraires, travaillait sans relâche à connaître tout ce qui pouvait enrichir le domaine de la couronne. Il s’entoura de tous les hommes qui pouvaient l’aider dans ses recherches, et sa perspicacité à cet égard) comme son infatigable ténacité au travail, étonnèrent étrangement des hommes du pays qui ne soupçonnaient pas des revenus qu’on découvrit.
Des Hollandais ont reproché au comte Daru de n’avoir pas les formes aussi engageantes que le prince Lebrun: un homme franc ne refait pas son caractère; la vivacité de M. Daru, mise en opposition avec le sang-froid batave, a d’ailleurs bien pu déconcerter quelquefois le flegme de ceux qui avaient affaire à lui. L’intendant général saisissait avec rapidité les questions administratives les plus difficiles, ne voyait point d’obstacle au bon droit; prompt à faire exécuter, comme à concevoir, il ne voulait point de retards. Les hommes habitués à remettre au lendemain durent être contrariés. Peut-être, même, si M. Daru eût mieux connu la Hollande et les bons Hollandais, il eût sacrifié quelque chose de sa pétulance à leurs habitudes tranquilles. Il faut convenir que la lenteur hollandaise a quelque chose de désespérant pour la vivacité française.
M. le comte Daru eut de cette vivacité ; des étrangers ont pu le remarquer; mais ils auraient tort de la nommer brusquerie. D’autres Français, immédiatement employés sous les ordres de l’intendant général, n’en furent point affranchis. Ces emportemens légers et passagers prouvent bien mieux la supériorité du comte Daru dans les affaires, qu’ils ne justifient le reproche qu’on lui adressait en Hollande d’avoir des manières peu engageantes.
A cette époque, on vit affluer en Hollande une nuée d’employés, destinés à servir les administrations impériales, gens dont la plupart, étaient recrutés au hasard parmi les désœuvrés. Ils semblaient avoir un grand besoin des places qu’ils venaient occuper loin de leurs foyers; mais bientôt ils parurent dans le monde avec une sorte de luxe, peu agréable pour ceux qui faisaient les fonds administratifs.
Lorsque Louis abdiqua le trône, il confirma dans leurs emplois tous les grands officiers de la couronne; le comte Daru convoqua ces dignitaires pour régler avec eux le budget des dépenses de leurs services jusqu’à la fin de l’exercice courant.
Le conseil de régence, constitué par Louis avant de quitter la Hollande, n’ayant point été approuvé par l’empereur qui avait ordonné la réunion, on ne conserva à Amsterdam, devenue capitale des pays réunis, qu’une faible partie du personnel des différens services de la maison du roi. Fourrier du palais, piqueurs et cochers, gens de bouche, valets de chambre, valets de pied et d’écurie, enfin tout ce qui était subalterne, et qui voulut aller en France, fut envoyé à Paris pour être employé dans la maison de l’empereur.