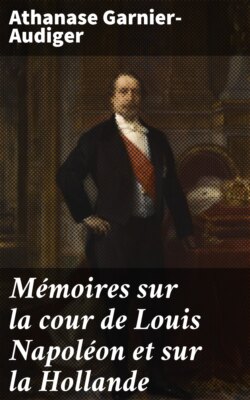Читать книгу Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande - Athanase Garnier-Audiger - Страница 9
CHAPITRE VI.
ОглавлениеMauvaise santé du roi. — Ambassadeur de France à la cour de Hollande. — La cour habite Amsterdam, déclarée capitale. — Exposition à Utrecht des produits de l’industrie, et création d’un institut des sciences et arts. — Louis refuse la couronne d’Espagne. — Police française en Hollande, et voyage du roi dans les départemens. — Hollandais qui regrètent le passé. — Désunion entre Napoléon et Louis. — Le code Napoléon pris pour base de celui de Hollande. — Le blocus raine le commerce. — Inondations. — Dévouement du roi. — Loi sur la noblesse. — Le grand duché de Berg donné au prince royal. Voyage du roi dans ses états. — Trait d’humanité. — Changement dans le ministère. — Mécontentement de l’empereur à cause de la contrebande en Hollande. — Pressentiment sur de grands événemens — Descente des Anglais dans l’île de Walkeren. — Troupes hollandaises envoyées contre cette expédition. Trahison du général Bruce, et prise du fort de Batz par les Anglais. — Voyage du roi à Anvers. — Le roi commande les troupes, et le prince de Ponte-Corvo lui succède. — Prise de Flessingue, et trahison du général Monnet. — Fête du roi. — Reprise du Fort de Batz par les Hollandais. — Les Anglais abandonnent l’île de Walkeren.
LE roi était habituellement d’une mauvaise santé , et cette disposition, qui augmentait sans cesse, donnait à son caractère quelque chose de triste et de morose qui affligeait les officiers de sa maison. Le malaise presque continuel qu’il éprouvait ne l’empêchait pourtant pas de travailler avec ses ministres; et, néanmoins, malgré ses efforts, il ne put détourner le gouvernement français du blocus contre l’Angleterre, dont l’effet devenait de plus en plus désastreux pour la Hollande.
Napoléon avait long-temps dédaigné d’avoir un ambassadeur en Hollande; enfin il y envoya M. de La Rochefoucauld, dont tous les efforts, si l’on en croit quelques diplomates hollandais, tendirent à préparer la réunion du pays à la France.
Peu de temps après l’arrivée du nouvel ambassadeur en Hollande, le bruit de la cession du Brabant et de la Zélande, en échange des villes Anséatiques, commença à se répandre. Louis, offensé de cette nouvelle, que la diplomatie française accréditait dans l’ombre, s’en expliqua sévèrement avec l’empereur, qui lui répondit d’une manière aussi ironique qu’évasive
Louis serait peut-être parvenu à assurer la prospérité de l’État, si son frère, dans ses vastes desseins, ne l’eût pas paralysé dans les siens. Il semblait permis de croire à cette prospérité, car il résulta des mesures de finances, prises jusqu’alors, un succès qu’on n’avait pas osé espérer, et qui dut être attribué en grande partie au ministre des finances, M. Gogel.
Quand le superbe hôtel-de-ville d’Amsterdam fut transformé, à ce que l’on crut, en palais royal, lorsqu’à grands frais on l’eût disposé et meublé somptueusement, le roi reçut à Utrecht une députation des habitans d’Amsterdam chargée de l’engager à prendre leur hôtel-de-ville pour sa demeure, et à déclarer Amsterdam la capitale du royaume . Le roi, acceptant une offre pour ainsi dire demandée, fit son entrée à Amsterdam le 20 avril 1808; le peuple alla au-devant de lui, et lui donna, par ses acclamations, de touchantes marques de son affection et de sa joie.
Le roi ayant choisi Utrecht pour le lieu de l’exposition des produits de l’industrie nationale, s’y rendit avec toute la cour pour y distribuer des médailles d’encouragement. De retour dans la capitale, Louis y fonda l’institut général des sciences et des arts, divisé en quatre classes: les noms de deux Français figuraient dans celle des beaux-arts, et tons les autres membres des autres classes étaient choisis parmi des Hollandais.
Joseph Bonaparte, l’aîné des frères de Napoléon, n’était point encore sur le trône d’Espagne, que l’empereur avait fait proposer à Louis de quitter les Hollandais pour venir régner sur les Espagnols . Louis refusa sans hésiter; et ce refus, auquel toute l’Europe applaudit plus tard, augmenta puissamment l’attachement et le dévouement des Hollandais en faveur de leur roi, qui leur accordait une si éclatante préférence.
La France, voulant avoir en Hollande une police secrète bien organisée, chargea un nommé Gateau de venir sonder le terrain; et ce lévrier d’espionnage intrigua tellement, que, sous un prétexte d’apparence honnête, il arriva jusqu’au roi, qui, le devinant, ne voulut point d’abord le déconcerter en le démasquant; mais Louis s’arrangea de telle façon, que cette police ne fut point organisée, quoique l’envoyé de Paris eût déjà beaucoup de gens qui lui étaient dévoués, et même jusque dans les services subalternes de la maison du roi.
Tous les ans le roi avait le bon esprit de vouloir faire une visite dans quelque partie de ses états; ces excursions dans les départemens ajoutaient à toutes les connaissances qu’il avait besoin d’acquérir sur un pays neuf pour lui: et d’ailleurs les souverains doivent bien se persuader que les peuples aiment toujours à voir ceux dont ils attendent leur félicité. Le roi qui visite souvent ses sujets obtiendra d’eux plus facilement les sacrifices qu’il en exigera.
Le peuple hollandais, essentiellement religieux, aima beaucoup à voir le roi s’occuper des affaires concernant les cultes; il sut concilier toutes les croyances, ce que la diversité des dogmes en Hollande rendait très-difficile; mais que ne peut la patience réunie à la volonté de faire le bien! Néanmoins, malgré cette constance à vouloir assurer la prospérité de tous, quelques-uns doutaient encore de ses intentions, c’était de ces Hollandais de vieille roche, fidèles partisans des Stathoudériens des Orangistes qui regrettaient toujours le passé. Eh! qui pourrait les blâmer, si la reconnaissance était le mobile de leur éloignement pour le présent? A ceux que le nouveau régime n’accommodait pas, se réunissaient tous ceux que la perte de leur hôtel-de-ville affligeait réellement. Le palais était exclusivement au roi, tandis que l’hôtel-de-ville appartenait à tous les habitans.
Deux ans s’étaient à peine écoulés depuis l’avénement de Louis au trône de Hollande, que tous ses rapports avec Napoléon étaient empreints d’aigreur; ces deux frères étaient en guerre ouverte. Pour plaire à l’empereur, il aurait fallu que Louis ne régnât en Hollande que d’après le système du gouvernement français. Le devait-il? Non! s’il voulait se dévouer tout à la nation. Mais qui l’avait fait roi? il faut bien distinguer ici l’homme du souverain. C’est à Louis Bonaparte, c’est au connétable de France à répondre à cette question, et non point à Louis Napoléon, roi de Hollande. On l’a toujours pensé, et maintenant on peut le dire sans déguisement, les frères de Napoléon, tout rois qu’ils fussent, n’étaient réellement que ses lieutenans; leur élévation était toujours subordonnée à sa puissance: c’était au nom de l’empereur des Français qu’ils régnaient en Espagne, en Italie, en Wesphalie et en Hollande. Sans juger ici du mérite de la politique de Napoléon, cette politique exigeait que, maître des puissances vaincues, il plaçât à leur tête des hommes agissant dans toute la plénitude de son système. Il avait son but: qu’il fût sage ou non de l’atteindre, ce n’était point à ses lieutenans, souverains il est vrai, mais toujours ses subordonnés, à gêner sa marche par des entraves.
Louis cédant donc au désir de gouverner d’après ses propres vues, contrariait tellement celles de l’empereur, qu’il devait bien s’attendre à tons les événemens qui furent la conséquence de son opposition au sytème du chef de l’empire français:
Si la politique de l’empereur n’avait pas l’assentiment de Louis, en revanche le Code-Napoléon lui plaisait beaucoup, car il demanda au Corps-Législatif d’en adopter les bases pour la rédaction du Code de la Hollande, qui fut approuvé en 1809.
Le désastreux blocus et par mer et par terre existait toujours, et quoique le commerce fût dans une position désespérée, il se faisait encore quelques affaires avec l’Angleterre: quelques bâtimens échappaient à la surveillance des douaniers; mais ce n’était que quelques gouttes d’eau pour étancher une soif ardente.
Il n’est pas rare en Hollande que de terribles inondations portent sur quelques points le deuil et l’épouvante. Le roi n’avait encore rien vu d’aussi effroyable que l’inondation de la Gueldre: quoique malade, il accourut avec les principaux officiers de sa maison. Ses souffrances, devenues plus vives, ne l’empêchèrent pas de s’occuper des maux de ses sujets; il voulut voir par lui-même le théâtre des ravages causés par les eaux, auxquelles les digues rompues n’opposaient plus de frein, et pour soulager des malheureux que l’inondation menaçait d’engloutir, Louis s’exposa plusieurs fois à d’imminens dangers. Son exemple, sa patience et son courage excitaient les travailleurs à l’imiter; il récompensait généreusement ceux qui s’exposaient le plus: la ville de Gorcum eût été submergée si le roi ne s’y fût pas rendu, et n’eût ordonné des travaux qui la ravirent à l’inondation complète dont elle était menacée. Louis, quoique harassé, exténué de fatigues, prit très-peu de repos en revenant à Utrecht, et repartit le lendemain pour se rendre sur un autre point, où son active sollicitude pouvait être aussi utile qu’à Gorcum, entièrement rassurée par les secours qu’on lui avait prodigués.
Depuis long - temps le roi était sollicité de s’occuper d’un projet de loi sur la noblesse; et ce fut le baron de Pallandt, premier chambellan, qui le lui présenta. Le roi, avec quelques modifications, voulut bien approuver la loi, à la grande satisfaction de ceux dont elle flattait l’ambition. L’enchantement ne fut pas de longue durée, car Napoléon obligea bientôt Louis à rapporter cette loi de faveur, et à annuler aussi le titre de maréchal de Hollande, qui avait été conféré à quelques officiers-généraux, titre que Napoléon, dans sa correspondance, désigne sous le nom de caricature dans un État secondaire.
Rien ne pouvait mieux tempérer la mortification que le retrait de la loi sur la noblesse faisait éprouver au roi, que l’investiture du grand duché de Berg en faveur du jeune prince royal de Hollande, bienveillance affectueuse de Napoléon, qui pourtant n’aveugla pas Louis au point de ne pas y reconnaître quelque dessein caché de l’empereur. Celui-ci n’avait pas même daigné informer le père d’une donation faite à son fils, encore sous la puissance paternelle. Ce n’était plus un problème; et il était bien évident que depuis quelque temps Napoléon voulait s’attribuer un empire despotique sur tous les membres de sa famille et sa politique l’avait amené à faire peut-être à cet égard ce que son cœur n’autorisait pas.
Le roi, qui savait déjà par expérience combien un souverain peut acquérir de connaissances utiles en parcourant ses états, et combien un prince peut se faire aimer de ses sujets en montrant le désir de les visiter chez eux, se détermina à aller faire une tournée dans le Brabant et dans la Zélande. Il se plut à visiter tous les établissemens publics, les églises, les couvens, écoutant avec bonté, et sans impatience, toutes les réclamations qui lui étaient adressées, et accordant avec justesse des encouragemens que la faveur n’obtenait pas sur la raison et l’équité. Mais ce qui surtout inspira pour le roi une espèce de vénération, ce fut son dévouement dans un village (Aerle), où il s’exposa volontairement aux dangereux effets d’une maladie contagieuse, en visitant des habitans en proie à une épouvantable épidémie, et dont un grand nombre était déjà victime. Des chirurgiens furent envoyés par lui et des secours distribués sous ses yeux même; ne se contentant pas d’offrir sa bourse et de fuir la présence des malheureux, qui, grâce à son ardente et pieuse humanité, virent bientôt disparaître le fléau dévastateur, dont toute la province aurait pu être la victime.
A son retour, le roi, écoutant peut-être trop facilement de trompeuses insinuations concertées pendant son absence, fit encore des changemens très-importans dans le ministère, sans examiner si ce jeu de bascule politique, ce dérangement d’hommes en place n’était pas plus nuisible que profitable aux intérêts de son gouvernement. En général les Hollandais voyaient toujours avec inquiétude ces mouvemens, ces mutations poussés par l’envie des courtisans, rarement utiles à la prospérité d’un État, et si opposés à l’esprit flegmatique et stationnaire des Hollandais.
Qu’on est à plaindre lorsqu’on emploie tout pour obtenir la confiance et qu’on a fait de vains efforts pour l’inspirer. La Hollande se trouvait dans ce cas, vis-à-vis de la France; car après avoir coopéré par de grands sacrifices à faire la guerre en Allemagne, dans l’intérêt de la France seulement, Napoléon croyait toujours avoir à se plaindre de la Hollande, «nation
» souple et fallacieuse, dit-il, dans un moment
» d’humeur, chez laquelle se fabriquent toutes
» les nouvelles qui peuvent être défavorables à
» la France.» Ses agens de police secrète lui affirmaient que les Hollandais faisaient avec l’Angleterre d’importantes affaires par la contrebande. Il en était bien quelque chose et plusieurs négocians hollandais se sont souvent exposés dans ce tortueux genre d’opérations commerciales, où l’appât des bénéfices leur était adroitement présenté par leurs correspondans anglais . La gazette de Leyde, dans ses feuilles toutes dévouées aux intérêts du pays, chercha à détruire ces mauvaises impressions: elle cria très-haut à la calomnie pour étouffer la voix de la médisance, et en appela, disait-elle, à la raison et à la loyauté. Les observateurs surent bien à quoi s’en tenir, sans être guidés par la gazette; et l’empereur, de son côté, n’en persista pas moins à dire: «que tout le pays de
» Hollande était entaché d’anglomanie et que le
» roi en était le premier smogleur.
L’homme le moins expert en affaires d’état, eût trouvé, dans les dispositions de la France, le pressentiment de quelques grands événemens; l’horizon politique s’obscurcissait, tous rapports affectueux entre Napoléon et Louis avaient disparu et l’on pensait, ou que l’empereur était trop absolu, ou que le roi, s’il devait se soumettre, ne le faisait jamais que de mauvaise grace, et en désespoir de cause. Dans cette lutte où les sentimens de fraternité semblaient étouffés, où les liens du sang étaient méconnus, qui cédera? Louis pressé par une puissance formidable, à laquelle il ne voudrait pas sacrifier les intérêts de sa nation, résiste avec l’arme de la raison et de l’amour de la patrie; mais son adversaire ne peut lui tenir compte des sentimens dont il est animé , et s’il résiste encore il peut ajouter aux maux dont il n’est déjà que trop assailli. Il se résigna et trouva l’occasion d’apprendre à l’empereur qu’il n’était pas aussi dévoué à l’Angleterre qu’on voulait bien le lui persuader. Le roi était allé à Aix-la-Chapelle pour y voir madame, mire; là, il apprit que les Anglais occupaient l’île de Walkeren et qu’ils avaient le projet de s’emparer de la flotte française, en station sur l’Escaut. Louis n’hésita point un instant et expédia sur-le-champ l’ordre à ses généraux en Hollande de se rapprocher avec leurs forces de la ville d’Anvers, pour protéger la flotte contre les entreprises des Anglais; toutes leurs tentatives eussent été vaines, si le général Bruce officier hollandais, qui commandait le fort de Batz, n’eût trahi ses devoirs en secondant les vues de l’ennemi et en laissant sans défense ce fort où il pouvait long-temps résister. Mais les troupes hollandaises, offensées d’une trahison à laquelle elles n’avaient eu aucune part, signalèrent bientôt leur courage et leur indignation en reprenant ce fort, abandonné par la lâcheté du commandant Bruce, dont le gouvernement français obtint la destitution et l’emprisonnement.
D’Aix-la-Chapelle, en passant par Amsterdam, le roi rejoignit ses généraux dans les parages d’Anvers, où il rassembla beaucoup de ses troupes, dont il forma un corps d’armée capable d’imposer aux Anglais, et déjoua une grande partie de leurs projets. Des troupes françaises se réunirent à l’armée hollandaise; et quoiqu’il s’y refusât de bonne foi vis-à-vis des généraux français, le roi fut obligé de prendre le commandement de toutes les forces réunies sur ce point. Il se rendit à la déférence qu’on lui marquait, mais avec la crainte qu’elle ne fût point approuvée par l’empereur. Louis ne s’était point trompé , car le prince de Ponte-Corvo vint bientôt prendre ce même commandement au nom de Napoléon. Louis quitta Anvers, emmenant sa garde et laissant le commandement de ses troupes au général Dumonceau. Cette conduite de l’empereur, si mortifiante pour le roi, n’était pas difficile à expliquer: il jugea qu’on se méfiait de lui, et ses conjectures, sur des événemens qu’il pressentait depuis long-temps, se justifiaient chaque jour par la quantité des troupes françaises que l’on rassemblait dans le Brabant.
La ville de Flessingue, bien défendue, pouvait opposer une longue résistance, et peut-être même en faire abandonner le siége; mais après une défense très-faible, le général Monnet, avec quatre mille hommes de garnison, se rendit aux Anglais. Il fut mis en jugement, et sa culpabilité bien constatée.
Comme l’occupation de la Zélande par les Anglais n’avait point altéré l’amour des Hollandais pour leur souverain, on célébra la fête du roi Louis à Amsterdam, et dans toute la Hollande avec les démonstrations de l’enthousiasme et de la joie; jamais la cour n’avait été plus brillante, et pendant trois jours que durèrent les fêtes, le roi s’y montra dans une recherche toute particulière, et, quoique souffrant, il avait toujours l’expression de la bienveillance.
A l’anniversaire de la fête de sa majesté, on joignit la fête de l’ordre de l’union; le roi y distribua des décorations, et parmi les nouveaux chevaliers figuraient de braves officiers dont les honorables blessures attestaient l’intrépidité avec laquelle ils avaient reconquis, sur les Anglais, le fort de Batz.
Quand les Anglais eurent inondé la Zélande de leurs marchandises, ils jugèrent à propos de l’évacuer après trois mois d’occupation. Malgré l’amour de la patrie, on les vit s’éloigner avec peine, parce qu’ils avaient ravivé le commerce dans cette partie de la Hollande, et en Hollande le commerce l’emporte sur toutes les autres affections: c’est l’ame du pays. Les produits des fabriques anglaises refluaient jusque dans le palais du roi, où tout le monde, depuis le grand dignitaire jusqu’au plus simple serviteur, voulait en avoir et s’en parer: on en trouvait partout, et partout on en désirait, en dépit du décret du roi, qui les prohibait; et c’est ainsi que sont ordinairement exécutées les lois et les ordonnances qui ne sont point dans l’intérêt des peuples.