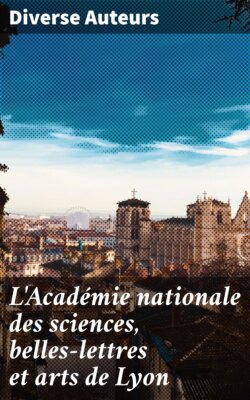Читать книгу L'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon - Diverse Auteurs - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеTable des matières
Rien n’est plus intéressant que d’embrasser dans sa mémoire toute l’évolution d’une branche de la science.
Beaucoup de bactériologistes contemporains jouissent de ce privilège exceptionnel, car ils ont vu naître la science qu’ils cultivent et l’ont suivie dans toutes les crises de son épanouissement.
S’il était entré dans ma pensée de retracer l’histoire de la microbie, j’aurais parlé exclusivement de faits qui se sont accomplis sous mes yeux.
En effet, les premières notions sérieuses sur le parasitisme virulent furent entrevues en 1861 et 1863; d’abord lorsque Pasteur annonça sa brillante découverte sur les ferments animés, puis lorsque Davaine publia ses patientes observations sur la bactéridie de la pustule charbonneuse. C’est en 1876 qu’elles furent affirmées définitivement, grâce aux recherches presque simultanées de Koch et de Pasteur sur la culture, le développement et le pouvoir pathogène spécifique du Bacillus anthracis.
La bactériologie n’a donc que vingt-quatre ans d’existence.
Quoique bien jeune encore, elle a poursuivi des objectifs divers. Chaque fois qu’elle a pris une voie différente, le changement s’est accompli avec une telle promptitude et a provoqué un tel engouement, qu’on peut lui appliquer le nom de crise, sans être taxé d’exagération.
En réalité, les bactériologistes n’ont pas changé d’objectif, mais ils ont entrevu successivement, sans dissimuler leur surprise, les diverses faces des questions microbiennes.
Nous nous rappelons une époque, celle du début, où l’anatomie pathologique tenta d’accaparer la science nouvelle, s’imaginant que la bactériologie consistait à démontrer la présence des microbes dans les lésions des maladies.
La bactériculture réclama vivement ses droits, estimant avec raison que la nature microbienne d’une affection repose sur des preuves plus nombreuses, comprenant: l’isolement et la propagation du microbe à l’état pur, et la reproduction de la maladie par l’inoculation de ce dernier.
Ce principe définitivement admis, les pathogénistes étendirent la main, proclamant que le point le plus intéressant était de savoir comment les infiniment petits créaient la maladie.
Alors s’établit une discussion, féconde en résultats, sur le rôle pathogénique du microbe et celui des poisons qu’il sécrète dans l’organisme.
A un moment donné, l’intérêt de la bactériologie paraissait concentré à peu près exclusivement sur l’étude des toxines microbiennes.
Pasteur, puis Toussaint, nous ayant appris que certains microbes réputés des plus dangereux pouvaient être transformés en vaccins et servir à procurer artificiellement l’immunité, aussitôt tous les esprits furent à la vaccinification des microbes pathogènes.
Mais bientôt, on se heurta, dans cette voie, à des obstacles insurmontables.
Ce fut pour les bactériologistes du monde entier une occasion de recueillement. Arrêtés par la difficulté de procurer l’immunité, ils voulurent connaître les causes mêmes de cet état mystérieux.
Résident-elles, comme d’aucuns le prétendent, dans l’exagération d’une propriété naturelle gd’un rand nombre des cellules de notre corps par laquelle ces cellules s’empareraient des microbes pour les tuer et les digérer? Au contraire, se rattachent-elles à certaines qualités de la partie liquide du sang qui la rendent bactéricide et antitoxique, c’est-à-dire lui permettent d’anéantir les agents de toute maladie virulente, le microbe et ses toxines?
On se passionna réellement pour ces deux théories, d’origine française, où nous voyons briller dès la première heure les noms de deux de nos membres, MM. Chauveau et Bouchard, et celui de M. Metchnikoff, de l’Institut Pasteur. Elles occupèrent presque entièrement la scène bactériologique, laissant au-dessous d’elles, à l’étiage des questions élémentaires, la recherche et la culture des microbes, exception faite toutefois pour certaines maladies, comme la rage, la rougeole, la scarlatine, dont l’agent infectieux persiste à se dissimuler sous des voiles quasi impénétrables.
Félicitons-nous de l’acuité de cette crise, car elle suscita des études approfondies sur le sérum sanguin des sujets immunisés, qui nous amenèrent rapidement à la sérothérapie de Behring et de Roux, l’une des applications les plus importantes de la bactériologie.
Au cours des travaux entrepris pour faire prévaloir tantôt l’influence des humeurs, tantôt celle des cellules lymphatiques dans la défense de l’organisme contre une invasion de microbes, Pfeiffer, puis Bordet s’aperçurent que le sérum des sujets immunisés jouissait, outre les pouvoirs bactéricide et autitoxique, préventif et curatif, de la propriété de rassembler les microbes en petits amas avant de les détruire. Gruber et Durham étendirent l’observation de Pfeiffer et de Bordet à plusieurs bacilles, et partagèrent leurs illusions en regardant l’agglutination comme une phase préparatoire à la destruction des microbes.
La découverte du pouvoir agglutinant (car tel est le nom donné à la propriété décrite par Pfeiffer et Gruber) est, au demeurant, un épisode de cette grande crise sérologique, la plus récente de la bactériologie, épisode sur lequel je voudrais retenir votre attention pendant quelques instants.