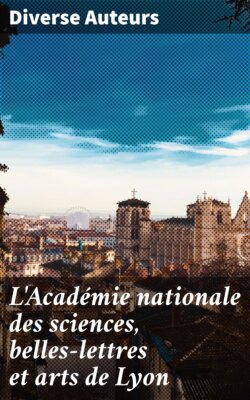Читать книгу L'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon - Diverse Auteurs - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ABABDEH
ОглавлениеTable des matières
La famille des Ababdeh qui a jadis vaincu les Bicharieh a vu grandir encore son importance depuis que le gouvernement lui a accordé sa protection dans le but, bien défini, d’achever la destruction des Bicharieh dont l’indépendance indomptable était gênante. Ils vivent au nombre de 40.000 environ, disséminés soit en Nubie, soit dans le désert entre le Nil au sud de Keneh et la mer Rouge près de Kosséir où ils cédèrent la place aux Bédouins Maazeh.
Les Ababdeh diffèrent des Bicharieh tant sous le rapport du type que sous celui des usages. Installés assez souvent dans des villages occupés jadis par ces derniers, ils sont devenus sédentaires. Par suite de leurs alliances avec des femmes arabes, Barabras et surtout Soudanaises, leur type a perdu une partie de son caractère bedjah. Menant une vie plus calme et vivant au contact des Egyptiens, leur teint s’est éclairci; ils ont abandonné l’usage de la longue et typique chevelure. Ils ont pris généralement le costume des gens de la vallée du Nil, à l’exemple de leur grand cheikh Bechir-bey qui possède d’immenses propriétés dans les régions de Keneh et d’Edfou. Comme les autres Bedjah, les Ababdeh possèdent surtout des chameaux. Leurs armes sont aussi les mêmes que celles des Bicharieh. Les principales tribus sont celles d’Achabab, de Fougara, Houboudie, Aouater, Melekah, Kavoadi, etc.
Durant mes divers séjours à Assouan j’ai mesuré une cinquantaine d’Ababdeh de la tribu des Hachabab, tous du sexe masculin. La couleur des yeux et des cheveux est généralement brun foncé ou noire parmi eux. Leur indice céphalique moyen (longueur-largeur) est de 75,13.
Les indices céphaliques des Ababdeh forment deux groupes distincts: l’un, le plus considérable (trente-trois sujets) ne présente que des indices inférieurs à 76, tandis que l’autre (vingt-deux sujets) est composé d’indices dépassant tous celui de 77.
La mise en séries ci-dessous montre, d’autre part, que quatre sujets seulement sont brachycéphales, vingt-huit sont dolichocéphales et 18 mésaticéphales.
Mise en séries de l’indice céphalique des Ababdeh.
La courbe antéro-postérieure est régulière et la voûte est généralement surélevée, l’indice transverso-vertical (auriculo-bregmatique) des 5 autres sujets est de 85,5. Cet indice se groupe à peu près de la même manière que celui de longueur.
Il peut être divisé en deux séries: l’une se compose de trente-deux sujets avec l’indice 83,5o et l’autre de dix-huit sujets avec celui de 86,01.
Mise en séries de l’indice céphalique longueur-largeur des Bicharieh et des Ababdeh
La face est plutôt large qu’étroite. Son indice moyen est de io5,64. La mise en séries ci-dessous fait voir que trente-trois sujets ont la face courte avec des indices supérieurs à 105; tandis que chez dix-sept sujets cet indice est inférieur à 100.
Mise en séries de l’indice facial.
Le nez est plus large chez les Ababdeh que chez les Bicharieh. Son indice est de 81,82. La mise en série de cet indice indique une mésorhinie qui, chez vingt-huit sujets, touche à la platirhinie. Mais vingt-deux sont vraiment mésorhiniens.
Mise en séries de l’indice nasal.
La taille est généralement plus élevée chez les Ababdeh que chez les Bicharieh. La moyenne est de 1m67. La mise en série de cette mesure montre que trente-quatre individus ont une taille supérieure à 1,70 et que seize restent en dessous de 1m64.
Mise en séries de la taille debout.
La grande envergure présente à peu de chose près les mêmes particularités que la taille. La moyenne en est de 174. Si l’on compare cette mesure à celle de la taille, on verra qu’elle est presque toujours supérieure à celle-ci comme le montre la mise en séries ci-dessous.
Mise en séries de la grande envergure.
Mise en séries de la grande envergure comparée à la taille.
De l’étude morphologique de ces 5o Abaldeh il ressort qu’ils forment ainsi que les Bicharieh, mais à un plus haut degré, deux groupes distincts.
Bien que l’on ait voulu confondre en une seule et même race les familles Ababdeh et Bicharieh, l’étude de leurs caractères morphologiques aussi bien que celle de leurs caractères ethnographiques montre qu’elles forment deux familles bien distinctes.
Par les chiffres que j’ai donnés plus haut, on a pu constater que les Bicharieh sont moins dolichocéphales et moins hypsicéphales que les Ababdeh. Chez les premiers, on remarque aussi une mésorhinie plus élevée, surtout chez la tribu des Hamrah. La fréquence des cheveux laineux et des lèvres lippues, associée à ce dernier caractère, semble prouver qu’une partie de cette population a des tendances à se mêler plus avec les Soudanais et les Barabras, eux-mêmes fortement métissés de nègres, qu’avec les Arabes avec lesquels on a proposé de les ranger. Cette étude montre enfin que ces deux familles doivent être divisées chacune en deux groupes assez différents. L’un présente les caractères vraiment éthiopiens, tels que M. Verneau les a récemment définis; l’autre, sans doute métissé de Soudanais, est plutôt négroïde.
Si maintenant on compare les caractères morphologiques des Bedjah que nous venons d’étudier avec ceux de quelques séries de crânes attribués à ce même peuple, ainsi qu’avec ceux de quelques séries d’individus vivants, appartenant à des familles voisines, on fera des constatations intéressantes. C’est ainsi que quatre crânes que M. le Dr Fouquet a reçus de M. Schweinfurth et venant de sépultures anciennes de Bedjah du désert de Chellall, près d’Assouan, présentent un indice céphalique moyen de 74,03 (deux hommes 72,44, et deux femmes 75,14). En ajoutant à ce chiffre les deux unités conventionnelles, on aura l’indice de 76,03 qui correspond assez bien à celui des Bedjah vivants.
Une autre série plus considérable et plus anciennement connue, et que l’on doit attriluer à des Barabras, est celle que MM. Broca et Hamy ont rapportée de l’île d’Eléphantine, près Assouan. Cette série composée de vingt-deux pièces présente, d’après Broca, un indice céphalique moyen de 74,47. En ajoutant deux unités on aura l’indice de 76,47, lequel n’est pas très éloigné également de celui de nos Bedjah. J’ai constaté, en effet, les indices de 76,59 (longueur-largeur) et de 87,25 (largeur-hauteur) sur une série de 11 Barabras vivants de l’île d’Eléphantine; puis celui (longueur-largeur) de 76,50 et de 85,41 (largeur-hauteur) sur 14 sujets de même race à Chellall, enfin celui de 78,37 (longueur-largeur) et de 86 (largeur-hauteur) sur quinze autres Barabras de l’île de Bigeh.
Il n’est pas sans intérêt sans doute de rappelerici les résultats auxquels est arrivé M. le Dr Santelli dans l’étude qu’il a faite de 54 Danakils. Cet observateur a trouvé chez cette population éthiopienne, l’indice céphalique moyen de 74,45. Il a constaté que 34 sujets étaient de vrais dolichocéphales; 13 dolichocéphales, 4 mésaticéphales et 3 sous-brachycéphales.
L’indice nasal des divers Barabras vivants, que j’ai mesurés dans la région d’Assouan, se rapprochent également beaucoup de celui des Bicharyeh et des Ababdeh. Il varie entre 80,42 (Eléphantine); 85,71 (Bigeh) et 89,42 (Chellall).
Ces faits montrent que, parmi les peuples rangés près des Bedjah, il en est, et les Barabras le prouvent surabondamment, qui, bien que présentant des caractères éthiopiens avec la voûte de leur crâne surbaissée, diffèrent de l’ensemble du groupe par les caractères négroïdes de leur face aussi bien que par la hauteur relativement considérable de leur crâne. Si nous étendions ces comparaisons aux Égyptiens (Coptes et Fellah), on trouverait plus d’un rapport entre cette population et celles dont nous venons d’étudier les caractères morphologiques.
Des observations et comparaisons précédentes, il résulte que les Bedjah (Bicharieh et Ababdeh) doivent être définitivement rattachés aux Ethiopiens à coté des Danakils, des Bogos, des Somalis et des Barabras.
Les faits qui permettent de présenter cette conclusion viennent confirmer les vues qu’avaient exposées autrefois M. Hamy et qui ont été récemment rappelées par M. Verneau au sujet des peuples de l’Éthiopie et de Haute-Egypte, à savoir «qu’ils ne sont, au point de vue ethnique que des variétés d’une même race».